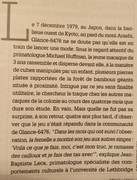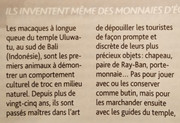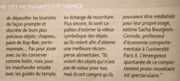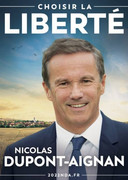Article fort intéressant par des chercheurs français. La différence entre un animal et humain ne serait pas le langage, mais bien l'imagination et les représentations géométriques. Avec ces deux ingrédients dans le boudin, nous arrivons à la symbolique. Comme Jung aurait été heureux!
La géométrie est-elle un langage que seuls les humains connaissent ?
22 mars 2022
Lors d'un atelier l'automne dernier au Vatican, Stanislas Dehaene, neuroscientifique cognitif au Collège de France, a fait une présentation relatant sa quête pour comprendre ce qui rend les humains - pour le meilleur ou pour le pire - si spéciaux.
Le Dr Dehaene a passé des décennies à sonder les racines évolutives de notre instinct mathématique ; c'était le sujet de son livre de 1996, "The Number Sense: How the Mind Creates Mathematics". Dernièrement, il s'est concentré sur une question connexe : quelles sortes de pensées, ou de calculs, sont propres au cerveau humain ? Selon le Dr Dehaene, une partie de la réponse pourrait résider dans nos intuitions apparemment innées sur la géométrie.
Organisé par l'Académie pontificale des sciences, l'atelier du Vatican a abordé le sujet "Symboles, mythes et sens religieux chez l'homme depuis le premier", c'est-à-dire depuis l'apparition des premiers humains il y a quelques millions d'années. Le Dr Dehaene a commencé son diaporama par un collage de photographies montrant des symboles gravés dans la roche - faux, haches, animaux, dieux, soleils, étoiles, spirales, zigzags, lignes parallèles, points. Certaines des photos qu'il a prises lors d'un voyage dans la Vallée des Merveilles dans le sud de la France. On pense que ces gravures remontent à l'âge du bronze, à partir d'environ 3 300 av. à 1 200 avant J.-C. ; d'autres avaient 70 000 et 540 000 ans. Il a également montré une photo d'un outil en pierre "biface" - sphérique à une extrémité, triangulaire à l'autre - et il a noté que les humains avaient sculpté des outils similaires il y a 1,8 million d'années.
Pour le Dr Dehaene, c'est la tendance à imaginer - un triangle, les lois de la physique, la racine carrée de moins 1 - qui capture l'essence de l'être humain. "L'argument que j'ai avancé au Vatican est que la même capacité est au cœur de notre capacité à imaginer la religion", a-t-il rappelé récemment.
Il a reconnu, en riant, qu'il n'y a pas qu'un pas entre l'imagination d'un triangle et la conception d'une religion. (Sa propre trajectoire intellectuelle impliquait un diplôme en mathématiques et une maîtrise en informatique avant de devenir neuroscientifique). Néanmoins, dit-il, "Voici ce que nous devons expliquer : Soudain, il y a eu une explosion d'idées nouvelles avec l'espèce humaine."
Humain ou babouin ?
Au printemps dernier, le Dr Dehaene et son Ph.D. Mathias Sablé-Meyer, étudiant, a publié, avec des collaborateurs, une étude comparant la capacité des humains et des babouins à percevoir des formes géométriques. L'équipe s'est demandée : Quelle était la tâche la plus simple dans le domaine géométrique - indépendamment du langage naturel, de la culture, de l'éducation - qui pourrait révéler une différence de signature entre les primates humains et non humains ? Le défi consistait à mesurer non seulement la perception visuelle, mais un processus cognitif plus profond.
Cette ligne de recherche a une longue histoire, mais est toujours fascinante, selon Moira Dillon, scientifique cognitive à l'Université de New York qui a collaboré avec le Dr Dehaene sur d'autres recherches. Platon croyait que les humains étaient particulièrement sensibles à la géométrie ; le linguiste Noam Chomsky a soutenu que le langage est une capacité humaine biologiquement enracinée. Le Dr Dehaene vise à faire pour la géométrie ce que le Dr Chomsky a fait pour le langage. "Le travail de Stan est vraiment innovant", a déclaré le Dr Dillon, notant qu'il utilise des outils de pointe tels que des modèles informatiques, la recherche inter-espèces, l'intelligence artificielle et l'IRM fonctionnelle. techniques de neuroimagerie.
Dans l'expérience, on a montré aux sujets six quadrilatères et on leur a demandé de détecter celui qui était différent des autres. Pour tous les participants humains - adultes et enfants de la maternelle français ainsi que des adultes de la Namibie rurale sans éducation formelle - cette tâche "d'intrus" était beaucoup plus facile lorsque les formes de base ou la valeur aberrante étaient régulières, possédant des propriétés telles que des côtés parallèles et des angles droits. .
Les chercheurs ont appelé cela "l'effet de régularité géométrique" et ils ont émis l'hypothèse - c'est une hypothèse fragile, admettent-ils - que cela pourrait fournir, comme ils l'ont noté dans leur article, une "signature putative de la singularité humaine".
Avec les babouins, la régularité ne faisait aucune différence, a constaté l'équipe. Vingt-six babouins - dont Muse, Dream et Lips - ont participé à cet aspect de l'étude, dirigée par Joël Fagot, psychologue cognitif à Aix-Marseille Université.
Les babouins vivent dans un centre de recherche du sud de la France, sous la Montagne Sainte-Victoire (l'une des préférées de Cézanne), et ils adorent les cabines de test et leurs écrans tactiles de 19 pouces. (Le Dr Fagot a noté que les babouins étaient libres d'entrer dans la cabine de test de leur choix - il y en avait 14 - et qu'ils étaient "maintenus dans leur groupe social pendant les tests".) Ils maîtrisaient le test de bizarrerie lors de la formation avec des images non géométriques une pomme, disons, parmi cinq tranches de pastèque. Mais lorsqu'ils sont présentés avec des polygones réguliers, leurs performances se sont effondrées.
Athias Sablé-Meyer, Stanislas Dehaene et al.
"Les résultats sont frappants, et il semble en effet qu'il y ait une différence entre la perception des formes par les humains et les babouins", a déclaré Frans de Waal, primatologue à l'Université Emory, dans un e-mail. "Pour savoir si cette différence de perception équivaut à la" singularité "humaine, il faudrait attendre des recherches sur nos primates les plus proches, les singes", a déclaré le Dr de Waal. "Il est également possible, comme le soutiennent (et rejettent) les auteurs, que les humains vivent dans un environnement où les angles droits comptent, contrairement aux babouins."
Pour aller plus loin, les chercheurs ont tenté de reproduire les performances des humains et des babouins avec l'intelligence artificielle, en utilisant des modèles de réseaux de neurones inspirés d'idées mathématiques de base sur ce que fait un neurone et comment les neurones sont connectés. Ces modèles - des systèmes statistiques alimentés par des vecteurs de grande dimension, des matrices multipliant des couches sur des couches de nombres - correspondaient avec succès aux performances des babouins mais pas à celles des humains ; ils n'ont pas réussi à reproduire l'effet de régularité. Cependant, lorsque les chercheurs ont créé un modèle gonflé avec des éléments symboliques - le modèle a reçu une liste de propriétés de régularité géométrique, telles que des angles droits, des lignes parallèles - il a fidèlement reproduit la performance humaine.
Ces résultats, à leur tour, posent un défi à l'intelligence artificielle. "J'adore les progrès de l'IA", a déclaré le Dr Dehaene. "C'est très impressionnant. Mais je crois qu'il manque un aspect profond, qui est le traitement des symboles », c'est-à-dire la capacité de manipuler des symboles et des concepts abstraits, comme le fait le cerveau humain. C'est le sujet de son dernier livre, "Comment nous apprenons : pourquoi les cerveaux apprennent mieux que n'importe quelle machine... pour l'instant".
Yoshua Bengio, informaticien à l'Université de Montréal, a convenu que l'IA actuelle manque de quelque chose lié aux symboles ou au raisonnement abstrait. Les travaux du Dr Dehaene, a-t-il dit, présentent "des preuves que les cerveaux humains utilisent des capacités que nous ne trouvons pas encore dans l'apprentissage automatique de pointe".
C'est particulièrement le cas, dit-il, lorsque nous combinons des symboles tout en composant et recomposant des connaissances, ce qui nous aide à généraliser. Cet écart pourrait expliquer les limites de l'I.A. — une voiture autonome, par exemple — et la rigidité du système face à des environnements ou des scénarios différents du répertoire de formation. Et c'est une indication, a déclaré le Dr Bengio, de l'endroit où A.I. la recherche doit avancer.
Le Dr Bengio a noté que des années 1950 aux années 1980, les stratégies de traitement symbolique dominaient la « bonne vieille I.A. » Mais ces approches étaient moins motivées par le désir de reproduire les capacités du cerveau humain que par un raisonnement basé sur la logique (par exemple, vérifier la preuve d'un théorème). Puis vint l'IA statistique. et la révolution des réseaux de neurones, qui a commencé dans les années 1990 et s'est accélérée dans les années 2010. Le Dr Bengio a été un pionnier de cette méthode d'apprentissage en profondeur, directement inspirée du réseau de neurones du cerveau humain.
Ses dernières recherches proposent d'étendre les capacités des réseaux de neurones en les entraînant à générer ou à imaginer des symboles et d'autres représentations.
Il n'est pas impossible de faire un raisonnement abstrait avec des réseaux de neurones, a-t-il dit, "c'est juste que nous ne savons pas encore comment le faire". Le Dr Bengio a un projet majeur aligné avec le Dr Dehaene (et d'autres neuroscientifiques) pour étudier comment les pouvoirs de traitement conscients humains pourraient inspirer et renforcer l'IA de prochaine génération. "Nous ne savons pas ce qui va fonctionner et quelle sera, en fin de compte, notre compréhension de la façon dont le cerveau le fait", a déclaré le Dr Bengio.
Connaître un triangle
Le mathématicien français René Descartes a estimé que "nous ne pourrions jamais connaître le triangle géométrique à travers celui que nous voyons tracé sur le papier si notre esprit n'en avait pas eu l'idée ailleurs". Le Dr Dehaene et M. Sablé-Meyer empruntent ce sentiment dans l'épigraphe d'une nouvelle étude, actuellement à l'étude, dans laquelle ils tentent de cerner cet "ailleurs" cognitif - offrant des théories et des preuves empiriques de ce que "l'ailleurs" pourrait être.
S'appuyant sur des recherches datant des années 1980, ils proposent un «langage de la pensée» pour expliquer comment les formes géométriques pourraient être encodées dans l'esprit. Et dans une tournure convenablement détournée, ils trouvent l'inspiration dans les ordinateurs.
"Nous postulons que lorsque vous regardez une forme géométrique, vous avez immédiatement un programme mental pour cela", a déclaré le Dr Dehaene. "Vous le comprenez, dans la mesure où vous avez un programme pour le reproduire." En termes de calcul, cela s'appelle l'induction de programme. "Ce n'est pas anodin", a-t-il dit. "C'est un gros problème en intelligence artificielle - inciter un programme à faire une certaine chose à partir de son entrée et de sa sortie. Dans ce cas, c'est juste une sortie, qui est le dessin de la forme.
En abordant de telles questions, Josh Tenenbaum, scientifique cognitif informatique au Massachusetts Institute of Technology et auteur du nouvel article à l'étude, aime demander : comment nous, les humains, parvenons-nous à extraire autant de si peu - si peu de données, de temps , énergie ? Son approche consiste à résoudre l'énigme de ces sauts inductifs.
"Au lieu d'être inspiré par de simples idées mathématiques sur ce que fait un neurone, il s'inspire d'idées mathématiques simples sur ce qu'est la pensée", a-t-il déclaré. la distinction est celle du matériel par rapport au logiciel, essentiellement. C'est une approche motivée par le mathématicien et informaticien britannique Alan Turing, entre autres, et l'idée que la pensée est une sorte de programmation.
Avec cette nouvelle étude, le Dr Dehaene et M. Sablé-Meyer ont commencé par proposer un langage de programmation pour dessiner des formes. Mais la nouveauté, a déclaré M. Sablé-Meyer, n'était pas simplement de proposer le langage - "il doit y en avoir des milliers maintenant, à commencer par Logo dans les années 60 et tout un tas de graphiques dérivés de tortues" - mais plutôt dans concevoir un langage qui imite notre compétence humaine pour la géométrie.
Le langage est composé de primitives géométriques, y compris des blocs de construction de base de formes, ainsi que des règles qui dictent comment ceux-ci peuvent être combinés pour produire des symétries et des motifs. Cependant, le but ultime de l'invention d'un tel langage n'est pas simplement le dessin, a déclaré M. Sablé-Meyer ; c'est en développant "une bonne théorie candidate pour la cognition" - une théorie plausible sur la façon dont les pensées, ou les calculs, sont traités dans l'esprit.
Ensuite, les chercheurs ont utilisé un A.I. algorithme appelé DreamCoder, développé il y a quelques années par Kevin Ellis alors qu'il était doctorant. étudiant travaillant avec le Dr Tenenbaum; il est maintenant informaticien à l'Université Cornell et auteur de la nouvelle étude. DreamCoder a modélisé la façon dont l'esprit pourrait utiliser le langage de programmation pour traiter de manière optimale les formes : l'algorithme trouve, ou apprend, le programme le plus court possible pour une forme ou un motif donné. La théorie est que l'esprit fonctionne à peu près de la même manière.
Langage géométrique
Les chercheurs ont développé un langage de programmation pour générer des formes de complexité croissante. La théorie est que le cerveau encode de la même manière des formes en tant que programmes dans un langage.
À droite, les formes trouvées dans de nombreuses cultures comprennent des lignes, des cercles, des spirales, des zigzags, des carrés et des carrés de cercles.
Le langage de programmation a dessiné des formes de plus en plus complexes combinant des lignes, des cercles, des arcs et des spirales.
Les formes géométriques de base trouvées dans de nombreuses cultures comprennent les lignes, les cercles, les spirales, les zigzags, les carrés et les carrés de cercles.
Le langage de programmation a dessiné des formes de plus en plus complexes combinant des lignes, des cercles, des arcs et des spirales.
Les chercheurs ont ensuite réintégré les humains dans l'équation, en testant la capacité des sujets à traiter des formes de complexité variable générées par le langage de programmation. Au cours d'un test, ils ont mesuré combien de temps il a fallu aux gens pour mémoriser une forme telle qu'une courbe ondulée, par rapport au temps qu'il a fallu pour trouver cette forme parmi une collection de six gribouillis similaires (appelé test d'appariement à l'échantillon). Les chercheurs ont constaté que plus une forme est complexe et plus le programme est long, plus un sujet a de la difficulté à s'en souvenir ou à la distinguer des autres.
Les babouins tentent ce test maintenant. Mais au-delà de ces études comportementales, les chercheurs espèrent approfondir encore plus la pensée symbolique – au laboratoire de neuroimagerie NeuroSpin du Dr Dehaene, avec des IRM fonctionnelles qui mesurent l'activité neuronale pendant que les sujets s'amusent avec des confections géométriques. Le Dr Dehaene dispose déjà de certaines données montrant que les régions cérébrales impliquées - dans les lobes préfrontal et pariétal - se chevauchent avec celles connues pour être associées au "sens du nombre" humain.
Les zones du cerveau qui s'illuminent pour le langage de la géométrie sont ce que le Dr Dehaene et son ancien Ph.D. étudiante, Marie Amalric, maintenant boursière postdoctorale à Harvard, a appelé le réseau sensible aux mathématiques. "Ils sont très différents des régions classiques activées par la langue parlée ou écrite, comme l'aire de Broca", a-t-il déclaré.
La langue est souvent supposée être la qualité qui délimite la singularité humaine, a noté le Dr Dehaene, mais il y a peut-être quelque chose de plus fondamental, de plus fondamental.
"Nous proposons qu'il existe des langues - plusieurs langues - et qu'en fait, la langue n'a peut-être pas commencé comme un dispositif de communication, mais vraiment comme un dispositif de représentation, la capacité de représenter des faits sur le monde extérieur", a-t-il déclaré. "C'est ce que nous recherchons."