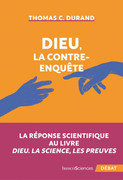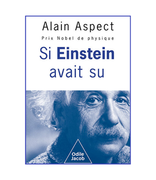Philippe de Bellescize a écrit : 14 janv. 2025, 12:17
Bonjour,
ABC a écrit : 12 janv. 2025, 12:55
Philippe de Bellescize a écrit : 11 janv. 2025, 14:17Dans la formulation d'une théorie générale de l'Univers il y a un certain ordre à respecter.
Le tout premier étant d'avoir la compétence requise pour s'exprimer sur ce sujet et de citer des sources dignes de confiance concernant ce sujet.
Philippe de Bellescize a écrit : 11 janv. 2025, 14:17vous pourriez reconnaître un certain aspect heuristique à ce type de démarche.
Non.
Dominique18 a écrit : 13 janv. 2025, 17:51Pour aborder les questions de physique de haut niveau, il faut se tourner vers des autorités compétentes (…).
Je vais sans doute enfoncer une porte ouverte mais qui n'est peut-être pas toujours si ouverte que cela : Il ne faut pas confondre intelligence des choses et compétence dans un domaine donné.
L'intelligence, au moins dans un de ses aspects essentiels, c'est lire de l'intérieur en ayant une perception des choses - parfois par connaturalité – dans leur globalité. L’acquisition de compétences peut conduire à la spécialisation, qui, bien que nécessaire, porte en elle le risque de la perte de cette vue d'ensemble dans ce qu'elle a de fondamentale. Celui qui a la compétence, s'il laisse tomber certaines grandes interrogations, risque de se trouver dans ce cas là. Plus grave encore, il peut empêcher les autres de progresser en bloquant, plus ou moins consciemment, certaines interrogations pourtant légitimes. Il y a dans l'interrogation un acte d'intelligence et d'humilité – en effet elle implique, d'une part une première perception initiale, d'autre part la reconnaissance des limites de notre savoir ou de notre connaissance des choses.
Il serait un peu pernicieux de vouloir bloquer un angle d'analyse pourtant légitime, sous prétexte qu'il n'est pas celui utilisé de manière courante par les
physiciens. La question n'est pas de savoir si son utilisation est habituelle, mais celle de se demander s'il est légitime, et si un non physicien peut avoir son mot à dire sur la question. Or il a des concepts, bien qu'utilisés par la physique, qui restent protophysiques, c'est à dire n'étant pas du seul domaine de la physique.
.....
Ça fait un moment que les scientifiques, dans différents domaines, travaillent en équipes interdisciplinaires, pour passer l'écueil de l'hyper-spécialisation (IA, préhistoire, médecine,...), ce qui rend quelque peu caduque ce genre de considérations.
C'est l'une des formes d'organisation les plus efficaces qui soient. Il a fallu du temps pour que le concept s'installe.
La somme des parties pouvant produire un résultat supérieur à ce qu'aurait découvert un individu seul, aussi affûté soit-il.
En neurosciences, il n'est pas rare de trouver un philosophe, des sciences, il va sans dire, un sociologue,... chacun oeuvre suivant son domaine de compétence, mais sans empiéter intempestivement sur le territoire de ses voisins.
Quand on traite de physique de haut niveau, il faut s'adresser à un physicien, pas à un philosophe.
Ce n'est pas la peine de tourner autour du pot, les digressions philosophiques ne pourront pas cautionner des hypothèses pseudo-scientifiques, et ce au détriment de la physique. Pas d'être suprême, pas de dessein intelligent, pasd de principe moteur, mais des questions qui restent sans réponse, et ce en l'état actuel des connaissances (année 2025).
Un objet philosophique n'est pas équivalent à un objet scientifique (cf. démarche scientifique , prédictions, etc... déjà évoqués).
La perniciosité, dans cette histoire, serait d'essayer de retirer "subtilement" la légitimité d'un physicien à se prononcer sur l'état physique du monde, à grands renforts de circonvolutions rhétoriques à la Templeton/IUP/Staune et consorts.
Ca ne marche pas comme ça. Nous sommes dans la parlotte, pas dans la science. L'aventure a déjà été tentée, sans succès (Bogdanov-Guitton). Guitton s'est ramassé une veste, il aurait mieux fait de s'abstenir.
Je ne suis pas sûr que Mario Bunge s'y retrouverait.
Vérifions...
https://www.erudit.org/fr/revues/philos ... /045191ar/
...La connaissance scientifique n’est pas un simple prolongement de la connaissance ordinaire, elle est plutôt un type particulier de connaissance puisqu’elle dépasse l’observable par ses conjectures, qu’elle teste par des techniques spéciales. Donc, la connaissance ordinaire, qui se rattache à l’observable ou à l’anthropomorphisme, serait un bien mauvais juge de la science. La morale pour les philosophes devrait être claire : n’essayez pas de réduire la science à la connaissance ordinaire, mais apprenez plutôt un peu de science avant de philosopher à son propos . C’est pourquoi la connaissance scientifique est souvent indirecte selon Bunge et, même si elle traite de l’inobservable, elle doit reposer sur des hypothèses testables. Bien que nous soyons immergés dans la réalité, la connaissance que nous en avons n’est pas immédiate (Bunge, 2006, p. xi). Elle s’obtient par une analyse rationnelle et empirique. Évidemment, une telle hétérogénéité est à même de froisser le philosophe moderne. Mais Bunge a déjà un préjugé favorable envers la science, car il juge qu’il s’agit du mode de connaissance le plus efficace. Il n’est pas parfait — et c’est pourquoi une étude critico-philosophique est nécessaire —, mais c’est le meilleur. Le défi est donc lancé : si vous croyez pouvoir fonder la connaissance du monde sur un mode autre que ce mélange (en apparence) hétéroclite de rationalisme et d’empirisme qu’on appelle la science — allez-y ! Comme le disait Novalis, les théories sont des filets : seul celui qui lance pêchera.
Puisque la science constitue le mode de connaissance le plus efficace pour explorer le monde, il convient donc d’en analyser les particularités. Aussi Bunge (1967c) présente-t-il quelques présupposés philosophiques de la science : 1) le réalisme : le monde extérieur existe ; 2) le pluralisme des propriétés : il y a des « niveaux » de réalité ; 3) le déterminisme ontologique : les événements sont déterminés par des lois, et rien ne naît de rien ; 4) le déterminisme gnoséologique : le monde extérieur est connaissable ; 5) le formalisme : l’autonomie de la logique et des mathématiques. Donc, la science n’est pas philosophiquement neutre. C’est pourquoi il est vain de prétendre éliminer toute philosophie des sciences : ignorer toute philosophie, c’est se rendre esclave de mauvaises philosophies (Bunge, 1966, p. 596). En effet, le but de la science est de donner le grand portrait ontologique et épistémologique de la réalité. Science et philosophie peuvent apprendre l’une de l’autre : la science sans philosophie perd de sa profondeur, tandis que la philosophie sans science fait du sur place (Bunge, 2000b, p. 461)...
Nous sommes donc fixés.
La véritable réponse est là :
viewtopic.php?t=17325&start=1100#p654795
On en prend acte ou pas, mais dans ce cas, il ne faut pas espérer de miracles.
Comme l'a rappelé ABC, c'est une conclusion, pas une invitation à continuer. Dura lex sed lex.