Bonne initiative.Bon bon bon...ça n'avance pas beaucoup cette discussion.
Si on en revenait aux bases?
juliens a écrit :
En espérant que...
Bonne initiative.Bon bon bon...ça n'avance pas beaucoup cette discussion.
Si on en revenait aux bases?
juliens a écrit :
LoutredeMer a écrit : 13 févr. 2023, 20:25 Bon bon bon...ça n'avance pas beaucoup cette discussion.
Si on en revenait aux bases?
.juliens a écrit :Nous pouvons déduire que le processus cognitif est UN biais porteur de distorsion et non une multitude de biais disparate dont nous ne connaissons pas l'étendue, sa complexité, son origine, son interaction, sa raison d'être, son utilité.https://aprisme.blog/psychologie/cognit ... ge-content
Les biais cognitifs (aussi appelés biais psychologiques) sont des formes de pensée qui dévient de la pensée logique ou rationnelle et qui ont tendance à être systématiquement utilisées dans diverses situations.
Ils constituent des façons rapides et intuitives de porter des jugements ou de prendre des décisions qui sont moins laborieuses qu’un raisonnement analytique qui tiendrait compte de toutes les informations pertinentes.
Ces jugements rapides sont souvent utiles mais sont aussi à la base de jugements erronés typiques.
Le concept a été introduit au début des années 1970 par les psychologues Daniel Kahneman (prix Nobel en économie en 2002) et Amos Tversky pour expliquer certaines tendances vers des décisions irrationnelles dans le domaine économique.
----------------------
Le biais cognitif st un concept différent de celui de distorsion cognitive qui a été développé dans le champ de la psychologie clinique.
----------------------
Le terme distorsion cognitive a été introduit en 1967 par le psychiatre américain Aaron Beck, pionnier de la TCC.
Souvent les distorsions sont confondues avec les biais. …… Pour simplifier les distorsions s’apparentent plus à des préjugés quand les biais peuvent se comparer à des attitudes.
Selon son modèle, les distorsions cognitives sont des façons de traiter l’information qui résultent en erreurs de pensée prévisibles ayant souvent pour conséquence d’entretenir des pensées et des émotions négatives.
Elles contribuent ainsi aux troubles émotionnels tels que la dépression et l’anxiété ainsi qu’aux troubles de la personnalité. Mais aussi à nos comportements quotidiens.
--------
La dissonance cognitive est un concept introduit par le psychologue social Leon Festinger. Ainsi c’est un état de tension ressenti par une personne en présence de cognitions (connaissances, opinions ou croyances) incompatibles entre elles
La dissonance cognitive amène la personne à mettre en œuvre des stratégies visant à restaurer un équilibre cognitif (changer une ou plusieurs croyances, discréditer certaines informations, rechercher de nouvelles informations…).
En d’autres termes, les dissonances sont des tensions dues aux cognitions et aux valeurs incompatibles entres elles et incompatibles avec les faits. Ainsi elles nécessitent pour la personne l’obligation de changer l’information traitée (biais, distorsions…) ou de modifier ses valeurs. Des valeurs (ensemble de croyances) que le thérapeute ou le coach va tenter de changer.
Cette théorie repose sur le principe de consistance selon lequel l’humain serait motivé à conserver une cohérence entre ses attitudes et ses comportements. La théorie de la dissonance cognitive (1957) permet de faire l’hypothèse suivante : si un individu est amené à agir librement de manière antinomique à son attitude initiale, il modifiera cette attitude conformément au comportement émis.
Il y a des progrès à faire...Loutre a écrit :
Bon bon bon...ça n'avance pas beaucoup cette discussion.
Si, parce qu’il ne va retenir que ce qui va dans son sens et oublier/rejeter/nier/négliger ce qui ne va pas dans son sens. C’est précisément le biais de confirmation.juliens a écrit : 13 févr. 2023, 22:23 Prenons le cas d'un conspirationniste, nous lui attribuons des biais de confirmation par exemple. Mais est-ce bien le cas? Non.
Et quelle serait l'origine de cette "intention" ?Voyons plutôt que l'intention dans le processus cognitif affecte l'utilisation de la confirmation, une distorsion créée par l'intention. Nous pouvons poursuivre en nous demandant pourquoi cette intention... Est-il possible que ce soit ou/en autre, l'intention dans le processus cognitif qui forme des distorsions et qu'on appelle des biais?
Ce n'est pas une intention, mais la dissonance cognitive qui amène des distorsions cognitives qui génèreront, elles, des biais.juliens a écrit : 13 févr. 2023, 22:23 Qu'est-ce qui peut transformer un processus cognitif comme la confirmation en "biais"?
(...)
Est-il possible que ce soit ou/en autre, l'intention dans le processus cognitif qui forme des distorsions et qu'on appelle des biais?
D'où le succès de certaines formes de désinformation...Le biais est plutôt un moyen conscient utilisé pour ce rééquilibrage en rationalisant de façon erronée (omission, évitement, choix arbitraire, surestimation etc).
C'est là ou l'on voit bien que le biais est un effet de la dissonnance et de la distorsion cogitives. Une tentative de rationalisation ratée (l'intuition prime sur l'analytique), par des raccourcis (= heuristiques) pour contourner l'inconfort d'une dissonance cognitive."Certains biais s’expliquent par les ressources en cognition limitées. Lorsque ces dernières (temps, informations, intérêt, capacités cognitives, *j'ajoute énergie et pathologies*) sont insuffisantes pour réaliser l’analyse nécessaire à un jugement rationnel, des raccourcis cognitifs (appelés heuristiques) permettent de porter un jugement rapide. Ces jugements rapides sont souvent utiles mais sont aussi à la base de jugements erronés typiques.
D’autres biais reflètent l’intervention de facteurs motivationnels, émotionnels ou moraux ; par exemple, le désir de maintenir une image de soi positive ou d’éviter une dissonance cognitive (avoir deux croyances incompatibles) déplaisante."
Ou à l'urgence.Il apparaît, à l'issue de ce test, que le sujet testé identifie quasi-immédiatement les mimiques de peur et ce au détriment des autres.
Une possible explication, d'après les psychologues : ce biais comportemental est peut-être lié à la notion ancestrale de survie,
En l'état actuel des connaissances, c'est le constat que l'on peut dresser.Pour en revenir à l'intention, qui est donc au niveau du biais, c'est l'éternelle question : est-elle voulue ou automatique? je pense qu'il existe les deux cas de figure, ce qui rend l'évaluation difficile.
Un biais est inconscient, il ne peut donc pas être voulu, sinon ce n’est plus un biais mais une tromperie.Un biais cognitif est un réflexe de pensée faussement logique, inconscient, et systématique. Ancrés au fin fond de notre cerveau...
L'intention, la motivation et indirectement la volonté, le désir, sont des sous-processus cognitifs tout comme les sous-processus de confirmation, d'autorité...richard a écrit : 14 févr. 2023, 18:30Un biais est inconscient, il ne peut donc pas être voulu, sinon ce n’est plus un biais mais une tromperie.Un biais cognitif est un réflexe de pensée faussement logique, inconscient, et systématique. Ancrés au fin fond de notre cerveau...
Oui, c'est un réflexe du cerveau.richard a écrit : 14 févr. 2023, 18:30Un biais est inconscient, il ne peut donc pas être voulu, sinon ce n’est plus un biais mais une tromperie.Un biais cognitif est un réflexe de pensée faussement logique, inconscient, et systématique. Ancrés au fin fond de notre cerveau...
Oui mais ce n’est plus un biais, puisque, par définition, nous ne savons pas que notre propos est biaisé quand il est biaisé.LoutredeMer a écrit : 14 févr. 2023, 23:15 A partir de là, il peut y avoir réutilisation de ce biais à des fins précises.
Ou contrôle de ce biais.
Ca c'est conscient.
As-tu une source sérieuse? J'ai beau chercher, rien n'est clair là-dessus.richard a écrit : 14 févr. 2023, 23:26Oui mais ce n’est plus un biais, puisque, par définition, nous ne savons pas que notre propos est biaisé quand il est biaisé.LoutredeMer a écrit : 14 févr. 2023, 23:15 A partir de là, il peut y avoir réutilisation de ce biais à des fins précises.
Ou contrôle de ce biais.
Ca c'est conscient.
Oui et non.Oui mais ce n’est plus un biais, puisque, par définition, nous ne savons pas que notre propos est biaisé quand il est biaisé.
Un individu seul n'est rien sans les autres. Il fait nécessairement partie d'un groupe. L'espèce humaine est à considérer comme l'évolution de groupes sociaux où se développent nécessairement coopération, entraide, solidarité.Lorsque vous réalisez un raisonnement exigeant, votre cerveau consomme plus de glucose, vos pupilles se dilatent et votre rythme cardiaque s’accélère très légèrement 4. Cela s’apparente à un effort physique et que ce soit pour courir un sprint ou pour mener une réflexion poussée, l’être humain est partisan du moindre effort.
Lorsque le système 2 se déclenche, il entre en conflit avec le premier système. Pour le vérifier, profitez d’une promenade à plusieurs. Cette marche mécanique est opérée par le système 1. Demandez alors à vos acolytes de calculer 21*76. Il est probable que pour vous répondre, ils se sentent obligés d’arrêter de marcher. **
L'un des derniers articles sur le sujet (février 2023):Oui, c'est un réflexe du cerveau.
Mais à partir du moment où un biais est comportemental, et qu'il se produit, il est observable, en tout cas pour certains biais. Observable par la personne concernée et/ou par d'autres qui pourront lui en faire part. Dans ce cas, il y a prise de conscience.
A partir de là, il peut y avoir réutilisation de ce biais à des fins précises.
Ou contrôle de ce biais.
Ca c'est conscient.
Mais il peut aussi se répéter sans qu'on puisse le contrôler, parce que ce qui le contrôle, c'est la dissonance cognitive.
Ca c'est inconscient.
* La notion de biais cognitifs, qui semble faire consensus dans le milieu de la recherche, permet à des personnes issues de différentes disciplines de travailler ensemble autour d'un projet, avec une définition commune, et de pratiquer l'interdisciplinarité, ce qui est une avancée positive en matière de construction du savoir et de l'élaboration des connaissances....Pour tous ces auteurs, il est clair que ne pas savoir se prémunir contre ses propres biais cognitifs peut avoir des conséquences délétères dans la vie quotidienne mais aussi dans la vie publique et l’exercice d’une profession. Dans notre dernier article, le psychologue suisse met cependant en garde contre le risque de simplifier le sujet. Il distingue au sein de la communauté des psychologues pas moins de six attitudes épistémologiques différentes à l’égard des biais cognitifs.
Nous donnons la parole à son collègue Sebastian Dieguez, qui met aussi en garde contre le risque de trop simplifier : les biais cognitifs recensés relèvent souvent de « registres très divers ». Il souligne l’intérêt de comparer le monde des biais cognitifs avec celui des illusions perceptives...
Extrait...Tous les sous-processus cognitifs peuvent devenir un "biais". Mais quand? Quand nous le jugeons comme tel. La liste est merveilleusement longue, et ce, sans prendre en considération l'interaction entre eux. Selon les biaiseux, la nature même du processus cognitif est d'être "biaisé" et pour cette raison nous en trouvons partout? Ça vaut quoi?
« A la base, une sorte d’égocentrisme naturel ».
On a recensé jusqu’à 288 biais cognitifs. Le plus important d’entre eux n’est-il pas le biais de confirmation ?
Il y a clairement eu, ces dernières années, une inflation du nombre de « biais cognitifs ». Le problème est que nombre de ces phénomènes relèvent de registres très divers : la psychologie humaine est riche en « effets », « illusions », « heuristiques », « erreurs », « excès », « actes manqués », « abus »... Et tout cela porte en plus sur des domaines différents : la prise de décision, la perception, le raisonnement, l’inférence, la mémoire, l’évaluation des probabilités et des risques, le soi, les autres, les valeurs, les émotions... Le résultat est que, pour l’heure, il n’existe pas de théorie très solide qui rende compte de l’ensemble de ces productions. Le biais de confirmation est en effet souvent apparu comme « omniprésent » dans la cognition humaine, et capable de « chapeauter » bon nombre d’autres biais. Mais ce n’est pas étonnant, dans la mesure où il recouvre lui-même un grand nombre de phénomènes distincts (la « cognition motivée », l’« exposition sélective », le « biais de disponibilité », le « biais rétrospectif », le « cherry picking », la « mauvaise foi », la « dissonance cognitive », le « wishful thinking », la « négligence d’hypothèses alternatives », etc.), et qu’il est parfois synonyme de « biais d’auto-complaisance », c’est-à-dire le problème beaucoup plus général qui consiste essentiellement à tout ramener à soi. De fait, on cherche rarement à « confirmer » compulsivement les choses qui nous déplaisent ou ne nous arrangent pas, ce qui suggère que le problème des biais est surtout celui d’une sorte d’égocentrisme naturel, et de l’excès de confiance en soi qui l’accompagne souvent. Difficile donc de savoir s’il existe des biais plus importants ou plus graves que d’autres, cela dépend certainement du contexte et des enjeux propres à chaque situation.
Plusieurs études semblent montrer que les experts ne sont pas moins sujets aux biais cognitifs que les profanes. Qu’en pensez-vous ?
Je trouve très utile de tirer des comparaisons entre biais cognitifs et illusions perceptives. Par exemple, avec ce qu’on appelle couramment les illusions d’optique, on constate la même prolifération (il en existe des centaines), et la même difficulté d’y apporter un ordre théorique. Mais il y a une différence frappante : elles sont fun. Les gens adorent ces illusions qui se partagent à foison sur les réseaux sociaux. Certaines sont spectaculaires : on croit voir du mouvement alors que l’image est statique, on voit deux couleurs distinctes alors que c’est la même, on voit apparaître des points inexistants, etc. Tout le monde admet volontiers « se faire avoir » par ces illusions, et personne ne s’acharne à « lutter » contre elles. C’est d’ailleurs tout leur intérêt : les psychologues disent qu’elles sont « encapsulées » ou « impénétrables », c’est-à-dire que cela ne change rien de savoir que ce sont des illusions. On peut avoir consacré sa vie à les étudier, elles « marchent » toujours. Pourtant, quand il s’agit des biais cognitifs, on souhaiterait en quelque sorte les éradiquer, ou du moins éduquer les gens à les détecter, s’en méfier et les surmonter. Certains s’en croient exempts, d’autres s’indignent du tour qu’on leur a joué, beaucoup se vexent quand on leur dit qu’ils ont été irrationnels dans tel ou tel test. C’est très intéressant, et cela montre à quel point la rationalité est valorisée, en particulier chez les gens dont l’expertise les porte à croire en leur parfaite objectivité.
Dans quelle mesure l’existence de biais cognitifs systématiques traduit-elle les facultés d’adaptation du cerveau humain ?
À nouveau, la comparaison avec les illusions perceptives est instructive. Depuis plus d’un siècle, l’existence de ces illusions a servi de modèle pour notre compréhension du système visuel. Elles prouvent que nous ne voyons pas les choses telles qu’elles « sont », mais que nous anticipons pour ainsi dire ce qu’elles devraient être. Nous voyons du volume, des contours, de la profondeur, des contrastes ou du mouvement là où il n’y en a pas, parce que ces choses sont ordinairement utiles pour nous dans la « vraie vie », et que notre cerveau a donc évolué pour y être particulièrement sensible. L’idée est que les biais cognitifs nous renseigneraient de la même manière sur des processus de plus « haut niveau » que la perception, en particulier sur nos relations sociales, notre image de nous-mêmes, nos raisonnements et nos décisions. D’où le débat, toujours ouvert, pour savoir si ces biais sont adaptatifs ou dysfonctionnels... La réponse dépend probablement du contexte : les biais nous ont sans doute bien servi pendant le plus clair de notre histoire, mais peut-être qu’ils sont devenus aujourd’hui trop faciles à exploiter.
Sebastian Dieguez est chercheur en neurosciences au Laboratoire de sciences cognitives et neurologiques de l’Université de Fribourg.
Salut la loutre! Dans l’article que tu cites il est ditLoutredeMer a écrit : 14 févr. 2023, 23:35 As-tu une source sérieuse? J'ai beau chercher, rien n'est clair là-dessus.
Edit : J'ai trouvé ça mais je ne l'ai pas encore lu.
Amha, si on ne peut pas le contrôler c’est qu’il est inconscient. Si on peut le maîtriser alors le biais disparaît. C’est un raisonnement simple, simpliste diront certains.Le premier système fonctionne en mode automatique, il ne demande aucun effort et on ne peut pas le contrôler.
Le biais de confirmation est peut-être le biais cognitif par excellence. Il consiste à étayer ses idées présupposées en sélectionnant les informations qui viennent les confirmer : c’est une manière simple et naturelle d’éviter les phénomènes de dissonance cognitive.
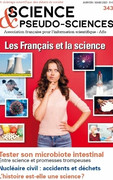
Surtout Dominique!Dominique18 a écrit : 15 févr. 2023, 13:06 Parce que bien sûr, nous savons tous raisonner correctement, sans commettre d'erreurs, de biais.
Ben oui, j'ai une réputation à défendre !richard a écrit : 15 févr. 2023, 13:20Surtout Dominique!Dominique18 a écrit : 15 févr. 2023, 13:06 Parce que bien sûr, nous savons tous raisonner correctement, sans commettre d'erreurs, de biais.

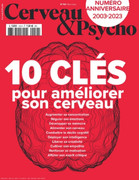
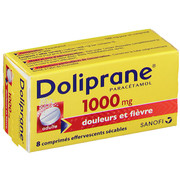

Dans sa liste de biais cognitifs, (ton lien) Daniel Kahneman docteur en psychologie et expert de la psychologie cognitive "confirme" mes propos. Est-ce que je suis biaisé?LoutredeMer a écrit : 14 févr. 2023, 23:35 As-tu une source sérieuse? J'ai beau chercher, rien n'est clair là-dessus.
Edit : J'ai trouvé ça mais je ne l'ai pas encore lu.
juliens a écrit : 12 févr. 2023, 18:19 Tout est responsable dans le processus cognitif. Les sentiments, les sensations, influencent tout autant le processus cognitif...
juliens a écrit : 13 févr. 2023, 17:47 L'amour rend aveugle, nous pourrions parler du "biais de l'amour"...
(Concernant le procédé très intuitif... Nous pouvons aussi ajouter les rêves prémonitoires, la télépathie, la clairvoyance... J'en invente un autre, le biais intuitif. Est-ce que j'ajoute ® ?)L’heuristique d’affect:
L’heuristique d’affect a un fonctionnement qui est proche. Il consiste à prendre une décision en utilisant davantage ses émotions qu’un raisonnement. C’est une façon de procéder très intuitif : le système 1 est aux manettes. Par exemple, nous avons tendance à donner raison aux personnes qu’on aime, même lorsqu’elles ont tort.
https://blog.nalo.fr/daniel-kahneman-bi ... -trompent/
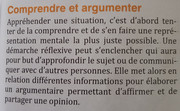
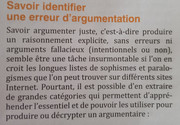
Tous les biais (cad le processus cognitif) peuvent servir, parfois oui, parfois non, parfois entre le deux... Historiquement c'était un biais, plus tard ce ne l'est plus...
Ah bon?juliens a écrit : 15 févr. 2023, 15:46 Tous les biais (cad le processus cognitif) peuvent servir, parfois oui, parfois non, parfois entre le deux... Historiquement c'était un biais, l'autre jour ce ne l'est plus...
https://www.afis.org/Humilite-epistemiq ... e-critique8 juin 2022 Dans le champ de l'éducation à l'esprit critique dans les établissements scolaires, l'humilité intellectuelle s'exerce par des activités mettant en lumière les limites et biais cognitifs des élèves, avec l'utilisation des illusions perceptives notamment. Il est alors primordial de bien évaluer les enjeux de ces activités qui peuvent ébranler la confiance qu'ont les élèves dans leurs propres capacités et dans celles des autorités légitimes en termes de ...

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit