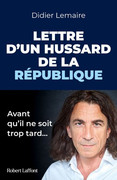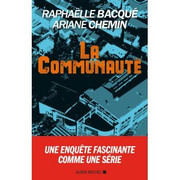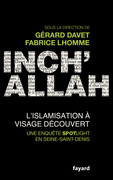@ Uno
Sur le plan historique, en début de ma réponse à EB, les trois références, si tu ne les connais pas, devraient retenir ton attention (deux vidéos et un article).
Une bonne vidéo dont le contenu fait le lien entre différents "dossiers ":
https://m.youtube.com/watch?v=RYrzJsMFx4I
Complément :
https://m.youtube.com/watch?v=E_yqz3qgth8
Éventuellement, un petit couo de woke and roll pour servir de "liant":
https://m.youtube.com/watch?v=NcMteX9wfcg
Edit: information pour tous les lecteurs
Il va y avoir un peu de lecture, mais si on fait l"effort d'essayer de comprendre, la somme de ces articles représente une bonne synthèse *.
Aucune propagande, des faits, rien que des faits, et pas par les polémistes du coin.
Je pourrais produire un résumé des différentes interventions. J'estime en avoir déjà produit une bonne dose, il suffit.
L'inénarrable Sandrine Rousseau, dans un pur numéro woke...
Abaya : quand Sandrine Rousseau réussit à faire passer les journalistes de Quotidien pour des "droitards"
En pleine lucarne
Par Samuel Piquet
Publié le 08/09/2023 à 17:00
Invitée dans l’émission Quotidien mardi 5 septembre, la députée EELV a bravement résisté aux propos nauséabonds des journalistes et a rappelé judicieusement que la politique ne doit jamais tenir compte des électeurs.
Les journalistes de Quotidien, peu connus pour leurs positions extrêmes, se sont inexplicablement mués mardi dernier en dangereux fascistes. Ivres de populisme, ils nous ont même laissés penser pendant un moment qu’on vivait en démocratie et que nos gouvernants allaient finir par s’intéresser à ce que pensaient les citoyens. Pas dupe pour un sou, la Jean Moulin du barbecue a fait front.
Après avoir brillamment expliqué que si la gauche avait perdu les classes populaires, c’était en raison de « l’incompréhension de ce qu’est le RN », elle a été interrogée sur le sondage de l’IFOP pour Charlie Hebdo, selon lequel 69 % des sympathisants ELLV n’ont aucun doute sur le caractère religieux de l’abaya et 79 % approuvent son interdiction – résultats quasiment identiques à la moyenne nationale islamophobe.
LA DÉMOCRATIE SANS LE PEUPLE
Après un « hum » et un silence gêné, la députée répond : « Vous voudriez que je vous dise, là, je vais approuver cette interdiction, non. » « Ben vous semblez déconnectée », rétorque Yann Barthès avant d’ajouter : « ce sont vos sympathisants ». Ne se laissant pas démonter, Sandrine répond fièrement : « Moi je fais une bataille qui est une bataille politique de fond sur les valeurs que nous défendons. » À savoir le virilisme de l’entrecôte et le point médian. Puis de préciser : « Sur l’abaya, on va en parler mais la question c’est derrière : comment l’école est un lieu qui accueille tout le monde avec ses différences ? » Et comment les professeurs doivent être des équipiers Mc Donald’s irréprochables. Elle ajoute que le rôle de l’école est de « permet(tre) à chacun d’avoir une véritable possibilité d’émancipation mais aussi de progression ». L’émancipation par le port d’une tenue religieuse dans le sanctuaire de la laïcité : il fallait y penser. Vivement le régime par le burger et l’introduction à la philosophie par Hanouna.
Jamais avare de démagogie, Quotidien renchérit, par l’intermédiaire du journaliste Julien Bellver : « Mais si vous n’êtes pas en phase avec vos militants, Sandrine Rousseau, y a un problème, non ? ». Réponse de l’intéressée : « Non mais heu, après ça dépend aussi de ce qu’on perçoit comme une bataille politique. On n’est pas là pour aller flatter les opinions qu’ont les gens, je pense qu’on est là pour défendre des valeurs, moi je défends des valeurs. » On jurerait un séminaire LR.
LANGUE DE BOIS NIVEAU EXPERT
« Même si ce n’est pas celle de vos sympathisants ? », interroge Yann Barthès. « Eh ben, si ce n’est pas celle de nos sympathisants, ce n’est pas celle de nos sympathisants », s’emporte Sandrine, bien décidée à égrener, comme elle l’avait prévu, ses éléments de langage sur le service public, l’émancipation des élèves, les bourses, les élèves SDF, les salaires, la pénurie de profs, le tout avec une force de conviction que n’aurait pas reniée Jean-Marc Ayrault et dans une langue de bois frôlant les 7,8 sur l’échelle de Jean-François Copé. « C’est pas le débat, là », s’étonne Jean-Michel Aphatie. « Ça n’est pas un sujet fondamental », réplique l’écoféministe. Le journaliste nuance : « Ce n’est pas fondamental mais c’est un sujet important puisque beaucoup de proviseurs, de conseillers d’éducation depuis des mois disent parfois « on a des problèmes (…) on a besoin que des directives encadrent notre travail », visiblement vos sympathisants comprennent mieux ces pédagogues sur le terrain que vous. »
L'interdiction de l'abaya à l'école...
Interdiction de l’abaya à l’école : « Serions-nous sortis de l’aveuglement ? »
TRIBUNE. Le Conseil d’État a validé l’interdiction de l’abaya à l’école. La réaction de l’ex-secrétaire général du Conseil constitutionnel Jean-Éric Schoettl, également ancien membre du Conseil des sages de la laïcité.
Par Jean-Éric Schoettl
<< La multiplication des abayas procede non d'une tocade juvenile ou d'une simple mode, mais d'une volonte organisee d'entrisme pour investir la place strategique que constitue l'ecole >>, expose Jean-Eric Schoettl.
« La multiplication des abayas procède non d’une tocade juvénile ou d’une simple mode, mais d’une volonté organisée d’entrisme pour investir la place stratégique que constitue l’école », expose Jean-Éric Schoettl.
© VALLAURI Nicolas / MAXPPP / PHOTOPQR/LA PROVENCE/MAXPPP
Publié le 07/09/2023 à 19h33
Ce 7 septembre, le juge des référés-liberté du Conseil d'État a rejeté, comme « ne portant pas d'atteinte grave ou manifestement illégale à une liberté fondamentale », la demande de suspension présentée par l'association Action droits des musulmans à l'encontre de la note de service de Gabriel Attal, publiée au bulletin officiel de l'Éducation nationale du 31 août, relative au port de signes religieux ostentatoires dans les établissements scolaires publics.
Était spécialement visé le passage de cette note de service selon lequel l'article L. 141-5-1 du Code de l'éducation, introduit dans ce code par la loi du 15 mars 2004, prohibe le port de tenues qui, telles que l'abaya et le qamis, manifestent ostensiblement en milieu scolaire une appartenance religieuse.
Ce passage était dénoncé tout à la fois comme discriminatoire, contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant, attentatoire au droit à l'éducation et à la liberté personnelle de l'élève et faisant une application inexacte de la loi du 15 mars 2004. Pour l'association requérante, cette loi ne concernerait que les habits véritablement religieux, ce que ne seraient ni l'abaya ni le qamis.
La clarté de la loi de 2004
Le Conseil d'État avait à se prononcer sur une question de fond assez simple : le ministre avait-il ajouté à la loi ou se bornait-il à l'appliquer sans excéder son domaine de compétences ni commettre d'illégalité ? La seconde réponse s'imposait, eu égard à la clarté de la loi de 2004 (« Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou de tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit ») et à l'évidence des faits.
La loi de 2004 interdit par elle-même le port de tenues qui ont comme objectif de manifester ou de revendiquer une appartenance religieuse, même sans prosélytisme. C'est le cas avec l'abaya, cette ample robe si visible qui nous vient du Moyen-Orient et dont les caractéristiques sont plus conformes encore que le hidjab aux préceptes coraniques. Sans doute le Conseil français du culte musulman (CFCM) affirme-t-il que l'abaya n'est pas un habit religieux. Mais cette position est inopérante pour trois raisons.
D'abord, c'est théologiquement discutable : le verset 59 de la sourate 33 ne recommande-t-il pas au prophète, comme l'explique la philosophe Razika Adnani, de demander aux femmes de ramener sur elles leurs djalabib, pluriel de djilbab, qui désigne une robe longue et ample ? Ensuite, la position du CFCM est paradoxale, car il affirme aussi que l'interdiction de l'abaya est une mesure islamophobe : mais comment la prohibition d'un vêtement non religieux pourrait-elle avoir un caractère antireligieux ? Enfin, et en tout état de cause, une instance religieuse ne saurait décider de l'application de la loi de la République. C'est le b.a.-ba de la séparation des Églises et de l'État.
Un étendard dans l'univers scolaire
La multiplication des abayas procède non d'une tocade juvénile ou d'une simple mode, mais d'une volonté organisée d'entrisme pour investir la place stratégique que constitue l'école. Pour l'élève qui s'y livre, porter l'abaya, c'est proclamer qu'on est une bonne musulmane. C'est s'enfermer dans une armure flottante pour gommer sa féminité et ne pas attirer le regard masculin. La pruderie des bigots du fondamentalisme islamique confine en effet à l'obsession sexuelle.
Pour les activistes qui influencent l'élève sur les réseaux sociaux, l'enjeu est de planter un étendard dans l'univers scolaire. Ces objectifs sont complémentaires : pour la jeune fille sous emprise islamiste, le but est de se soumettre à la loi divine (interprétée de façon maximaliste) ; pour les prédicateurs numériques et nombre de « grands frères », il s'agit de marquer le territoire de l'école et de « tenir » leurs sœurs à distance de la société impie qui les entoure.
Au demeurant, les porteuses d'abayas portent aussi le foulard islamique sur le chemin du collège ou du lycée et ne le retirent qu'à la porte de l'établissement. L'abaya est donc une façon de continuer à proclamer son appartenance religieuse une fois entrée dans l'établissement. C'est un substitut du foulard plus manifeste encore que le bandana (dont le Conseil d'État, par un arrêt du 5 décembre 2007, a admis la contrariété à la loi de 2004 lorsque le contexte révèle que son port a pour objet de contourner la prohibition du foulard islamique).
Un changement d'état d'esprit
Cacher ses cheveux, cacher son corps : la même logique d'occultation et de relégation des femmes a été importée au pays des Lumières, d'Olympe de Gouges et du marivaudage. Ouvrons les yeux : l'abaya a été inventée par les wahhabites pour enrégimenter les femmes et leur faire abjurer charme et séduction. Mais, évidemment, le discours appris par les gamines sur les réseaux sociaux invoquera des motifs plus présentables aux yeux des modernes : l'abaya les protégerait contre le harcèlement sexuel.
Il faut refuser de voir pour nier que le port de l'abaya manifeste une volonté d'affirmation religieuse et de séparatisme confessionnel. Ceux qui en doutent de bonne foi n'ont ni fréquenté la sortie des établissements scolaires des quartiers touchés par le salafisme ni consulté les réseaux sociaux sous influence frériste. Saluons donc le réalisme de l'ordonnance de référés du 7 septembre, qui relève que le port de l'abaya et du qamis s'inscrit dans une logique d'affirmation religieuse, ainsi qu'il ressort notamment des dialogues engagés avec les élèves en application de la loi de 2004.
En reconnaissant l'évidence de ces faits, les propos de Gabriel Attal (comparés au silence embarrassé de son prédécesseur sur les abayas) et l'ordonnance du Conseil d'État du 7 septembre (rapprochée de ses positions récentes sur le burkini dans les piscines municipales et sur le hidjab dans les tournois de football) traduisent peut-être un changement d'état d'esprit de nos responsables publics sur la question de la montée de l'islamisme.
Serions-nous sortis de l'aveuglement dont les milieux bien-pensants avaient fait preuve lors de l'affaire des foulards de Creil il y a trente-quatre ans ? N'avait-on pas entendu le ministre de l'Éducation de l'époque – ou telle ou telle personnalité éminente de son cabinet – exposer qu'il ne fallait pas faire un drame d'un « morceau de tissu », que l'intransigeance aurait des effets contre-productifs (en « braquant » et en « clivant ») et que, d'ailleurs, les foulards disparaîtraient à la prochaine rentrée scolaire ?
Paralysés par la peur de stigmatiser
À la source de tout se trouve une excessive homogénéité culturelle et religieuse dans certains quartiers. Les habitants de ces quartiers sont les premiers à la regretter, telle cette mère de famille d'origine maghrébine déclarant à Emmanuel Macron visitant le collège où était scolarisé son enfant : « Mon fils m'a demandé si le prénom Pierre existait en dehors des livres. » Face à cette situation, l'école aurait dû être résolument intégratrice. Elle n'aurait pas dû transiger avec l'impératif de soustraire l'espace scolaire aux emprises communautaires. Elle aurait dû s'opposer sans état d'âme au prosélytisme.
Or, nous avons été paralysés par la peur de stigmatiser l'autre. Paralysés par notre culpabilité postcoloniale, par notre honte du comportement de la France à l'égard des juifs sous Vichy. Nous avons regardé l'avenir dans le rétroviseur, au risque de verser dans le fossé.
L'analyse de Gilles Kepel...
Interdiction de l’abaya à l’école : « Serions-nous sortis de l’aveuglement ? »
TRIBUNE. Le Conseil d’État a validé l’interdiction de l’abaya à l’école. La réaction de l’ex-secrétaire général du Conseil constitutionnel Jean-Éric Schoettl, également ancien membre du Conseil des sages de la laïcité.
Par Jean-Éric Schoettl
<< La multiplication des abayas procede non d'une tocade juvenile ou d'une simple mode, mais d'une volonte organisee d'entrisme pour investir la place strategique que constitue l'ecole >>, expose Jean-Eric Schoettl.
« La multiplication des abayas procède non d’une tocade juvénile ou d’une simple mode, mais d’une volonté organisée d’entrisme pour investir la place stratégique que constitue l’école », expose Jean-Éric Schoettl.
© VALLAURI Nicolas / MAXPPP / PHOTOPQR/LA PROVENCE/MAXPPP
Publié le 07/09/2023 à 19h33
Temps de lecture : 6 min
Premium Lecture audio réservée aux abonnés
Ce 7 septembre, le juge des référés-liberté du Conseil d'État a rejeté, comme « ne portant pas d'atteinte grave ou manifestement illégale à une liberté fondamentale », la demande de suspension présentée par l'association Action droits des musulmans à l'encontre de la note de service de Gabriel Attal, publiée au bulletin officiel de l'Éducation nationale du 31 août, relative au port de signes religieux ostentatoires dans les établissements scolaires publics.
Était spécialement visé le passage de cette note de service selon lequel l'article L. 141-5-1 du Code de l'éducation, introduit dans ce code par la loi du 15 mars 2004, prohibe le port de tenues qui, telles que l'abaya et le qamis, manifestent ostensiblement en milieu scolaire une appartenance religieuse.
Ce passage était dénoncé tout à la fois comme discriminatoire, contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant, attentatoire au droit à l'éducation et à la liberté personnelle de l'élève et faisant une application inexacte de la loi du 15 mars 2004. Pour l'association requérante, cette loi ne concernerait que les habits véritablement religieux, ce que ne seraient ni l'abaya ni le qamis.
La clarté de la loi de 2004
Le Conseil d'État avait à se prononcer sur une question de fond assez simple : le ministre avait-il ajouté à la loi ou se bornait-il à l'appliquer sans excéder son domaine de compétences ni commettre d'illégalité ? La seconde réponse s'imposait, eu égard à la clarté de la loi de 2004 (« Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou de tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit ») et à l'évidence des faits.
À LIRE AUSSIL'abaya qui cache la forêt
La loi de 2004 interdit par elle-même le port de tenues qui ont comme objectif de manifester ou de revendiquer une appartenance religieuse, même sans prosélytisme. C'est le cas avec l'abaya, cette ample robe si visible qui nous vient du Moyen-Orient et dont les caractéristiques sont plus conformes encore que le hidjab aux préceptes coraniques. Sans doute le Conseil français du culte musulman (CFCM) affirme-t-il que l'abaya n'est pas un habit religieux. Mais cette position est inopérante pour trois raisons.
D'abord, c'est théologiquement discutable : le verset 59 de la sourate 33 ne recommande-t-il pas au prophète, comme l'explique la philosophe Razika Adnani, de demander aux femmes de ramener sur elles leurs djalabib, pluriel de djilbab, qui désigne une robe longue et ample ? Ensuite, la position du CFCM est paradoxale, car il affirme aussi que l'interdiction de l'abaya est une mesure islamophobe : mais comment la prohibition d'un vêtement non religieux pourrait-elle avoir un caractère antireligieux ? Enfin, et en tout état de cause, une instance religieuse ne saurait décider de l'application de la loi de la République. C'est le b.a.-ba de la séparation des Églises et de l'État.
Un étendard dans l'univers scolaire
La multiplication des abayas procède non d'une tocade juvénile ou d'une simple mode, mais d'une volonté organisée d'entrisme pour investir la place stratégique que constitue l'école. Pour l'élève qui s'y livre, porter l'abaya, c'est proclamer qu'on est une bonne musulmane. C'est s'enfermer dans une armure flottante pour gommer sa féminité et ne pas attirer le regard masculin. La pruderie des bigots du fondamentalisme islamique confine en effet à l'obsession sexuelle.
Pour les activistes qui influencent l'élève sur les réseaux sociaux, l'enjeu est de planter un étendard dans l'univers scolaire. Ces objectifs sont complémentaires : pour la jeune fille sous emprise islamiste, le but est de se soumettre à la loi divine (interprétée de façon maximaliste) ; pour les prédicateurs numériques et nombre de « grands frères », il s'agit de marquer le territoire de l'école et de « tenir » leurs sœurs à distance de la société impie qui les entoure.
À LIRE AUSSIGilles Kepel : « La mouvance islamiste fait feu de tout bois »
Au demeurant, les porteuses d'abayas portent aussi le foulard islamique sur le chemin du collège ou du lycée et ne le retirent qu'à la porte de l'établissement. L'abaya est donc une façon de continuer à proclamer son appartenance religieuse une fois entrée dans l'établissement. C'est un substitut du foulard plus manifeste encore que le bandana (dont le Conseil d'État, par un arrêt du 5 décembre 2007, a admis la contrariété à la loi de 2004 lorsque le contexte révèle que son port a pour objet de contourner la prohibition du foulard islamique).
Un changement d'état d'esprit
Cacher ses cheveux, cacher son corps : la même logique d'occultation et de relégation des femmes a été importée au pays des Lumières, d'Olympe de Gouges et du marivaudage. Ouvrons les yeux : l'abaya a été inventée par les wahhabites pour enrégimenter les femmes et leur faire abjurer charme et séduction. Mais, évidemment, le discours appris par les gamines sur les réseaux sociaux invoquera des motifs plus présentables aux yeux des modernes : l'abaya les protégerait contre le harcèlement sexuel.
Il faut refuser de voir pour nier que le port de l'abaya manifeste une volonté d'affirmation religieuse et de séparatisme confessionnel. Ceux qui en doutent de bonne foi n'ont ni fréquenté la sortie des établissements scolaires des quartiers touchés par le salafisme ni consulté les réseaux sociaux sous influence frériste. Saluons donc le réalisme de l'ordonnance de référés du 7 septembre, qui relève que le port de l'abaya et du qamis s'inscrit dans une logique d'affirmation religieuse, ainsi qu'il ressort notamment des dialogues engagés avec les élèves en application de la loi de 2004.
À LIRE AUSSIAbaya : « L'école est une cible de choix des fondamentalistes »
En reconnaissant l'évidence de ces faits, les propos de Gabriel Attal (comparés au silence embarrassé de son prédécesseur sur les abayas) et l'ordonnance du Conseil d'État du 7 septembre (rapprochée de ses positions récentes sur le burkini dans les piscines municipales et sur le hidjab dans les tournois de football) traduisent peut-être un changement d'état d'esprit de nos responsables publics sur la question de la montée de l'islamisme.
Serions-nous sortis de l'aveuglement dont les milieux bien-pensants avaient fait preuve lors de l'affaire des foulards de Creil il y a trente-quatre ans ? N'avait-on pas entendu le ministre de l'Éducation de l'époque – ou telle ou telle personnalité éminente de son cabinet – exposer qu'il ne fallait pas faire un drame d'un « morceau de tissu », que l'intransigeance aurait des effets contre-productifs (en « braquant » et en « clivant ») et que, d'ailleurs, les foulards disparaîtraient à la prochaine rentrée scolaire ?
Paralysés par la peur de stigmatiser
À la source de tout se trouve une excessive homogénéité culturelle et religieuse dans certains quartiers. Les habitants de ces quartiers sont les premiers à la regretter, telle cette mère de famille d'origine maghrébine déclarant à Emmanuel Macron visitant le collège où était scolarisé son enfant : « Mon fils m'a demandé si le prénom Pierre existait en dehors des livres. » Face à cette situation, l'école aurait dû être résolument intégratrice. Elle n'aurait pas dû transiger avec l'impératif de soustraire l'espace scolaire aux emprises communautaires. Elle aurait dû s'opposer sans état d'âme au prosélytisme.
À LIRE AUSSIBernard Rougier : « L'abaya est présentée par les prédicateurs comme un antidote à la mécréance »
Or, nous avons été paralysés par la peur de stigmatiser l'autre. Paralysés par notre culpabilité postcoloniale, par notre honte du comportement de la France à l'égard des juifs sous Vichy. Nous avons regardé l'avenir dans le rétroviseur, au risque de verser dans le fossé.
Celle de Bernard Rougier...
Bernard Rougier : « L’abaya est présentée par les prédicateurs comme un antidote à la mécréance »
ENTRETIEN. L’universitaire, spécialiste du djihad et du salafisme, revient pour « Le Point » sur l’interdiction du vêtement à connotation religieuse à l’école.
Propos recueillis par Alice Pairo-Vasseur
Pour l'universitaire Bernard Rougier, l'interdiction de l'abaya a l'ecole est << une bonne decision >>.
© Gilles Bader / MAXPPP / PHOTOPQR/LA PROVENCE/MAXPPPGilles Bader
Publié le 31/08/2023 à 17h30
« J'ai décidé qu'on ne pourrait plus porter l'abaya à l'école », tranchait le ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, ce dimanche 27 août. À une semaine de la rentrée scolaire et face à la multiplication des atteintes à la laïcité, parmi lesquelles le port de ce vêtement à connotation religieuse, le nouveau locataire de la Rue de Grenelle annonçait une interdiction, jugée « nécessaire et juste ».
Bernard Rougier, professeur à la Sorbonne Nouvelle, directeur du Centre des études arabes et orientales (CEAO) et auteur de l'enquête remarquée Les Territoires conquis de l'islamisme (PUF, 2019), développe auprès du Point le dessein politique de ses promoteurs, la propagande à l'œuvre et ce que l'ouverture de cette nouvelle séquence pourrait produire.
« Avec l'abaya, expose-t-il, les islamistes s'offrent à nouveaux frais l'occasion de faire campagne sur la prétendue islamophobie française. Avec pour but d'entraver l'intégration des jeunes musulmans à la République et d'œuvrer au séparatisme. »
Le Point : Comment avez-vous accueilli l'interdiction de l'abaya annoncée par Gabriel Attal ?
Bernard Rougier, professeur à la Sorbonne Nouvelle et directeur du Centre des études arabes et orientales.
Bernard Rougier : Il a pris la bonne décision. L'abaya possède incontestablement une dimension religieuse pour les jeunes filles qui la portent et ceux qui les y encouragent. Ce signe ostentatoire n'a pas lieu d'être dans l'école républicaine. L'école, comme extension de l'État, est le lieu de l'émancipation propre au projet républicain. Les islamistes l'ont bien compris et frappent au cœur, où ça fait mal. L'institution s'est d'ailleurs retrouvée fragilisée par cette offensive. Réaffirmer la loi de 2004 sur l'interdiction du port de signes religieux à l'école est donc indispensable si l'on veut la préserver des influences extérieures et de la propagande religieuse.
À LIRE AUSSIL'abaya privée d'école : la fin de l'ambiguïté
Comment opère cette dernière ?
D'abord sur les réseaux sociaux, où des prédicateurs, s'appuyant sur la tradition religieuse la plus radicale, développent de nouvelles normes pour obtenir obéissance et conformité. Des centaines de prédicateurs et autres « étudiants en sciences religieuses » y dispensent des cours en ligne, principalement sur Telegram. Ils sont en France, au Maghreb, au Moyen-Orient, ils parlent français, arabe, sont traduits. Et témoignent de la forte influence des religieux de statut au sein de la mouvance islamiste.
L’un des prédicateurs en ligne les plus populaires explique que la société française est plongée dans la “jahiliyya” (l’ignorance préislamique) et que les jeunes femmes doivent porter des vêtements religieux, comme l’abaya.
Ils jouent sur les peurs et font du chantage en s'appropriant la parole divine : la croyante qui n'aura pas porté tel habit ou le croyant qui aura oublié ses cinq prières devra en rendre compte devant Dieu le jour du Jugement. Pour s'éviter les affres de l'enfer, il lui faut obéir dès maintenant. Très suivis, ces prédicateurs sont ensuite repris par les plus jeunes sur TikTok ou X (anciennement Twitter), qui incitent à leur tour à contourner la loi de 2004 et diffusent des tutos et vidéos suivant leurs principes, auprès des sphères adolescentes.
Quelle part occupe le thème de l'abaya dans cette propagande ?
Présenté comme un antidote à la mécréance, ce vêtement s'inscrit dans un discours global. L'un des prédicateurs en ligne les plus populaires, imam dans une mosquée de la banlieue parisienne, explique par exemple que la société française est plongée dans la jahiliyya (l'ignorance préislamique) et que les jeunes femmes doivent porter des vêtements religieux, comme l'abaya, pour afficher leur pudeur et ne pas s'exposer au mal en fréquentant des chrétiens ou des juifs, porteurs de mécréance.
À LIRE AUSSIAbaya : haute couture et coutures grossières
Quel est le but poursuivi ?
La thématique de l'abaya offre aux islamistes l'occasion de prendre l'ascendant sur les autres courants et de s'affirmer comme les défenseurs de l'islam à travers la défense de la pudeur féminine. Au nom de la liberté individuelle – qu'ils méprisent en réalité, en voulant contrôler le corps des femmes –, ils s'offrent à nouveaux frais l'occasion de faire campagne sur la prétendue islamophobie française. Avec pour but d'entraver l'intégration des jeunes musulmans à la République et d'œuvrer au séparatisme. Un organe communautaire comme le Conseil français du culte musulman - déjà mal en point - s'est lui-même retrouvé contraint d'endosser une position favorable et de se soumettre à la pression des prédicateurs et de leurs relais.
Mais la thématique de l'abaya est aussi l'illustration d'une capacité à créer de nouveaux enjeux, en se réclamant d'un régime d'exception sociétal pour affaiblir la République. L'islamisme, entendu comme transformation de la religion en instrument de pouvoir et capacité à susciter la honte chez les musulmans, prend la forme d'un mouvement social en multipliant ce genre de mobilisations symboliques.
À LIRE AUSSIAbaya : « L'école est une cible de choix des fondamentalistes »
C'est-à-dire ?
Pour exister en tant que mouvement social, l'islamisme doit disposer d'un réseau interne suffisamment structuré (mosquées et associations) afin de mobiliser, outre ses partisans, des musulmans de bonne foi convaincus par sa propagande. Ensuite, il doit être en mesure de formuler une revendication religieuse en désignant un ennemi : l'État français et sa vision jugée rigoriste de la laïcité. Enfin, il doit bénéficier d'une opportunité politique, soit la possibilité de s'appuyer sur des responsables politiques (ici LFI) pour gagner en légitimité dans l'espace public - on remarque d'ailleurs que la revendication sur l'abaya est apparue après la manifestation du 10 novembre 2019 contre l'islamophobie, qui a scellé cette alliance. Tout repose sur la dialectique entre structures communautaires internes, théologie cognitive et opportunités politiques nouvelles. Ces trois conditions étant réunies, elles permettent à l'islamisme de s'affirmer comme mouvement social, avec toutes les conséquences que cela comporte pour l'avenir.
L’abaya donnera encore matière à différents incidents, au besoin surjoués, aussitôt transformés en scandales et mis en ligne sur les réseaux sociaux, dans le cadre d’une victimisation très prisée par les islamistes.
Quelles sont-elles ?
On joue, ici, une forme de troisième manche : l'affaire du voile au collège de Creil en 1989 avait été (provisoirement) réglée par l'intervention du roi Hassan II, celle de l'opposition à la loi de 2004 contrariée par la circonstance irakienne, mais aujourd'hui, on ne voit pas qui ni quoi pourrait contraindre le nouveau défi lancé à l'école. Or tout mouvement social s'accompagnant d'un risque d'expression violente sur ses marges, l'abaya donnera encore, très certainement, matière à incidents. Au besoin surjoués, aussitôt transformés en scandales et mis en ligne sur les réseaux sociaux, dans le cadre d'une victimisation très prisée par les islamistes.
Le risque de cette séquence est qu'elle favorise de nouvelles formes d'engagement militant et facilite la diffusion d'un cadre d'injustice fondé sur une forme de séparatisme, d'abord avec l'institution scolaire et peut-être, au-delà, avec l'État républicain. Plus la communauté est en tension par rapport à la société globale, plus des groupements radicaux ont des chances de se former. Dans les parcours de ceux qui sont passés au djihadisme, on trouve beaucoup de jeunes qui s'étaient opposés à la loi de 2004, usant de l'argument selon lequel la France, islamophobe par nature, était l'ennemie de l'Islam.
À LIRE AUSSIComment « guérir » de l'abaya ?
Pouvions-nous rester sans rien faire ?
Non. Ne rien faire, c'était courir le risque de laisser le phénomène se développer et accepter une forme de prosélytisme culpabilisateur vis-à-vis des jeunes filles musulmanes désireuses de ne pas endosser l'uniforme dessiné à leur intention. On ne pouvait faire autrement que réactualiser la loi de 2004 et affirmer nos principes républicains. Mais on doit s'attendre à une mobilisation des groupes salafistes et fréristes contre cette décision, déjà condamnée par AJ + [la chaîne francophone d'Al-Jazira] et par une campagne internationale relayée par les milieux « woke », déjà hostiles au modèle français.
Les semaines à venir vont être difficiles pour une partie du personnel éducatif, particulièrement les CPE [conseillers principaux d'éducation], souvent en première ligne face aux jeunes filles qui arborent l'abaya. Ils ne devront montrer aucune faiblesse de négociation, car chacune d'entre elles sera exploitée. Jusqu'au prochain enjeu religieux… Leurs capacités d'invention étant infinies, les prédicateurs, comme ils exploiteront les crises internationales (Palestine, Sahel…), inventeront, demain, d'autres formes de tabous et d'interdictions, à leur avantage.
Celle de Pierre-Henri Tavoillot...
Abaya : « L’école est une cible de choix des fondamentalistes »
ENTRETIEN. Le philosophe Pierre-Henri Tavoillot revient pour « Le Point » sur l’interdiction du port de l’abaya annoncée par Gabriel Attal.
Propos recueillis par Alice Pairo-Vasseur
Publié le 30/08/2023 à 07h30
« J'ai décidé qu'on ne pourrait plus porter l'abaya à l'école », a tranché le ministre de l'Éducation Gabriel Attal, ce dimanche 27 août. À une semaine de la rentrée scolaire et face à la multiplication des atteintes à la laïcité, parmi lesquelles le port de ce vêtement à connotation religieuse, le nouveau locataire de la rue de Grenelle a annoncé une interdiction, jugée « nécessaire et juste ».
Une décision dans la droite ligne de la loi de 2004, relative aux signes ostensibles religieux à l'école, rappelle Pierre-Henri Tavoillot, professeur de philosophie politique à la Sorbonne et responsable d'un diplôme « Référents laïcité » destiné aux institutions et aux entreprises. Une « urgence », fait-il aussi valoir. Car « les fondamentalistes, qui savent que l'on y construit ses repères et son individualité, font de l'école un lieu de conquête ».
Le Point : Comment avez-vous accueilli l'annonce de Gabriel Attal ?
Pierre-Henri Tavoillot
Pierre-Henri Tavoillot : Il était devenu urgent de clarifier les choses et sa décision d'interdire l'abaya – dans la droite ligne du texte de loi de 2004 – a le mérite de la clarté. L'institution montre qu'elle a non seulement pris conscience des difficultés que cette tenue pose à l'école, mais aussi qu'elle les assume et ne laisse plus les corps intermédiaires (chefs d'établissement, professeurs, recteurs…), parfois en grande difficulté, le faire seuls. Dans certains établissements, l'abaya – dont la connotation religieuse est une évidence absolue – tend à devenir une tenue quasi majoritaire. Ceux qui réagissent de manière effarouchée à l'annonce de son interdiction ne connaissent pas la nature de cette réalité. Les mots de Gabriel Attal tenus à cet égard sont très justes : la République est « testée ». Et l'école est une cible de choix des fondamentalistes…
À LIRE AUSSIGabriel Attal et l'abaya : bravo, l'artiste !
Pourquoi l'est-elle ?
Parce qu'elle est le lieu du savoir. Or, en entravant la possibilité des fondamentalistes de façonner les esprits, elle menace le communautarisme qu'ils appellent de leurs vœux. En ses murs, l'école permet de s'extraire de sa communauté ethnique et/ou religieuse, de ne pas se définir à travers elle. C'est toute la grandeur de cette respiration républicaine et laïque. L'école, ce n'est pas « Venez comme vous êtes ! » De la même manière, on en sort différent – élevé – de lorsqu'on y est entré. En cela, elle est devenue un lieu de guerre culturelle.
Les fondamentalistes, qui savent que l'on construit ses repères et son individualité à l'âge où l'on est scolarisé, en font ainsi un lieu de conquête. L'école permet de grandir et de s'affirmer, quand le fondamentalisme fige, au contraire, dans une identité. La religion y est d'ailleurs souvent défendue au nom de l'hyperindividualisme : « C'est mon choix », font valoir les élèves portant l'abaya. Or, il ne faut pas gratter bien longtemps pour découvrir, sous ce vernis, le fond communautariste à l'œuvre. D'autant qu'on connaît désormais les éléments de langage de ces dernières…
Les fondamentalistes utilisent la liberté qui nous est si chère, pour la retourner contre nous.
Dont celui de l'abaya portée comme un « vêtement traditionnel »…
Absolument. Les jeunes filles qui l'arborent cultivent cette ambiguïté. Si certaines peuvent manquer de cohérence – elles évoquent une « pudeur » qui a tout à voir avec la religion musulmane –, elles tiennent majoritairement des discours très rodés à leurs chefs d'établissement. Elles usent d'ailleurs toutes des mêmes éléments de langage. Je dis bien « toutes », car on retrouve les mêmes arguments dans les académies du nord, du sud, de l'ouest et de l'est de notre pays… Et pour cause, c'est principalement sur les réseaux sociaux – TikTok en tête – que l'accompagnement est à l'œuvre. Et l'on y retrouve tous les ressorts stratégiques du frérisme.
À LIRE AUSSIAbaya : haute couture et coutures grossières
Quels sont-ils ?
Il y a l'entrisme d'abord (la diffusion de la religion dans l'espace public, doublée d'une pression exercée sur ceux qui n'y contribuent pas), l'orthopraxie (la manifestation ostensible de son identité) et enfin, la dénonciation de l'islamophobie (le fait de se poser comme victime, de sorte que toute critique est un acte de discrimination). C'est un cocktail particulièrement efficace !
D'autant plus efficace que les fondamentalistes jouent sur nos faiblesses, ou ce qui apparaît comme telles. Ils utilisent la liberté qui nous est si chère, pour la retourner contre nous. Et, in fine, la réduire à néant. C'est pourquoi les jeunes filles sont réceptives à ces discours et ne voient, bien souvent, « pas le mal ». Les élèves qui portent l'abaya en appellent d'ailleurs, souvent, à la « liberté » et à la « tolérance ». Quant à ceux qui, dans la classe politique, dénoncent son interdiction, ils n'identifient pas – ou ne veulent pas identifier – cette stratégie. Ce faisant, ils reprennent le discours des fondamentalistes. Que ce soit par mauvaise foi ou par mauvaise conscience, leur réaction menace, elle aussi, notre commun républicain.
L’absence d’une réponse forte et apportée à temps a incontestablement joué contre nous.
Comment en est-on arrivé là ?
C'est un mouvement de fond… Et si la stratégie est particulièrement offensive, nous avons aussi notre part de responsabilité. L'absence d'une réponse forte et apportée à temps a incontestablement joué contre nous. Rappelons que le phénomène est apparu il y a plus d'un an dans nos écoles… C'était pourtant simple : au fond, Gabriel Attal n'a fait que rappeler la loi. À savoir que les signes ostensibles témoignant d'une appartenance religieuse étaient interdits dans l'école de la République. Il n'y a pas d'ambiguïté. Si ces conditions ne sont pas acceptées, alors d'autres écoles – des établissements privés – existent. Finalement, la liberté n'est même pas mise en péril !
À LIRE AUSSILaïcité : « L'école ne doit pas avoir peur de dénoncer »
Beaucoup interrogent, depuis l'annonce du ministre, la question de l'applicabilité de cette interdiction…
Cet aspect ne doit pas nous inquiéter. Nombreux étaient ceux à poser cette même question en 2004, lors de l'interdiction du port du voile. Et à demander – comme on le fait aujourd'hui avec les robes longues - si on allait pouvoir le distinguer d'un bandana… Il s'avère que le texte de loi, ferme et précis, s'est révélé d'une redoutable efficacité. Je le répète, on ne grattera pas bien longtemps avant de voir, derrière les discours de tolérance et d'hyperindividualisme, poindre l'appartenance religieuse.
Le lien entre 1989 (Lionel Jospin) et 2023: Iannis Roder...
Interdiction de l’abaya à l’école : merci Monsieur Jospin…
TRIBUNE. Tiède en 1989, ferme en 2023, l’ancien Premier ministre s’est déclaré favorable à cette mesure. Iannis Roder revient sur ces quelques mots qui changent tout.
Iannis Roder*
Publié le 06/09/2023 à 07h30
Il est des voix qui retiennent l'attention. Vendredi 1er septembre, c'est celle de Lionel Jospin que tout un chacun a pu reconnaître sur l'antenne de France Inter. L'ancien Premier ministre, à la parole rare, s'est exprimé sur l'Ukraine, les retraites… et le port de l'abaya. Lionel Jospin n'était-il pas celui qui, ministre de l'Éducation du gouvernement de Michel Rocard, avait dû affronter, en septembre-octobre 1989, la fameuse « affaire de Creil » ?
S'exprimant publiquement, il avait à l'époque expliqué, tout en subtilité, qu'« on ne doit pas arborer de signes religieux à l'école ». Toutefois, il précisait que « si, aux termes des discussions, des familles n'acceptent toujours pas de renoncer à tout signe religieux, l'enfant – dont la scolarité est prioritaire – doit être accueilli dans l'établissement public […]. L'école française est faite pour éduquer, pour intégrer, pas pour rejeter ». Résolument optimiste et confiant dans l'école de la République, Lionel Jospin estimait alors que celle-ci saurait faire entendre raison aux jeunes filles, lesquelles finiraient par enlever leur voile…
À LIRE AUSSIGhaleb Bencheikh : « Sur l'affaire des foulards de Creil, la République a manqué d'autorité »
Le principal du collège de Creil, déçu, et qui avait largement dialogué avec les élèves concernées, constatait alors que « ceux face à qui nous avons fait la démonstration qu'il est très difficile de dialoguer triomphent aujourd'hui ». Le journal L'Humanité présentait d'ailleurs ce « triomphe » comme « une défaite aux oreilles de tous ceux qui à gauche, et bien au-delà, ont la laïcité au cœur ». De fait, le chef d'établissement se sentit abandonné en rase campagne.
Une évolution bienvenue
Abandonnés, les personnels de direction le furent d'autant plus après l'arrêt du Conseil d'État du 27 novembre 1989 qui laissait à leur seule appréciation l'interdiction éventuelle du port du voile à l'intérieur d'un établissement scolaire. Tout le monde se souvient qu'il avait fallu la loi du 15 mars 2004 interdisant le port de signe ou de vêtement manifestant ostensiblement une appartenance religieuse pour finalement apaiser la situation dans les écoles.
À LIRE AUSSIL'abaya est-elle une tenue religieuse ? Les enjeux d'un faux débat
Comme d'autres, Lionel Jospin a évolué, à l'instar de Marie-George Buffet qui n'avait pas voté la loi de 2004 mais reconnaît aujourd'hui qu'elle avait « une démarche de compassion » qui revenait à ne pas réellement considérer les jeunes issus de l'immigration comme « des citoyens et des citoyennes ». L'ancien Premier ministre met aujourd'hui en avant le contexte qui n'est plus le même qu'en 1989, citant ainsi « l'islamisme violent, l'islamisme terroriste » ou encore « un prosélytisme islamiste ».
À LIRE AUSSIAffaire de Creil : « À l'époque, Philippe de Villiers soutenait les filles voilées »
On peut évidemment reprocher à Lionel Jospin sa tiédeur en 1989 quand d'autres ministres socialistes tels Jean Poperen et Jean-Pierre Chevènement, ou encore la députée Yvette Roudy, s'étaient immédiatement prononcés pour une ligne claire d'interdiction, au nom de la laïcité, mais aussi au nom de l'égalité femmes-hommes.
On peut se dire que celui qui deviendrait Premier ministre en 1997 n'avait pas pris la mesure de l'avancée de l'islam politique malgré la révolution iranienne, la fatwa visant Salman Rushdie et le pourrissement progressif de la situation en Algérie, qui allait mener à la décennie noire de la guerre civile. Mais Lionel Jospin a évolué et c'est cela l'important, car sa prise de position claire et franche témoigne de sa lucidité et d'une prise en compte des réalités.
À LIRE AUSSIEXCLUSIF – Les confidences de Salman Rushdie
Besoin de sérénité
Il nous le dit : l'abaya est un outil au service de l'islam politique. Ce dernier tente de fracturer la société, notamment en exerçant un contrôle sur une partie de la jeunesse française, et d'abord sur les jeunes femmes. Si nous voulons que l'école de la République continue d'offrir à tous les enfants de France cet espace de liberté, de respiration, qui leur permet de se dégager des déterminismes, celle-ci a besoin de sérénité. Elle doit donc pouvoir, sans pression exercée par la présence d'élèves affichant leur appartenance religieuse, offrir la possibilité de l'émancipation et de l'accession à l'autonomie par la construction d'une pensée individuelle.
À LIRE AUSSIRentrée scolaire : à Créteil, des tenues amples comme subterfuge à l'abaya
Alors merci Monsieur Jospin pour cette parole importante, pragmatique et responsable car l'école et ses personnels ne doivent ni ne peuvent accepter l'idée que l'invisibilisation du corps des femmes et la soumission de ces dernières à des prescriptions religieuses seraient des gestes anodins, voire progressistes.
*Iannis Roder, professeur d'histoire-géographie, directeur de l'Observatoire de l'éducation de la Fondation Jean-Jaurès.
* dans le cas contraire, il vaut mieux, effectivement, retourner dans son bac à sable