Luc Montagnier de retour, que penser...
Re: Luc Montagnier de retour, que penser...
Le fait qu'il n'était pas très contagieux, ni très dangereux à ses débuts me fait pencher pour une évolution naturelle.
Русский военный корабль, иди нахуй ! 

- Dominique18
- Messages : 10551
- Inscription : 06 oct. 2020, 12:27
Re: Luc Montagnier de retour, que penser...
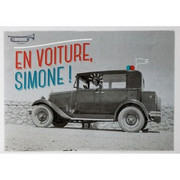
Coronavirus : faut-il vraiment craindre le mutant britannique ?
ANALYSE. Le nouveau variant a semé la panique en Europe. Or, les données sur sa contagiosité et sa dangerosité ne sont pas forcément si inquiétantes. Par Gwendoline Dos Santos, Caroline Tourbe
Modifié le 22/12/2020 à 13:12 - Publié le 22/12/2020 à 09:51 | Le Point.fr
La décision, prise en catastrophe ce week-end, du reconfinement de Londres et du sud-est de l'Angleterre se justifie selon le Premier ministre britannique, Boris Johnson, par la propagation « hors de contrôle » d'un nouveau variant du coronavirus qui serait jusqu'à « 70 % plus contagieux » que les autres. Rapidement, la panique a gagné une bonne partie de l'Europe avec la multiplication des fermetures temporaires de frontières au nez des voyageurs en provenance du Royaume-Uni. Ce que l'on sait sur cette nouvelle variante en six questions.
Pourquoi le nouveau variant a-t-il gagné aussi rapidement du terrain ?
D'après le conseiller scientifique du gouvernement britannique, Patrick Vallance, cette nouvelle variante du Sars-CoV-2 est apparue mi-septembre à Londres ou dans la région du Kent, dans le sud-est du pays. Elle serait aujourd'hui la plus fréquente dans ces régions. « Mais, pour l'instant, il n'y a pas de preuve absolue que ce nouveau variant est associé à une plus grande transmission », souligne d'emblée le Pr François Balloux, directeur de l'Institut de génétique de l'University College de Londres et grand spécialiste des séquences du nouveau coronavirus. Et le scientifique de préciser que « la seule chose que l'on puisse dire, c'est que sa fréquence a augmenté dernièrement ». Trois hypothèses permettent d'expliquer cette propension à gagner du terrain dans la population.
La première n'a rien à voir avec la génétique. « Le variant aurait simplement eu de la chance en se retrouvant, au bon moment au bon endroit », explique encore François Balloux. Ce pourrait être, par exemple, lors d'un rassemblement dans lequel des super-contaminateurs auraient permis une diffusion à large échelle. La deuxième hypothèse suppose que ce variant possède, intrinsèquement, des avantages génétiques qui lui permettent d'infecter plus facilement les cellules humaines (voir ci-dessous). La dernière des trois hypothèses suppose que le virus aurait la capacité d'échapper en partie à notre système immunitaire et pourrait non seulement infecter les personnes qui n'ont jamais été touchées par le Covid-19, mais aussi celles qui en ont déjà été victimes une première fois. Autrement dit, ce variant n'aurait que faire – ou presque – de l'immunité acquise par la population et gagnerait d'autant plus facilement du terrain dans les régions très touchées lors des premières vagues. Ce qui est précisément le cas d'une ville comme Londres. Sachant que ces trois hypothèses ne s'excluent pas les unes les autres.
Quelles sont les mutations qui inquiètent le plus les scientifiques ?
Le chiffre d'une contagiosité augmentée de 70 %, avancée par Boris Johnson, n'est pas le fruit d'une observation menée dans la population mais de modélisations mathématiques basées sur l'augmentation des cas dans la capitale ces derniers jours et la fréquence du nouveau variant dans la population. Pas de preuve directe, donc. Néanmoins, l'inquiétude sur la transmission facilitée de ce coronavirus repose sur des indices génétiques sérieux. « Depuis le début, on observe des variants de Sars-CoV-2 qui dérivent lentement par rapport aux premiers génomes séquencés en janvier en Chine. Ce nouveau variant B117 est atypique, car on observe un saut dans le nombre des mutations », souligne Bruno Canard, directeur du laboratoire Architecture et fonction des macromolécules biologiques (CNRS, Marseille), dont l'équipe travaille sur les virus émergents. Jusqu'à présent, le Sars-CoV-2 a accumulé des mutations à un rythme d'environ deux changements par mois. De nombreux variants ont ainsi dérivé, petit à petit, pour atteindre un peu plus de 20 mutations d'écart avec les premiers virus séquencés. À lui tout seul, le variant qui fait si peur aux Britanniques a accumulé 17 mutations. Plus encore que le nombre des mutations, ce qui inquiète les spécialistes, c'est la localisation de huit d'entre elles. Ces dernières se situent en effet sur le gène qui code pour la protéine « spike » du virus, connue pour être sa clé d'entrée dans nos cellules en se liant à des serrures présentes à leur surface, les récepteurs ACE2.
Deux mutations possiblement en lien avec la contagiosité concentrent tout particulièrement l'attention des chercheurs. Baptisées P681H et N501Y, elles pourraient provoquer une plus grande affinité du virus pour nos cellules. « C'est un peu comme si la clé du virus trouvait plus facilement la serrure, grâce à la première mutation, et qu'ensuite cette clé tournait mieux, grâce à la deuxième mutation », résume Bruno Canard.
Et ce n'est pas tout, car une fois la porte ouverte, « une autre modification, nommée 69-70del, serait, elle, impliquée dans une évasion immunitaire », poursuit Bruno Canard. La protéine « spike » du virus est un peu modifiée au point d'être un peu moins bien reconnue par le système immunitaire. Notre système de défense peut toujours faire son travail, mais potentiellement, un peu moins efficacement.
Le nouveau variant est-il plus dangereux ?
Les premières indications sur la mortalité liées à ce nouveau variant ont d'abord paru très inquiétantes. La faute en revient à des données très incomplètes et concentrées sur des populations touchées par des formes les plus graves du Covid-19. « Depuis, les estimations de la mortalité ont été revues à la baisse et se rapprochent de ce que l'on constate avec les autres variants dans le monde », rassure François Balloux. La séquence du variant comporte un indice génétique rassurant : une petite modification, baptisée ORF8. « Elle a déjà été repérée chez des patients à Singapour où elle a été associée à une atténuation des symptômes », explique encore le généticien. Reste qu'à ce stade, « on ne peut encore absolument rien conclure sur la gravité de la maladie en regardant le génome », reprend Bruno Canard. « On n'est pas capable de faire de telles prédictions avec nos connaissances actuelles. »
D'autant plus que pour les autres mutations, c'est le flou total. Leurs effets sur le comportement du virus sont inconnus que ce soit pour sa virulence ou sa contagiosité. Elles portent en effet sur des régions du génome dont les fonctions sont bien moins explorées que celle de la protéine « spike ».
Comment ce variant est-il apparu ?
Il semble être apparu chez des personnes immuno-déprimés ou souffrant d'une forme chronique de Covid-19. Comme elles ne parviennent pas à se débarrasser du virus, ce dernier a tout le temps nécessaire pour évoluer dans leur organisme. « Ce qui est intéressant dans l'étude, c'est que certains de ces patients ont été traités avec un anti-viral, le remdesivir », souligne Bruno Canard. Ce traitement serait-il à l'origine de mutations ? « C'est une possibilité, car il a un potentiel mutagène, mais qui n'est pas encore clairement démontré. » C'est également la question posée par le cas de patients immunodéprimés traités avec du plasma. « Là encore, comme ces personnes sont chroniquement infectées, elles gardent le virus sous pression de sélection plus longtemps, ce qui lui donne l'occasion d'évoluer en combattant les défenses contenues dans le plasma », reprend Bruno Canard. De quoi lui permettre de développer la capacité à esquiver – en partie – les défenses immunitaires chargées normalement de le combattre.
Faut-il revoir en urgence la formule des premiers vaccins ?
Si la question se pose avec acuité, c'est parce que la première génération de vaccins se focalise sur la réponse immunitaire contre la protéine « spike » du coronavirus, précisément celle sur laquelle des mutations sont apparues. À ce stade, heureusement, il n'est pas nécessaire de revoir la copie des premiers vaccins. En effet, les modifications du variant ne sont pas suffisantes pour lui permettre d'échapper totalement à la réaction immunitaire protectrice provoquée par la vaccination. Tout au plus, les vaccins Moderna et Pfizer/BioNTech perdraient quelques pour cent d'efficacité, mais il leur en resterait encore suffisamment pour éviter l'infection. Mais la mise en évidence de ce nouveau variant renforce une hypothèse déjà avancée par de nombreux spécialistes : la nécessité, à moyen terme, de pratiquer des vaccinations « saisonnières », un peu comme on le fait pour la grippe actuellement. Cela devait être facilité par les nouvelles biotechnologies à base d'ARN utilisées pour mettre au point les premiers vaccins qui permettront une « mise à jour » plus rapide de la formule vaccinale. Du côté des tests PCR, pas d'inquiétude à avoir, ils continueront à repérer le Sars-CoV-2 dans les échantillons, même s'il s'agit du nouveau variant.
Le variant est-il déjà présent dans d'autres pays ?
L'interdiction des vols et des trains en provenance du Royaume-Uni ne devrait pas changer la donne. Tout simplement parce que le variant a déjà été clairement identifié dans d'autres pays. Des chercheurs néerlandais l'ont trouvé dans un échantillon d'un patient prélevé début décembre, a déjà déclaré le ministre néerlandais de la Santé, dont les services tentent de savoir comment le patient a été infecté et s'il existe d'autres cas dans son entourage. D'autres patients ont déjà été repérés en Italie, au Danemark, en Australie… Et ce n'est peut-être que le début. À ce jour, la France n'a pas encore recensé de cas. De nombreux pays ne pratiquent pas ou peu de séquençages des virus retrouvés sur les patients et ne peuvent pas, de ce fait, savoir s'ils sont déjà touchés ou pas.
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit