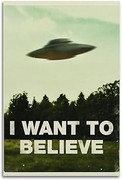jroche a écrit : 08 sept. 2024, 22:17
Dominique18 a écrit : 08 sept. 2024, 22:03
Parce que dix-neuf spécialistes émérites, auteurs du rapport, n'ont rien décelé à ce niveau, mais qu'ils laissent la porte ouverte aux interrogations.
On ne peut pas mettre en évidence ce qui n'existe pas.
Ils n'ont donc pas
de réponse, dont acte (à moins, qui sait, que certains aient la même conception que moi, ce que je soutiens n'est pas si original que ça). Je ne vois toujours comment on pourrait y arriver sans éliminer toute explication qui fasse l'économie
de l'hypothèse conscience.
mais qui ne peut rivaliser avec l'extrême complexité globale de ce vivant.
La complexité, ça se quantifie en science. Comment, par quelles expérience, pourrait-on approcher
de l'équation hypothétique reliant complexité et conscience ?
La complexité est étudiée en science, avec
de la prudence et
de la mesure pour éviter
de raconter ou
de prétendre n'importe quoi, ce qui passe par des protocoles qui se nomment analyses et métanalyses. Jacques Benveniste s'est d'ailleurs fait ramasser à ce sujet av6sa "mémoire"
de l'eau. Il a été démontré que ça ne tenait pas debout. Certains y croient toujours, cependant, mais ne sont toujours pas fichus
de prouver quoi que ce soit.
Généralement, ils ont une sainte horreur des démarches scientifiques, du matérialisme, du rationnel,...
La conscience, plutôt les consciences, sont étudiées scrupuleusement, au même titre que les mémoires.
("La" conscience, ou "la" mémoire, c'est
de la littérature, pas
de la science qui réclame justesse et précision. C'est pour ces raisons que les psychanalyses sont définitivement hors-
jeu parce que leurs discours rétrogrades s'appuient encore sur
de la pensée magique : il y a forcément "autre chose" qui ne peut qu'échapper à la science, bien trop matérialiste. Le résultat est que ça fait un demi-siècle qu'ils sont largués).
Il est abusif
de considérer que les scientifiques ne savent pas. C'est
de la rhétorique surannée. Ils sont limités par l'état ctuel des connaissances, état dynamique qui ne reste jamais figé.
Comment, par quelles expérience, pourrait-on approcher de l'équation hypothétique reliant complexité et conscience ?
Question mal formulée, au contenu bien trop vague pour espérer une réponse.
La complexité du vivant passe par la connaissance des niveaux d'organisation
de ce vivant. Si on n'a aucune idée
de ce en quoi consiste, on ne risque pas
de progresser.
Dans ces niveaux, il existe ce qu'on nomme des interactions.
Ce qui sous-entend également que le contenu
de l'article n'a pas été compris, celui qui faisait référence aux six théories principales.
Le vivant n'est pas à considérer sur le même plan que l'Ai (c'est un truisme qu'il faut pourtant rappeler).
Le gros souci général, c'est qu'on a envie que "ça" existe au détriment
de la plus élémentaire des rigueurs.
Sans rigueur, on ne va nulle part.
cf. les derniers jeux paralympiques qui peuvent donner un bon terrain d'étude à ce niveau. Quelles différences et approches, dans le handicap, entre un individu handicapé
de naissance et celui qui l'est devenu (accident, maladie), sur le plan
de la conscience, du schéma corporel, des processus adaptatifs,...?
Sur le plan complexité et conscience, il y a
de quoi faire.
Dire que les scientifiques n'ont pas
de réponse est absurde puisque les progrès réalisés sont phénoménaux (toujours dans le cas des athlètes, ce qui constitue un terrain d'expériences unique quant aux possibilités offertes, aux multiples interrogations en cours et à venir).
Quelles restrictions ? Je pose une question, toujours la même et toujours pas de réponse ni même d'idée de comment on pourrait approcher cette réponse.
Et ce que je dis n'est pas si original que ça donc ce matraquage ad hominem ne va pas. Mais, bon, j'ai le cuir épais depuis le temps.
Il n'est
de pire sourd que celui qui ne veut pas entendre.

et je n'ai rien dit de plus.
Dans les deux sens donc. Et un protocole strict, en général ça enferme dans un cadre conceptuel. Tout dépend de ce qu'on cherche.Dominique18 a écrit :3 - idem 1. Pas de protocole strict, tout et son contraire peuvent être allégués.