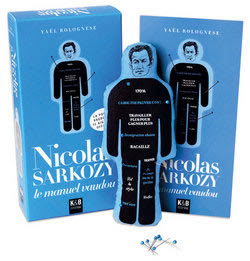Je ne sais pas pourquoi
jogging a tant perdu la cote. Peut-être qu'il n'a jamais été populaire en France, mais au Canada anglais, si. Or on tend de plus en plus à le remplacer par
running. Or chaque fois que je vois quelqu'un "courir" ainsi, j'ai plutôt envie de rire. Il faudrait inventer un verbe pour dire "sautiller gentiment en avançant d'un micro-pas à la fois pendant une période de temps exagérément longue".
Pour ce qui est des questions "le français est-il en danger" etc.. la question qui intéresse souvent les Québécois inquiets est "le français est-il en danger au Québec", et les autres francophones qui se posent la question est "la qualité du français est-elle menacée". Il ne faut pas d'autre part confondre
apprenant comme langue seconde (ou autre) et
locuteur. Dans ce débat peu de Français ou autres Européens peuvent comprendre la situation québécoise. Même en Amérique, les Acadiens en général ne voient pas où est le problème d'intrusion de mots anglais pour décrire leur réalité quotidienne, comme l'anglais pour eux n'est pas une langue étrangère.
Je ne comprends pas non plus le s du
pin's français et le masculin pour un mot dont a prononciation qui se termine en "inne", mais les Français semblent masculiniser tout mot anglais (un job), tandis qu'ici c'est selon la sonorité*. Cela montre à mon avis que les Français ingèrent ces mots mais conservent à jamais une "distance" envers ceux-ci, en les traitant différemment. Tandis qu'au Québec l'histoire et le quotidien montrent qu'on absorbe un mot au complet, ou on ne l'absorbe pas. C'est pourquoi on a tant de verbes formés à partir de l'anglais au Québec tandis que les Français ont surtout des substantifs anglais intacts, en terme d'anglicismes. Que les Québécois ne peuvent maintenir cette "distance" montre pourquoi l'ingestion de mots étrangers est souvent perçue comme une menace au français d'ici ici. Il y a d'autres mécanismes d'anglicisation mais celle du vocabulaire est la plus apparente et donc souvent critiquée.
Hallucigenia a écrit :ils ont aux aussi intégré plein de mots italiens : pizza, expresso, spaghetti al dente, etc. Comme nous.
Évidemment pour la bouffe on ne peut pas faire autrement, mais je me suis toujours demandé pourquoi ce X dans expresso. Soit on garde le mot italien, ou on prend son équivalent anglo-français (un
express, apparu pour décrire certains trains rapides au 19e siècle).. mais pourquoi cette boucherie "expresso" au lieu d'espresso ? Même problème au Québec et au Canada..
*Pour les abbréviations de mots français on tend à garder le genre du mot original au lieu de se fier à la terminaison (la loterie devient
la loto ou lieu
du loto).