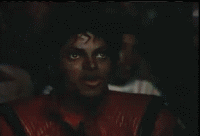@ E.B.
Etienne Beaufman a écrit : 08 avr. 2018, 16:47
Patator a écrit :Ou peut-être aussi que tu n'a pas grand chose à y opposer de consistant.
Nope.
Je ne vais pas entrer dans ton trollage.
Pour chaque réponse courte de ma part, tu floodes en retour pour décourager les réponses au point par point.
En vrai c'est plutôt que j'ai relevée tes âneries point par point et que tu n'as rien à redire aux commentaires que tu ne reprends pas.
Il y a des points précis où tu dis n'importe quoi, et où tu ne tiens absolument pas compte de mes réponses, à quoi bon se fatiguer.
Bien écoute, tu a relevé dans mes messages pas mal d'erreurs imaginaires. C'est toi qui dis que je dis n'importe quoi sur certains points. De mémoire, j'ai merdé sur un exemple donné où j'ai écrit effectivement n'importe quoi. Ce que j'ai corrigé par la suite. Or, la plupart de tes remarques, excuse moi : ne sont pas pertinentes. Enfin, je tiens bien sûr compte de tes réponses qui le sont. Mais si tu crois que je vais tenir compte de tes âneries, par ce que tu les affirmes haut et fort avec une confiance inébranlable dans le fait que tu as la parole de vérité, en plaçant ici et là quelques banalités ou fausses évidences, bien tu te goures.
Tu ne sais pas ce qu'est un argument d'autorité !
Un argument d'autorité peut tout à fait être recevable, quand on cherche la déf d'un mot, le dico fait autorité.
Argument d'autorité donc.
C'est bien ce que je disais : tu n'argumentes pas, tu reprends des choses dites par d'autres, sans les avoir forcément comprises d'ailleurs, mais c'est la vérité pour toi...
Et non, un dico généraliste ne fait autorité que pour des mots d'usage courant, on y trouve des définitions de notions plus que des définitions de concepts.
Si tu n'es pas d'accord pour admettre que la confiance est une croyance selon l'un des meilleurs dico en ligne, alors à quoi bon discuter avec toi ?
C'est le premier point, on arrête la science infuse, sinon stop.
Tu cites une définition qui correspond à ta croyance et tu voudrais me l'imposer parce qu'elle est dans un dico ? --------->

Les dicos c'est bien pour quand on connait pas l'usage d'un mot. Après, c'est un peu limite quand on cherche à préciser les concepts.
Le tout c'est de définir les mots que l'on emploie (autrement dit : il s'agit bien souvent simplement d'en préciser le sens).
Second point :
tu t'acharnes à utiliser des équivalences pour formaliser des définitions.
Je t'expliques une dernière fois pourquoi tu as tort, si tu comprends toujours pas, à quoi bon discuter avec toi ?
Je me rappelle que tu m'avais dit que j'avais tort, mais il n'y avait rien à comprendre dans ta remarque, puisque tu affirmais sans expliquer en quoi : le fait d'utiliser des équivalences comme je le fais serait une erreur. Sache que je ne reconnais aucune autorité autre que celle de la logique et des faits. Donc tu peux continuer d'affirmer gratuitement ce que tu veux, cela n'a aucun impact sur moi.
Mais examinons ce que tu dis ensuite où tu sembles tenter d'étayer ta remarque :
mot à définir : dessiner
définition simple : faire un dessin
D(x) : dessiner x
Fud(x) : faire un dessin de x
version simple est compréhensible par tout le monde
D(x) = Fud(x)
il n'y a que deux cas possibles,
une égalité est toujours vraie !
soit D(x) = Fud(x) = 0 soit D(x) = Fud(x) = 1
en français ça donne :
faire un dessin de x c'est dessiner x, et, ne pas faire un dessin de x c'est ne pas dessiner x.
version tarabiscotée par tes soins
D(x) <=> Fud(x)
il y a quatre cas possible,
une équivalence peut être fausse !

Premier problème : c'est débile !
C'est ta compréhension de la logique qui l'est. ------->

D(x) <=> Fud(x)
Ça signifie que les propositions D(x) et Fud(x) sont interchangeables. En effet : D(x) <=> Fud(x) signifie que si l'on a D(x) l'on a nécessairement Fud(x) et inversement, et que si l'on a D(x) et pas Fud(x) ou Fud(x) et pas D(x) c'est que l'équivalence est fausse.
Très simplement, D(x) <=> Fud(x) peut se lire : D(x) si est seulement si Fud(x) ou ce qui revient au même : Fud(x) si est seulement si D(x). C'est exactement ce qui définit une définition.
Une définition c'est en effet pareil qu'une équivalence, elle est interchangeable avec le mot qu'elle définit. Mais ce n'est en rien une comparaison. C'est donc toi qui enchaînes les âneries. (Oui, tu es tellement sûr d'avoir raison que tu ne ressens même plus le besoin de réfléchir, ce qui te fait dire des choses bêtes.)
Et ce que tu ne piges pas, - et c'est notamment en cela que ce que tu dis est grotesque, - c'est qu'une égalité n'est qu'une sorte d'équivalence :
Une égalité => une équivalence
De plus, tu dis qu'une égalité est toujours vraie, or ça c'est encore une fois n'importe quoi, car bien entendu une égalité peut être fausse, j'en corrige souvent d'ailleurs. Où as-tu vu jouer qu'une égalité serait toujours vraie ?
Exemple :
Avec a : un nombre pair et b : un nombre impair, a² = b est bien une égalité. Elle est certes évidemment fausse, mais c'est bien une égalité. C'est une égalité, parce que cette expression a la forme d'une égalité.
Or, quelle est la différence qu'il existe entre ce cas et celui d'une équivalence fausse, en dehors bien sûr du fait qu'il s'agisse dans un cas d'une égalité et dans l'autre d'une équivalence ?
------->

Ensuite, on peut toujours définir une égalité comme une comparaison, mais ce n'est même pas obligé. On peut traiter une égalité posée comme on traite une équivalence, comme le cas ci-dessus donné en exemple.
l'équivalence est un opérateur logique, ce n'est pas un opérateur de comparaison :
 source
source
C'est déjà suffisant pour que tu cesse de faire n'imps.

Tu mélanges les formalismes.
Tu crois m'apprendre quelque chose par ces tableaux ?
L'expression commune :
"Comparaison n'est pas raison" s'applique ici.
- D'une façon très générale, une égalité relie deux objets identiques entre-eux par une propriété considérée, autrement dit : deux objets non distincts par cette propriétés. Or, 2 propositions équivalentes ne sont pas identiques par une propriétés dans leur formulation mais par leur vérité dialectique (implicationelle), de la même manière que d'un point de vue formel : un mot n'est pas identique à sa définition. Il n'y a donc pas égalité mais équivalence entre un mot dans l'emploi qui en est fait et sa définition correspondante. En effet : un mot et sa définition ne sont pas identiques mais il est possible de remplacer l'un par l'autre dans un texte, sans en changer le sens (c'est-à-dire très précisément : sa vérité dialectique, implicationnelle comme je l'ai évoquée).
- En arithmétique et en algèbre, une égalité c'est une expression liant par le signe
" = " deux quantités identiques. Donc : a = b, si a et b sont la même quantité. Ce n'est pas du tout adaptable aux mots et à leur définition.
- En logique classique de plus, l'on n'utilise pas le signe
" = " , on ne parle pas d'égalité. Par contre, le signe
" <=> " est d'usage abondant - et il connecte quoi ? - je te pose la question -, il connecte
des propositions.
On peut d'ailleurs écrire et lire "x = y <=> y = x", "x = y" et "y = x" étant des propositions mathématiques, mais pas "x <=> y = y <=> x", expression qui n'a aucun sens.
Donc, malgré ce que tu cries et crois, une définition, c'est bien une équivalence logique et non une égalité mathématique.
deuxième problème :
Pour que ce que tu écris ait du sens selon toi, il te faut supposer que l'équivalence que tu vas utiliser sera toujours vraie,
Q : pourquoi diable utiliser une équivalence à 4 états pour n'en utiliser que 2 ?

Pourquoi ? Et bien parce que c'est comme ça qu'on fait en logique classique, tout devant pouvoir s'écrire avec seulement des symboles pour les propositions, des lettres par exemple :
"a",
"b",
"c", etc... les connecteurs
"et" et
"ou" (inclusif), la négation
"non" et des parenthèses
"(" et
")", sachant que même les formules utilisant les connecteurs
"=>" ou
"<=>" peuvent s'écrire comme dit.
Or, toi, monsieur Beauman, comment fais-tu pour écrire un
" = " avec cette restriction ?
Ça m'intéresserait bien de le savoir......
troisième problème :
tu fais pareil avec l'implication
tu nous sors des a -> b, et tu te permets de modifier des termes par d'autre en raison de telle ou telle implication.
je veux bien que dans ta tête ça fasse sens, mais c'est tout bonnement n'importe quoi.
Ce serait n'importe quoi parce que monsieur l'a décrété ?
Ce n'est pas que dans ma tête que cela fait sens. C'est là l'application implacable des règles de la logique classique.
- Mais je peux comprendre que tu n'en aies pas l'intuition. La logique ce n'est pas évident pour la plupart d'entre nous : petites choses humaines...
Alors, dis moi ce que j'ai fait qui ne serait pas logique selon toi.
Quels termes aurais-je modifiés sans en avoir le droit formel ?
l'implication entre deux termes admet elle aussi 4 états, 3 sont vrais et 1 seul est faux (si a=1 et b=0, a->b=0)
j'imagine donc que tu considères tes implications toujours vraies.
sinon clamer que
S(x) => non C(x)
si tu considères que ça peut être faux, ça rime à rien.
Quand on pose ou infère (implique) une implication logique, si on le fait en bonne logique, avec des prémisses (axiomes, données ou définitions) non contradictoires entres elles, il n'y a aucune raison qu'elle soit fausse, ni que son premier terme le soit.
Donc, si tu veux prouver que j'ai tort, tu ferais mieux de cesser de chercher à ébranler les bases axiomatiques et les règles de la logique et essayer plutôt de trouver l'erreur dans les raisonnements que je tiens et que j'ai formulés. Tu as pour cela trois façons de t'y prendre : 1) prouver qu'au moins une de mes définitions présente une contradiction interne 2) prouver qu'au moins deux de mes définitions sont contradictoires entre elles, ou encore 3) prouver que j'ai impliqué une vérité que je n'étais pas en droit d'impliquer selon les règles de la logique (ici la classique).
or il y a un cas que tu oublies depuis le début si a=0 et b=1, a->b =1
soit pour l'exemple S(x) => non C(x), ne pas savoir x implique ne pas croire x est vrai.
et c'est ça contradictoire avec ton affirmation guignolesque
"Croire c'est ne pas savoir et savoir c'est ne pas croire."
Non mais ici le guignol c'est toi, parce que quiconque a un tout petit peu étudié les bases de la logique sait parfaitement que si "A" est fausse quelle que soit la valeur de vérité de "B", "A => B" sera vraie.
Mais toi tu sembles le comprendre en un sens aussi ridicule qu'absurde. La preuve de cela un peu plus loin.
Le fait que l'implication "A => B" est vraie quand "A" est fausse est en réalité très sensé et cela s'explique comme suit : l'on peut tout prouver à partir d'une contradiction.
Principe d'explosion :
(wikipédia)
"Le principe d'explosion, énoncé en latin ex falso quodlibet ou encore ex contradictione sequitur quodlibet, « d'une contradiction, on peut déduire ce qu'on veut » ou le principe de Pseudo-Scotus, est une loi de logique classique, de logique intuitionniste et d'autres logiques, selon laquelle n'importe quel énoncé peut être déduit à partir d'une contradiction."
Preuve :
Dans l'exemple, avec S(x) : fausse, tu fais comme si : S(x) => non C(x) était l'équivalent logique de
"ne pas savoir x implique ne pas croire x", autrement dit de : non S(x) => non C(x). --------> Or ça, ça, c'est une erreur de petit débutant l'ami !
Ce qui est vrai, c'est que si S(x) est faux, l'implication dont on doit en inférer la vérité c'est celle-ci :
"savoir x implique ne pas croire x" et non celle-là :
"ne pas savoir x implique ne pas croire x", comme tu le proposes à tort.
Alors ? Alors ? C'est qui le guignol ?

De plus, avec S(x) : fausse, cela n'implique même pas la vérité de "non C(x)", autrement dit : de ne pas croire x !
Donc, pour ceux qui nous liraient il faut simplement se souvenir que la proposition "A => B" est fausse exactement lorsque "A" est vraie et "B" fausse, raison pour laquelle elle peut aussi se lire
A seulement si B. C'est cela que signifie exactement une implication, se le rappeler peut éviter d'enchaîner les âneries comme celle qui suit et complète l'autre :
selon tes propres bout d'équation
ne pas savoir c'est aussi
ne pas croire, mais
ne pas croire selon toi c'est
savoir donc bravo tu as démontré que
ne pas savoir c'est
savoir !!!



Voici la logique que pratique E. Beauman.
>>>>>>> Soit : une logique de

_____
...et c'est ça contradictoire avec ton affirmation guignolesque
"Croire c'est ne pas savoir et savoir c'est ne pas croire."
Là par contre je dois te donner raison. Mais je reprenais une expression de par chez moi, qui est fausse.
Sachant que :
- C(x) ≠> S(x)
- S(x) => T(x)
- C(x) => T(x)
Ce qui est vrai c'est :
- C(x) => non S(x) ----------------> une croyance n'est pas une sorte de savoir
- S(x) => non C(x) ----------------> un savoir n'est pas une sorte de croyance
- non C(x) => S(x) ∨ non T(x)
- non S(x) => C(x) ∨ non T(x)
Note : je n'écrirai plus . ou + , j'utiliserai désormais, comme ici, les signes de la logique classique :
- ∧ : "et" (conjonction)
- ∨ : "ou" (disjonction inclusive)
.Une croyance c'est une affirmation que l'on tient pour vraie mais qui peut être fausse. Pas besoin de bosser la logique ou de pratiquer la méthode scientifique pour croire.