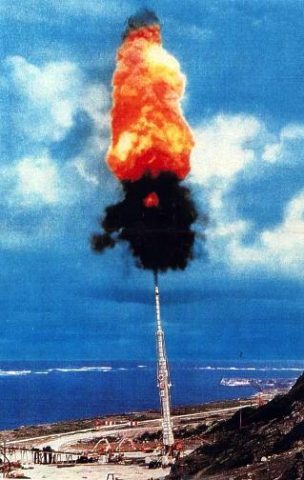Mary Shostakov a écrit : 11 avr. 2019, 15:09
En passant, je voulais signaler que nous avons ici et maintenant la chance d'avoir en cosmicboy un physicien qui vaut la peine d'être écouté avec le plus grand respect lorsqu'il parle.
C'est gentil

mais j'espère bien ne pas être considéré comme "l'expert" physicien, plutôt comme l'un d'entre vous que vous n'hésiterez pas à contredire. Il est parfois dur de s'extraire complètement de l'argument d'autorité, surtout quand il s'agit de soi-même, c'est parfois pratique (ça permet de gagner du temps) mais ça mène aussi parfois à des explications lacunaires et peu rigoureuses. Et oui, on a pas besoin d'être précis puisque celui qui nous écoute sait qu'on sait, une explication vague sera suffisante et même plus parlante pour un "néophyte". Ouai, et bien voilà en partie pourquoi on entend parfois de grands physiciens dire sur YouTube des énormités dignes d'un étudiant de premier année. Jugez-moi donc sur mes arguments, et tant pis pour moi si ma flemmardise m'amène à prononcer des contre-vérités, je n'aurai qu'à être précis

.
Il ne fait nul doute pour moi qu'il saura expliquer ici pourquoi et comment lorsqu'un voyageur se déplace à une vitesse presque égale à celle de la lumière dans le vide le temps s'écoule tout ce qu'il y a de plus normalement pour lui, mais pas pour le reste du monde vu par lui et resté immobile par rapport à lui.
Je pense que tu comprendras mieux le principe si tu te focalises sur le principe de contraction des distances (dans le sens du mouvement de celui qui se déplace) et le fait que pour une personne en mouvement, les distances parcourues pour lui (selon son point de vue) ne seront pas les mêmes que celles que toi tu observes de ton point de vue. Pour un vaisseau voyageant à de grandes vitesses, partant de la Terre, la distance qui le sépare de la galaxie d’Andromède est beaucoup plus petite que ce que nous on pense sur Terre. Je dis bien "que ce que nous on pense" car si nous imaginons que la distance réelle ou absolue Terre -Andromède est celle que nous mesurons sur Terre (2.5 million d'année-lumière), et bien nous nous trompons. Il s’agit uniquement de la distance que nous mesurons dans notre référentiel. Pour un même voyage Terre – Andromède, l’observateur sur Terre et l’équipage dans le vaisseau ne seront d’accord ni sur le temps, ni sur les distances parcourues, et ils auront à la fois raison et tort tous les deux. Si l’équipage a eu le temps de parcourir cette distance en quelques minutes, c’est parce que pour eux la distance était plus petite. Et pour l’observateur terrestre, tout se passera comme si le temps sur le vaisseau se sera écoulé plus lentement (dilaté). La dilatation du temps étant "compensée" par la contraction de l’espace, la seule chose sur laquelle tout le monde aura été d’accord, c’est la vitesse.
Mais comment l'expliquer ? Parce que Einstein s’est débarrassé des concepts de temps et d’espace absolus pour en établir un autre (en quelque sorte tout aussi absolu d'ailleurs) : l’espace-temps. Les relations entre coordonnées spatiales et temporelles doivent être pensées en terme d’espace-temps.
Tout découle de cet état de fait : les équations de Maxwell demeurent inchangées lors du passage d'un référentiel inertiel à un autre : la vitesse "c" est toujours la même. Einstein va vite comprendre que la physique galiléenne ne peut pas rendre compte correctement des relations entre les coordonnées spatiales et temporelles, il va donc en quelque sorte reconstruire les transformations de Lorentz (par lesquelles les équations de Maxwell demeurent inchangées lors du passage d'un référentiel galiléen à un autre) pour en conclure magistralement que le temps et les longueurs ne sont pas absolus mais relatifs au système de coordonnées.
Un exemple simple qui correspond bien à l’expérience de pensée d’Einstein : dans un vaisseau en mouvement (rectiligne, uniforme), un membre d’équipage allume une lampe torche en direction du plafond qui reflète la lumière de cette lampe. La lumière va de bas en haut (de manière verticale) pour ceux qui sont dans le vaisseau, n'oublions pas que pour eux tout se passe comme si le vaisseau était immobile. Mais pour un observateur situé sur Terre, le vaisseau, lui, n’est pas immobile, il bouge de la gauche vers la droite. Le mouvement de la lumière ne parait donc plus vertical (comme dans le vaisseau), mais oblique pour celui qui l’observe de dehors. La distance parcourue par le rayon lumineux sera plus grande pour l’observateur que pour les membres de l’équipage. Pourtant, la vitesse "c" est bien absolue, quel que soit le référentiel. Comment donc la lumière peut-elle parcourir plus de distance pour l’observateur dans un même laps de temps ? et bien justement car il n’y a pas de "laps" de temps en soi. C’est l’hypothèse que formule Einstein : il s’est passé plus de temps dans le référentiel de l’observateur terrestre, alors même que le rythme d’écoulement du temps au bracelet de sa montre est resté inchangé. Alors même que le rythme d’écoulement du temps au bracelet de la montre de ceux qui se situent dans le vaisseau est resté inchangé. Pour lui, l'observateur, le temps qui s’écoule dans le vaisseau en mouvement parait dilaté (ralenti). Encore une fois "la distance parcourue pendant 1 seconde par un voyageur marchant dans un train est différent suivant qu'elle est mesurée dans le train ou sur le quai". Autrement dit les longueurs et les temps se contractent dans le sens du mouvement et se dilatent dans le sens opposé au mouvement.
Pour la démonstration formelle, le mieux est que je te renvoie à l'article d'Einstein lui-même, il ne demande pas un grand niveau technique pour être compris
 http://etienneklein.fr/wp-content/uploa ... vement.pdf
http://etienneklein.fr/wp-content/uploa ... vement.pdf