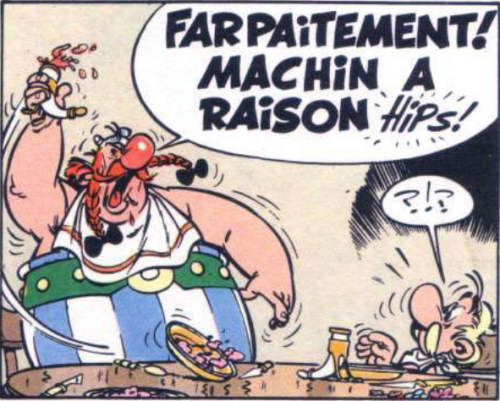@ Guillaume
Un extrait d'une intervention de Wooden Ali, sur un autre fil (j'espère qu'il ne l'en voudra pas pour cet emprunt) où on retrouve (toujours) la même problématique inhérentes et récurrente :
...Les interventions zozos montrent qu'ils sont avant tout de grosses feignasses intellectuelles. La Science, seul moyen connu pour produire du savoir objectif, c'est difficile, couteux, frustrant, ça amène à dire "je ne sais pas", "je ne comprends pas". Elle demande de la rigueur, du travail, encore du travail sans oublier de l'imagination et de la créativité.
Toutes choses qui rebutent la zozoterie triomphante. Ils préfèrent émettre des hypothèses qui ne fatiguent pas et qu'on sait d'avance être infalsifiable. Ce qu'ils aiment, c'est un match sans arbitre qu'on peut jouer sans transpirer. Dieu et les extraterrestres sont l'expression de cette paresse. Pour eux, c'est montrer qu'ils ont l'esprit ouvert et de l'imagination. La stérilité constatée de leur démarche ne les rebutent pas. Au contraire, ils en sont même fiers !
Il est idiot aussi d'attaquer la Science en tant qu'institution pour critiquer sa démarche. Comme toute institution humaine, elle peut être en but aux biais et dérives de ses acteurs. C'est fatal. La Science à toute fois cette originalité de pouvoir corriger ses faux-pas bien mieux que n'importe quelle autre institution car elle a un juge-arbitre implacable : les faits et la logique. Ce que refusent catégoriquement les zozos...
C'est le ton général qu'il faut considérer, la teneur du contenu. Ça ne s'adresse pas à des personnes en particulier mais à un état d'esprit, qu'on peut retrouver dans de multiples domaines.
Deuxième point, qui recouvre plusieurs domaines : l'apparition du vivant, les processus évolutifs conduisant à des mises en forme successives, où le hasard intervient, où rien n'est codifié et réglé comme du papier à musique, où de multiples développements nous échappent...
Plus on essaie d'étendre le champ de ses connaissances, plus on peut espérer "casser" le recours (inconscient) au raisonnement circulaire.
L'enjeu, si on peut le caractériser ainsi, c'est qu'à chaque démarche poussée on parvient peu à peu à déterminer et à reconnaître son propre niveau d'incompétence pour s'exprimer à propos d'un sujet. Ce qui signifie avoir développé des compétences pour déceler son incompétence. Jusqu'à l'étape suivante.
Pour la synthèse et la clarté (ce qui reste toujours matière à discussion et à contestation), à mon niveau, je n'ai pas trouvé mieux que la série de cours proposée par Bruno Dubuc.
J'y reviens souvent parce qu'il propose un fil conducteur, avec une volonté pédagogique au service des autres, sous forme d'outils.
Ce qui donne concrètement :
Notre cerveau à tous les niveaux (UPop Montréal, Automne 2019 - Hiver 2020)
https://lecerveau.mcgill.ca/flash/pop/pop_pres/pop_pres_ecole_profs.html
Figure une série de dix interventions, de dix cours, au sujet, pour faire court, de la globalité du fonctionnement de l'être humain.
Sans se dispenser de prendre connaissance de l'ensemble de ces cours, les n°2 (poussières d'étoiles) et 9 (le l'apparition du langage) permettent d'avoir un non aperçu de la complexité de la problématique.
Bruno Dubuc propose un canevas conçu en l'état actuel des connaissances, évolutif, intégratif quant aux dernières avancées scientifiques, avec un fil conducteur, pour s'y retrouver.
L'étude de ces cours prend du temps, beaucoup.
Quant à savoir si on est capable de bien intégrer la masse d'informations, c'est un autre problème qui renvoie à la notion de compétences et d'incompétence, qui calme le jeu.
On n'en ressort pas avec des certitudes, mais avec encore plus d'interrogations.
C'est avec des interrogations qu'on progresse, pas avec des convictions.
La question de dieu, puisqu'il s'agit bien de cela, reconduit vers de la rhétorique, ce qu'ont expliqué Mathias et Dany, sous des formes différentes, mais la conclusion est similaire.
On ne peut pas faire autrement que de retourner dans des développements rhétoriques, il n'y a rien de novateur à ce niveau et certainement pas la parution du livre "*Dieu, la science, les preuves" qui renvoie, une fois de plus, à la case départ. Ce qui semble normal puisque le raisonnement est circulaire.
C'est l'une des raisons pour lesquelles le cours n°9 (L'apparition du langage) de Bruno Dubuc apporte un nombre d'éléments à considérer.