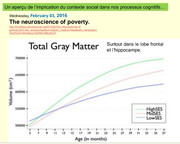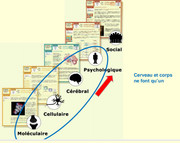#187
Message
par Dominique18 » 02 mars 2023, 22:23
D'accord. Plutôt que des scans, il faut aller voir du côté d'une structure comme Neurospin plutôt unique (Stanislas Dehaene), pour observer et examiner, grâce aux possibilités d'imagerie cérébrale existante, ce qui se produit au niveau du cerveau quant aux échanges de divers types avec les zones cérébrales en activité,...
Le conscient et l'inconscient, cognitifs, restent bien mystérieux. Henri Laborit indiquait que le conscient ne servait que d'alibi aux motivations de l'inconscient. C'est à ces aspects qu'on s'aperçoit que les mots traduisent (très) difficilement des concepts scientifiques.
Conscient, inconscient, pensée, intention, pulsion,... Intention est un terme polysémique, tout dépend du contexte référence, soigneusement choisi et identifié comme tel.
Intention induit la notion et la dimension de conscient.
Pulsion, plutôt celle d'inconscient.
La frontière est floue, les mots impropres à rendre compte de la "juste" réalité scientifique.
Là encore, les termes langagiers utilisées sont source de suspicion.
Qu'on l'admettre ou pas, nous sommes fondamentalement, et avant tout, des entités neurobiologiques. La pensée, le conscient, tels que nous les concevons avec l'ensemble de nos connaissances n'ont jamais précédé l'apparition du vivant. Avant la mise en forme d'ordre neurobiologique c'était encore autre chose qui a pris xxx années dans le long processus de l'évolution.
Ce qui permet de constater qu'à l'échelle de la réflexion humaine, nous avons un gros souci avec le temps. Nos méninges sont à la traîne pour traiter de cet aspect sur le plan conceptualisation. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que des chercheurs comme Thierry Ripoll indiquent que notre équipement cérébral est dépassé face à la complexité de nos sociétés.
J'en ai brièvement parlé dans un précédent post. Ce n'est pas une notion nouvelle. Les chercheurs de l'école de Palo Alto travaillaient déjà sur le sujet, à leur niveau de connaissances, dans les années 60. L'introduction de la cybernétique a permis de progresser.
Ce que je constate, c'est que nous ne nous appartenons pas. Nous croyons détenir les rênes du pouvoir, ce n'est pas le cas. La somme de déterminismes passe avant "nous". Nous ne sommes que des "produits". Ce n'est pas parce que nous pensons que nous savons. Mais on peut toutefois essayer. Sinon, il n'y aurait jamais eu de création comme Neurospin avec son armada de chercheurs
https://joliot.cea.fr/drf/joliot/Pages/Entites_de_recherche/NeuroSpin.aspx
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/NeuroSpin
Je ne sais pas où en est la recherche à ce niveau à propos des biais cognitifs (expériences conduites, protocoles expérimentaux, restitution des résultats,...).
Il y a certainement plus de nouvelles questions que de réponses.
C'est comme le "passage" entre la matière inanimée et le vivant. On dispose des éléments, mais on ne sait pas comment les assembler, et faire en sorte que cela fonctionne, c'est à dire comment arriver à reproduire l'apparition de la vie à partir de combinaisons de ces éléments.
Les scénarios existent mais ils restent à l'état d'hypothèses, faute de démonstrations convaincantes.
Au cours de l'une de ses interventions, Hubert Reeves rappelait qu'un individu, un être vivant, ne saurait être uniquement rapporté à la somme de ses composants ou constituants. Il y avait "autre chose" qu'on ne connaissait pas. Mais ce n'est pas parce parce qu'il y a un manque constaté dans les connaissances qu'on peut se laisser aller à prétendre n'importe quoi. Seul l'expression à l'intérieur d'un cadre scientifique est le plus sûr moyen à disposition permettant d'éviter les dérives.
Depuis l'apparition du vivant, on a pu avancer avec la théorie de l'évolution de Darwin, mais il a fallu du temps, et elle n'est pas toujours acceptée, alors que c'est le seul modèle explicatif dont on dispose, et il semble plutôt fonctionner correctement, du moins par rapport à l'état des connaissances.
J'ai évoqué le mythe de Sisyphe. Ce n'était pas une boutade. Le sujet est passionnant mais plutôt épuisant. Les apports de personnes telles Bruno Dubuc (certainement pas un "maître à penser") sont précieux car ils permettent de se recentrer, de définir une ligne de conduite pour éviter de (trop) s'égarer. L'éclairage apporté est instructif car on peut disposer d'un maximum d'éléments, avec des références, des sources, ce qui n'est pas rien.
A mon (très) modeste niveau, je ne vois pas comment progresser sans notion d'interdisciplinarité, ce qui suppose s'aventurer sur de nouveaux terrains et affronter de nouvelles connaissances qui risquent fort de mettre à mal celles que l'on pensait détenir en toute "sécurité", bien à l'abri dans sa zone de confort.
Deux informations qui vont dans le sens de mes réflexions...
- L'homme de Néandertal...
Un préhistorien (il faut que je recherche son nom) considère qu'il ne faut plus penser l'homme de Néandertal comme un humain mais comme une créature autre (sans connotation péjorative, c'est une définition à comprendre sur le plan scientifique), ce qui obige à changer de paradigme et à penser autrement.
Je peux indexer l'article en question.
- Pierre Clastres, un ethnologue..
Il a établi, en étudiant des tribus amazoniennes qu'un nombre d'individus aux alentours d'une centaine de membres composant le groupe social, représentait un seuil à ne pas franchir, parce que les interactions sociales pouvaient être régulées et optimisées entre les membres.
Au-delà, surgissaient des questions sociétales, c'est à dire que des structures créées, à cause du nombre, engendraient des dysfonctionnements provoqués, non par les membres,bmais par ces structures étatiques.
Autour d'une centaine d'individus, chacun peut avoir un regard sur ce qui se passe à l'intérieur du groupe social. Passé ce nombre, le regard disparaît, absorbé ou dilué par la multitude.
Les problèmes humains générés sont plus conséquents que dans la première option, la régulation moins opérante.
Une indication qui complète cette dernière réflexion...
Des chercheurs ont récemment établi qu'au niveau des réseaux sociaux, on retrouvait ce nombre d'une centaine d'individus. Un adepte de ces réseaux entretient des relations avec au grand maximum cent-cinquante autres membres. Les deux situations sont à contextualiser, en ayant bien conscience des facteurs en jeu. Elles sont à considérer sur le plan régulation et optimisation d'un groupe social.
Le fonctionnement humain semble obéir, du fait des interactions sociales (cf mon précédent post avec l'intervention de Bruno Dubuc), à des "standards" de comportement dont les mécanismes intermes restent intrigants.
Ce fonctionnement obéit à des bases dont l'origine est enfouie dans l'inconscient cognitif.
Comme je l'ai laissé entrevoir, nous disposons d'une somme d'éléments. Comment est-ce qu'ils se combinent entre eux, c'est un sujet vaste qui échappe à nos compétences.
Ce qui, au terme de ce long post, ne conduit pas à des affirmations mais à des questionnements.
Processus cognitifs, biais, intention... certes.
Essayer d'opter pour une rationalisation semble quelque peu hasardeux.
Personnellement, je n'y parviens pas. Il y a toujours quelque chose qui coince.