Sophie Mazet
Vis ma vie de prof laïque
(Franc-Tireur n°95)
Des voix s’élèvent pour juger inutile et « islamophobe » d’interdire l’abaya à l’école. Ce
n’est pas l’avis de Sophie Mazet, professeure de lycée à Saint-Ouen. Elle est l’une des
premières à avoir affronté la crise des abayas, dès 2011, avec en face d’elle un collectif
islamiste virulent… qui mènera plus tard l’offensive contre Samuel Paty. Depuis, des
influenceurs religieux ont pris le relais sur TikTok et les « provocations » ont fleuri. En «
première ligne », les directeurs et les enseignants ont tout essayé : le déni, le silence, la
négociation. Rien n’a marché. Ils sont 80 % à approuver la décision du nouveau ministre
de l’Éducation nationale et à souhaiter une règle claire. Sophie Mazet en fait partie, et
nous dit pourquoi. Une parole courageuse.
Vous pouvez m’appeler Denver: je fais partie des derniers dinosaures de l’Éducation nationale.
Ceux qui pensent que la laïcité est un principe nécessaire, dont collégiens et lycéens peuvent
comprendre les bienfaits. Nous sommes une espèce en voie d’extinction. Et le dinosaure est
épuisé. En cette rentrée 2023, Gabriel Attal vient d’annoncer qu’on ne pourrait plus porter
l’abaya à l’école, en vertu de la loi du 15 mars 2004 interdisant aux élèves d’arborer « des
signes ou tenues par lesquelles ils manifestent ostensiblement une appartenance religieuse».
C’est un soulagement pour les personnels des établissements qui se sentent un peu moins
abandonnés. La droite et l’extrême droite, unanimes, ont salué la décision du ministre. Mais moi
je suis de gauche, et la réaction de l’immense majorité des leaders de mon camp me met en
colère, sans pour autant me surprendre. Avec plus ou moins de mauvaise foi, ils racontent
n’importe quoi. Quand Dominique Sopo, président de SOS Racisme, déclare sur BFM : « Les
différents problèmes qui ont eu lieu se sont réglés assez bien 1 », c’est faux. Je suis en
première ligne et parfaitement placée pour en parler. Rien n’était réglé.
Sur le terrain, on a le sentiment d’être bien seuls à se débattre avec ces provocations. Plus
encore, quand nous sommes accusés de «faire la chasse aux femmes musulmanes », de
stigmatiser ou de nous ériger en « police du vêtement ». Nous, enseignants, personnels de
direction, conseillers principaux d’éducation (CPE), ou l’Éducation nationale dans son
ensemble, serions donc «islamophobes ». Nous chercherions à tout prix à savoir qui est
musulman pour mieux l’exclure. C’est le contraire de ce que nous vivons. Nous nous efforçons
de traiter toutes nos lycéennes à égalité, sans les assigner, mais lorsqu’une d’elles se présente
en classe vêtue d’une abaya, on ne peut pas ignorer sa religion.
Une abaya n’est pas comparable à une coquetterie, comme a tenté de le faire croire Cécile
Duflot sur X (ex-Twitter) en postant la photo d’une longue robe-chemise à imprimé vert et bleu,
légendée : « Ça vous choque, ça? C’est une atteinte à la laïcité? » Un internaute qui n’y connaît
rien est tombé dans le panneau. Oui, a-t-il répondu, et elle s’en est régalée: «Bim badaboum
perduuuuuuuu c’est PAS une abaya, c’est une robe GUCCI, 2 980 euros. » Quiconque croise
des jeunes tous les matins sait faire la différence entre une robe Gucci et une abaya… Que nos
élèves nous disent porter pour respecter leur foi, couvrir leurs corps d’une couleur sombre qui
ne doit jamais comporter de fioritures.
Le vice-président du Conseil français du culte musulman a beau déclarer que cette tenue n’est
pas religieuse, nos jeunes filles, elles, en sont convaincues et se conforment à ce que leur
racontent des prédicateurs ou des influenceurs sur TikTok. L’intention est là, et c’est elle qui
compte pour établir si le port de la tenue vise à manifester son appartenance. Ce défi, nous le
vivons tous les jours, comme nous avons traversé celui du voile. On nous demande de faire
comme s’il n’existait pas. Problème : cela ne fonctionne pas. Je peux l’affirmer car j’ai vécu
l’arrivée des abayas dans mon lycée en Seine-Saint-Denis, il y a douze ans. Nous avons
essayé la négociation à bas bruit… Sans succès.
NOUS N’ÉTIONS PAS PRÉPARÉS
Retournons à cette première crise. Nous sommes en 2011. Je ne suis pas encore un dinosaure,
mais une jeune prof pleine d’énergie. J’enseigne l’anglais depuis quatre ans, j’aime mes élèves
et ils m’apprécient. La laïcité? Cela ne m’évoque alors pas grand-chose. La loi de 2004? Une
partie du règlement intérieur à faire appliquer au même titre qu’une autre. Je n’ai rien contre, je
n’ai rien pour non plus. L’approche opposée, laisser les jeunes porter tous leurs signes
religieux, ne me semble à l’époque pas forcément mauvaise. Seulement il y a la règle. Et je la
fais respecter, comme celle de demander à mes élèves d’ôter leur casquette. Parfois, je fais du
zèle, jugeant que je n’ai pas à mettre les formes pour recadrer celui qui l’enfreint sciemment.
Mes collègues me conseillent de mettre la pédale douce, inquiets de me voir, avec mon gabarit
de poche, pourchasser dans les couloirs des gaillards de 1,80 mètre en criant: «Bonnet!
Casquette!» Désormais, je demande gentiment, et ça marche. Quant aux signes religieux, je
n’ai pas le souvenir d’avoir dû faire enlever autre chose qu’une grande croix portée en
pendentif… jusqu’à 2011.
Cette année-là, je déborde d’enthousiasme. J’inaugure mon tout nouvel atelier d’«autodéfense
intellectuelle » pour former les jeunes volontaires à exercer leur esprit critique. C’est un succès.
Même s’ils me gratifient un jour d’un : « Madame, à cause de vous, on ne croit plus en rien ! »,
je sais qu’ils ne m’en veulent pas : ils viennent semaine après semaine. Nous débattons de tout
: politique, publicité, pseudosciences, et même laïcité. Parfois en présence d’auteurs comme
Caroline Fourest ou de l’islamo-logue franco-tunisien Abdelwahab Meddeb. L’aventure va durer
dix ans.
À cette époque déjà – nous sommes donc pendant l’année scolaire 2010-2011–, je remarque
dans l’une de mes classes une jeune fille toujours habillée d’un long vêtement couvrant que je
ne sais pas encore nommer, et que j’appelle, faute de mieux, une longue robe noire. Elle est
dépourvue d’ornement, fabriquée du même tissu que le voile qu’elle arbore sur la tête hors du
lycée, et autour de son cou le reste du temps. Le terme robe est d’ailleurs imprécis et inexact,
puisqu’elle la porte par-dessus ses vêtements. Et elle n’est pas la seule. Elles sont une dizaine
pour un lycée de près de mille élèves. C’est peu. Mais c’est nouveau. Peut-être est-ce pour cela
que nous n’avons pas réagi immédiatement. Mon élève est discrète, elle a d’importantes
difficultés, ne participe pas, mais ne pose aucun problème. Un jour, à la fin d’un cours, je la
retiens et lui glisse ces mots, préparés avec soin (merci encore à mes collègues de m’avoir
appris la modération) : « Je crois qu’il va falloir entamer une réflexion autour de votre tenue.
Elle me semble relever de la loi sur les signes religieux à l’école. Je vous laisse y réfléchir, nous
en reparlerons dans quelque temps. » La loi du 15 mars 2004 prévoit une phase de dialogue
avant d’évoquer la moindre sanction.
Quelques mois plus tard, le 11 mars exactement, la direction du lycée la convoque et, avec elle,
les autres jeunes filles affichant la même tenue. C’est là que les ennuis commencent. Par
méconnaissance, les choses ont été mal faites, il faut le reconnaître. Il aurait fallu se renseigner
davantage, avant d’aller au bras de fer. Les adolescentes ont d’abord admis qu’elles portaient
ce vêtement pour manifester leur appartenance religieuse, avant de changer de discours. Des
propos maladroits ont été tenus par les adultes, comme : «Pourquoi ne pas porter un jean et un
haut, comme les autres filles? Et puis tout ce noir!» À quoi la lycéenne a rétorqué avec justesse
: «Ah, c’est la couleur qui vous gêne, maintenant ? » Touché. Les élèves militants ne vous
ratent jamais quand vous n’êtes pas préparés. Et nous ne l’étions pas. La proviseure adjointe
de l’époque a abordé cette convocation comme une formalité. Au milieu de mille priorités, elle et
la CPE ont mené l’entretien dès qu’elles ont trouvé un moment, sans imaginer un instant les
conséquences. La loi sur les signes religieux est plutôt bien respectée quand on la fait appliquer
avec fermeté et bienveillance. Mais cette fois, rien ne s’est passé comme prévu. L’affaire a pris
des proportions énormes.
Quatre jours après la convocation, un homme accompagnant la mère de « mon » élève
débarque au lycée. Il se présente comme l’oncle de la jeune fille, et exige de rencontrer la
proviseure sur-le-champ. Il vocifère tant qu’il finit par obtenir gain de cause, en dépit de la règle
selon laquelle on n’est reçu que sur rendez-vous. D’un ton menaçant, il aurait accusé le lycée
de vouloir célébrer l’anniversaire d’une loi liberticide, celle de mars 2004. Nous apprenons qu’il
est membre du collectif Cheikh Yassine (CCY), un groupe ultrareligieux connu pour ses
manifestations violentes en janvier 2010 contre l’imam de Drancy, Hassen Chalghoumi. Et nous
sommes les prochaines cibles sur la liste.
MENACES DE MORT
Dès le lendemain, tout s’emballe. Ce collectif poste sur son site sa version de l’affaire: inouïe,
partiale et truffée d’éléments erronés. Ce récit se répand à la vitesse de l’éclair dans
l’établissement. Une page Facebook « Entraide filles de Blanqui» est même créée. Deux jours
plus tard, environ soixante-dix jeunes (dont quelques garçons) se présentent en classe vêtus,
pour certains d’une abaya, d’autres d’une djellaba, parfois unie, souvent imprimée – ce qui
illustre bien la confusion. Il y avait même une djellaba léopard qui m’avait beaucoup plu.
L’après-midi même, un second groupuscule salafiste, Forsane Alizza, tente d’organiser un
happening devant le lycée en accrochant une banderole « Islamophobe [sic] ON EST LA [sic] ».
Avec leurs barbes, ils ont surtout fait peur aux jeunes. Mais la blogosphère bout toujours de
mensonges sur l’établissement, et des menaces de mort commencent à être proférées contre la
direction et les conseillers d’éducation.
Des plaintes sont déposées. Dans mes classes, j’en discute, je prends le temps d’écouter les
griefs des élèves, d’expliquer pourquoi cette tenue n’a pas sa place à l’école, et je réponds aux
accusations de racisme et d’«islamophobie». Les débats se passent plutôt bien, et celles et
ceux qui portaient une robe en soutien aux jeunes filles l’enlèvent. Mais je ressens le besoin de
m’armer intellectuellement.
Qui prescrit cette tenue? Comment s’appelle-t-elle en réalité ? Mes recherches en bibliothèque
me font découvrir les mots « abaya », « jilbab », « khimar », autant de vêtements couvrants
destinés à respecter les prescriptions religieuses de « savants » du wahhabisme d’Arabie
saoudite. Puis je surfe sur Internet, sur les sites qui vendent ces articles. Je ne suis pas
déçue… On trouve, comme aujourd’hui, à peu près les mêmes arguments de vente. Neyssa
Shop est l’un des plus clairs: « On dit que l’abaya est tout simplement l’extension du hijab 2. » «
Abaya et jilbeb sont deux ensembles spécifiques. Ils partagent tout de même un point commun
qui est celui d’offrir la possibilité à la femme musulmane de se cacher du regard des hommes. »
Mes ados le voient bien ainsi. Certaines me prêtent même main-forte. L’une d’elles m’apporte
Ma sœur, voilà comment Allah et son Messager veulent que tu sois !, un ouvrage de Cheikh
‘Amr’ Abd Al Mun’im Salim, emprunté à son père. Il détaille les prescriptions: couvrir l’ensemble
du corps, ne comporter aucun ornement, ni boutons, ni dentelles, ni broderies, ne pas
ressembler aux vêtements des hommes ni à ceux des «non-musulmanes». Quand les
journalistes déboulent devant le lycée, ce qui ne tarde pas, ils reprennent immédiatement, et
unanimement, la version des jeunes filles, qui entre-temps a totalement changé: cette tenue
serait purement culturelle. Mon élève a même déclaré à la télévision qu’elle avait choisi cette
robe car le noir l’amincissait.
UNE GUERRE QU’ILS ONT GAGNÉE À L’USURE
La situation devient intenable, y compris en salle des profs. Certains collègues, peu nombreux,
soutiennent que l’abaya n’est pas religieuse. Un plus grand nombre admet le caractère religieux
ostensible, mais estime qu’on en a déjà assez fait avec l’interdiction du voile. D’autres enfin,
majoritaires, pensent qu’il y a des combats plus importants à mener. La digue ne demande qu’à
céder.
Galvanisés par la médiatisation, les auteurs des menaces s’en prennent à celles qui ont
renoncé à soutenir les porteuses d’abaya. Un soir, vers 23 heures, une jeune fille de première
me téléphone: «Madame, il y a quelqu’un qui m’a appelée. C’était un adulte. Il m’a parlé en
arabe, je n’ai pas compris, puis il a dit : “Ne viens pas au lycée demain, tu n’entreras pas.” »
C’est du vent, bien sûr, mais mon élève est terrifiée. Face à cette extrême tension, quelques
professeurs, une minorité, décident d’adresser un courrier au rectorat, qui soutient les
personnels du lycée menacés, pour lui demander une position claire. La directrice de cabinet du
recteur finit par nous recevoir. Une bonne heure de langue de bois nous invitant… à nous
débrouiller. La seule solution, nous suggère-t-on, serait d’exclure les dix jeunes filles en conseil
de discipline. Nous ne voulons pas en arriver là. Ce serait un échec. Et puis il reste les
menaces de mort, nombreuses. Je ne suis pas rassurée. Mon élève a déjà fait circuler mon
nom sur les réseaux pour avoir été la première à lui parler de son abaya. Que m’arrivera-t-il si
nous l’excluons? On nous propose de délocaliser le conseil de discipline, dont je suis membre.
Mais les lycéennes pourront faire appel. Le rectorat nous soutiendra-t-il jusqu’au bout? La
réponse de la directrice de cabinet n’invite guère au courage: «Ah, moi, je ne peux rien vous
promettre.» C’est ainsi que l’affaire s’est conclue. Temporairement.
Nous sommes tous partis en vacances, les islamistes aussi. À la rentrée, les jeunes filles ont
continué à venir en abaya en nombre identique. La situation s’est enkystée au fil des années.
Une guerre gagnée à l’usure. Lorsque nous abordons la loi sur les signes religieux en classe,
certains, ne s’y trompant pas, demandent pourquoi les « robes » (dont ils ne connaissent
souvent pas le nom) sont autorisées et pas le voile. Nous ne savons plus quoi leur répondre…
De fait, laisser les abayas entrer à l’école introduit une inégalité entre les élèves qui respectent
la loi et une petite minorité qui s’en dispense. Insupportable.
J’étais en proie à cette colère lorsqu’est arrivé le 16 octobre 2020. Deux jours après la
décapitation de Samuel Paty, un journaliste m’apprend que l’homme ayant agité la meute
contre l’enseignant, Abdelhakim Sefrioui, n’est autre que celui qui était venu vociférer au lycée
neuf ans auparavant. Celui là-même qui a divulgué mon nom et celui de mes collègues sur ses
réseaux. Celui à qui nous devons tous nos ennuis de 2011. Ma colère décuple… Il aurait pu
nous arriver la même chose. Je ne pense plus qu’à cela. Je ressasse les discours qui nous ont
été opposés à l’époque, au rectorat ou en salle des profs. Pas de vague. Ce choix de ne rien
faire. Ne pas parler du problème, espérer qu’il s’en aille tout seul. Voilà le résultat.
Douze ans après la première crise des abayas, la mode n’est pas passée. Au contraire, depuis
que des « Tiktokeurs » soufflent sur les braises, elle s’est propagée. Dans mon lycée, elles
étaient dix en 2011. Aujourd’hui, j’en compte une par classe. On nous dit qu’un nombre infime
d’établissements serait concerné et qu’il faut parler des vrais sujets. Mais l’abaya n’est pas un
faux problème, même s’il est loin d’être le seul. On nous explique qu’elle ne mérite pas une
rentrée politique. C’est vrai. Mais qui en fait le sujet central ? Gabriel Attal, qui choisit de
l’évoquer au Journal de 20 heures de TF1, ou ceux qui commentent la décision pour s’en
indigner et menacent de déposer un recours devant le Conseil d’État? Combien d’années
fallait-il nous laisser réduits à l’impuissance? À l’heure où nous bouclons ces lignes, grâce à
cette règle claire, le personnel a su comment agir et la rentrée se passe plutôt bien dans mon
lycée.
Tant mieux. Car l’esprit même de résistance laïque s’épuise en réalité… La plupart de mes
nouveaux collègues, enfants de leur génération, parfois issus de mouvements politiques de
gauche qui combattent désormais ces lois, se désintéressent de la question laïque, dans le
meilleur des cas, ou sont parfois carrément opposés à la loi de 2004. Si je suis convaincue,
chaque jour davantage, que la laïcité est la meilleure des protections pour l’école, nous
sommes de moins en moins à le penser. Voilà pourquoi la décision du ministre de l’Éducation
nationale était nécessaire. Il fallait clarifier la règle pour nous permettre de parler des autres
sujets: le manque d’enseignants, l’absurdité de Parcoursup, les inégalités, et pourquoi pas,
rêvons un peu, l’arrêt du financement de l’enseignement privé par l’État. Les dinosaures que
nous sommes utiliseront leurs forces, celles qui leur restent, pour mener ces combats. ■0
1. BFMTV, Direct, 28 août 2023.
2.
https://neyssa-shop.com/blog/quelle-est ... un-jilbab/
3. France Inter, matinale du 29 août 2023.
L’esprit même de résistance s’épuise *…
BIO EXPRESS
Sophie Mazet, née en 1980, normalienne, agrégée d’anglais, est professeure au lycée
Auguste-Blanqui de Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis, depuis 2007. Entre 2011 et
2021, elle y anime un atelier d’« autodéfense intellectuelle » qui lui vaudra les Palmes
académiques. Elle a publié trois livres : Manuel d’autodéfense intellectuelle (2015),
Prof, les joies du métier (2017) et Autodéfense intellectuelle, le retour (2020), tous édités chez Robert Laffont

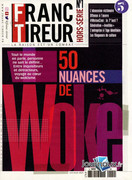

 praedicator veridicus, inquisitor intrepidus, doctor egregius
praedicator veridicus, inquisitor intrepidus, doctor egregius