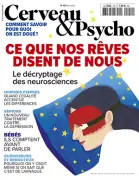Extrait de la "chose"...
...Le deuxième chapitre est consacré aux dérives de la science quand l’imaginaire scientifique sert un scientisme qui prétend interpréter le Réel de la subjectivité. S. Calmette remarque à quel point l’enfant est d’une logique imparable quand il s’agit de compter et de mesurer ce qui l’entoure : il semble même prédisposé à l’EBM et il y a pour certains d’entre eux un amour exclusif des sciences comme pour mieux maîtriser un certain réel, éventuellement angoissant. 1 - Elle rappelle aussi que le choix de la nomination d’un trouble n’est pas anodin, exemple à l’appui avec le TDAH et les troubles neuro- développementaux appelé depuis peu TND. L’auteure note aussi comment au nom d’un principe de prévention l’écart à la norme va fixer ainsi les limites du normal et du pathologique. Ce qui peut légitimement nous inquiéter car c’est un mésusage de la science ! T. Florentin s’interroge sur les progrès de la science, ce qui mène la danse de ses avancées (l’exemple de l’impact factor) et du prix à payer pour la civilisation. J. Garrabé dresse une histoire des classifications en psychiatrie en s’attachant avec précision à l’émergence de certains mots. Il rappelle que la psychiatrie est issue à la fois des sciences du vivant et de celles de l’esprit et par conséquent l’objet de son étude que sont les maladies mentales relève d’éléments de deux natures différentes. J.-J. Tyszler met en exergue la fragilité de la pédopsychiatrie dont le champ s’est avéré, ces dernières années, beaucoup plus poreux au biologisme ambiant que celui de la psychiatrie de l’adulte. Là encore, le choix des mots et des nominations ont toute leur importance puisque celles-ci conditionnent les orientations et le déploiement d’un système de soins dans lequel le praticien a de moins en moins son mot à dire....
Autre extrait...
... 2 - Le Réel de la science et le Réel de la psychanalyse viendrait à se rencontrer et dans un même temps à se disjoindre, ce qui provoque pour le moins la surprise. Je retiens aussi cette question instructive concernant la psychanalyse et que Freud reconnaissait comme incontournable : le mystère n’est pas l’inconscient mais la conscience. L. Sciara introduit la question de l’invariance qui permet de saisir la structure. La clinique psychanalytique se fonde sur ces invariants qui reposent sur des faits langagiers, c’est-à-dire le réel de la clinique. J.-L. Chassaing rappelle que si psychanalyse et science se ressemblent, l’écriture scientifique forclot la vérité comme cause. Si l’on peut reconnaître une certaine réussite des sciences cognitives, elle repose essentiellement sur un discours biologisant et l’imagerie médicale, ce qu’Henri Atlan assimile à des tentatives de naturalisation de l’esprit et une façon de prendre ses désirs pour des réalités (whishfull thinking). M. Darmon conclut cette partie en reprenant un écrit du mathématicien Gödel où il est question de la démonstration de l’existence de Dieu ; Gödel est l’auteur du théorème sur l’incomplétude. Cette nouvelle écriture s’est accompagnée, comme souvent après leur découverte chez les mathématiciens, d’un vide dans l’Autre que Gödel s’est efforcé de boucher.
Alors y aurait-il deux Réels, celui de la science et celui de la psychanalyse ? Partant de ce que dit Lacan dans RSI sur le modèle mathématique, P.-C. Cathelineau souligne que l’écriture mathématique qui le constitue ne lui confère pas un caractère pour autant symbolique, mais sa dimension de supposition à propos du Réel le situe dans l’Imaginaire car au fond il n’approche un Réel, au demeurant inaccessible, qu’à travers sa doublure, que Lacan appelle substance. C’est l’imaginaire de la représentation qui filtre la relation du savant au Réel. Il précise que cette prise en compte du réel de la structure d’un sujet n’est liée qu’à sa singularité, contrairement à une écriture scientifique. 3 - J’ai trouvé éclairant qu’il souligne que le réel en psychanalyse puisse faire l’objet d’une écriture pour cerner au plus près ce qu’il en est d’un impossible pour un sujet, en parant aux effets de l’imaginaire du sens, ce dont nous sommes souvent abreuvés dans une forme de psychologisation de l’histoire du sujet dans la clinique.
H. Ricard s’est intéressé au terme de croyance en se demandant s’il pouvait englober la connaissance scientifique. Il explore un parcours entre relativisme d’un côté qui dissout toute référence à une vérité, y compris scientifique, et scientisme qui scinde nettement science
et croyance. 4 - Le temps logique et l’assertion de certitude anticipée, fameux texte de Lacan écrit dans une première version en 1945, sert de support à la thèse de T. Tazdaït, scientifique de renom, pour affirmer que Lacan est un précurseur de l’usage de la théorie des jeux, avec son raisonnement original par la notion de connaissance commune qui permet de démontrer que le collectif n’est rien que le sujet de l’individuel.
Il n'y a pas besoin d'être grand clerc pour détecter très vite que nous avons affaire à un bon exemple de pur foutage de gueule. C'est d'autre part d'une prétention...
Je défie quiconque de trouver un sens à ce charabia abscons.
Lacan fut un escroc intellectuel, un charlatan identifié comme tel. Est-ce bien sérieux de revendiquer ses "approches"?
Je me demande si certains des auteurs ont bien conscience de leur abrutissement. Ils ne sont pas là pour communiquer mais pour s'écouter parler. C'est impressionnant. Dans tes propos, tu reconnais que ces écrits dépassent ton entendement.
Sophie Robert a publié un livre au titre explicite: "La psychanalyse est-elle une secte".
Quand on lit ce genre de discours, on ne peut que constater qu'on se trouve face à des discours empreints de pensée magique, comme ceux couramment pratiqués dans les mouvements sectaires. Leur caractéristique commune est qu'ils ne sont jamais clairs, mais toujours sybillins, avec un contenu ésotérique que seuls les "initiés" pourraient comprendre.
Une secte avec ses gourous et ses captifs... Pas étonnant que ce qui relève de la science est soigneusement démoli, et pour cause. La science, tend vers la lucidité, la clarté, l'explicite, la critique.
Entre de telles mains, le consultant ne peut pas en sortir indemne, ce n'est pas possible. Il faut avoir un grain ou avoir décidé d'en terminer avec son existence pour rencontrer ce genre d'énergumènes.
En conclusion, le réel psychanalytique n'existe pas. Et ce n'est pas avec ce genre de foutaises purement rhétoriques (aucune preuve, aucune démonstration, mais une enfilade de mots...) que ça risque de changer.
Pourquoi pas le réel lacanien aussi, tant qu'on y est, avec brevet déposé?
Les phrases en gras précisent sans équivoque à qui on a exactement affaire et ce qu'on peut redouter comme obscurantisme.
La question que tu dois te poser, Richard, est la suivante: "Ai-je besoin de lucidité, de clarté, ou est-ce que je privilégie l'obscurantisme parce qu'il me permet de fuir, sans avoir à affronter ni assumer la réalité?"