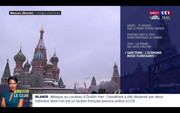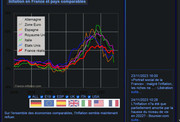Gwanelle a écrit : 20 nov. 2023, 09:47
Une deuxième raison, c'est la suspicion des autorités allemandes envers tous les scientifiques ne pratiquant pas une physique "allemande" .
Un "bon" physicien allemand (au yeux des autorités) devait être critique de la relativité et de la mécanique quantique (!)
Heisenberg a failli partir en camps à cause de ça, et a été réhabilité de justesse par Himmler.
Par ailleurs, les historiens n'ont pas réussis à déterminer si, dans le cas de Heisenberg, l'erreur de conception neutrons lents/neutrons rapide, était involontaire ou volontaire (Décidemment Heisenberg est aussi indéterminé que son principe ^^)
Merci pour cet apport et ces rappels.
Le sujet est si vaste qu'on pourrait y passer une bonne partie de son existence, surtout depuis l'ouverture de beaucoup d'archives jusque là tenues secrètes ou à accès réservé.
Il existe indéniablement un "mystère" Heisenberg qu'il est devenu très difficile de cerner puisqu'il recouvre plusieurs périodes déterminantes où les circonstances historiques particulières (avant-guerre, durable conflit, après-guerre) ont influencé indéniablement le parcours de ce chercheur qui est resté très discret y compris dans sa correspondance.
Un article qui résume quelques points de vue:
https://www.slate.fr/story/129797/scien ... quer-bombe
C'est l'une des raisons qui vont m'inciter à lire l'ouvrage "Oppenheimer" que j'ai cité parce que le sujet et l'époque me passionnent.
Trouverai-je ou pas quelques éléments de réponse à mes interrogations ? Là réside encore un beau principe d'incertitude...

Autre article, celui du CRIF, au sujet du film "Oppenheimer":
https://www.crif.org/fr/content/le-bill ... les-autres
...Robert Oppenheimer, physicien théoricien réputé, dont le père, immigrant juif prussien avait eu une « success story » remarquable aux États-Unis, devint le Directeur de Los Alamos et fut le père indiscuté de la bombe atomique, énorme succès scientifique et énorme dilemme moral. « Nous sommes tous désormais des fils de putes » avait dit à Oppenheimer Kenneth Bainbridge, le responsable de la mise en place et de la réussite technique de Trinity Test, la première explosion atomique de l’histoire, le 16 juillet 1945.
La bombe atomique a été lancée sur le Japon, mais les recherches et les investissements américaines sur le sujet ont commencé dans l’angoisse que les Nazis ne développent cette arme les premiers. En 1945, les équipes de Alsos, groupe d’enquêtes du Projet Manhattan sur le développement scientifique allemand, ont découvert que les spécialistes allemands étaient très en retard. Ils n’avaient pas bénéficié d’un financement et d’une organisation comparables au Projet Manhattan, mais c’était peut-être aussi parce que les physiciens juifs qui avaient dû fuir l’Allemagne et ses alliés n’avaient pas été remplacés. Le responsable scientifique de Alsos était Samuel Goudsmit, physicien juif d’origine néerlandaise, célèbre pour avoir proposé le concept de spin électronique. Ses parents furent gazés à Auschwitz.
Après la guerre, le bruit s’est répandu de la bombe atomique comme d’une arme juive, ce qui est évidemment très largement exagéré : Bainbridge était loin d’être le seul des physiciens non juifs de Los Alamos, mais il n’en reste pas moins que pendant les combats autour de la citadelle de Safed, en mai 1948, la détonation d’un nouveau mortier particulièrement bruyant, la célèbre Davidka, a entraîné une débandade de la garnison arabe, convaincue que les Juifs envoyaient une nouvelle bombe atomique.
La plupart des physiciens juifs ayant contribué de près ou de loin au projet Manhattan s’étaient formés en Europe. L’antisémitisme n’épargnait pas l’Université américaine. Ainsi, le jeune Richard Feynman, future star de la physique quantique, avait eu du mal à être admis à Princeton malgré ses notes exceptionnelles.
Dans le film, un ami d’Oppenheimer lui reproche de ne rien connaître au judaïsme, venant d’une famille juive très assimilée. Cet homme, c’est Isidore Isaac Rabi, Prix Nobel de physique en 1944, auquel nous sommes redevables de l’IRM. Peu de ses collègues portaient comme lui leur judaïsme en bandoulière, et plusieurs étaient d’ailleurs convertis. Mais tous savaient que leurs familles européennes faisaient face à la mort.
Hans Bethe, chef de la section théorique à Los Alamos et futur Prix Nobel, avait une mère juive et un père pasteur, et c’est sa mère qui lui avait interdit d’épouser une jeune fille juive.
Il y avait aussi des Juifs hongrois, qu’on appelait « Martiens », en raison de la bizarrerie de leur langue natale et de leur exceptionnel niveau intellectuel. Parmi eux, John von Neumann, qui au cours d’une brève présence à Los Alamos donna une solution au mécanisme d’implosion utilisé pour la bombe au plutonium et qui est souvent considéré comme le cerveau le plus brillant de son époque, Edward Teller, partisan de la fusion, qui aboutit à la bombe H et devint l’ennemi de Oppenheimer, thème majeur du film. Eugene Wigner, autre futur Prix Nobel et Leo Szilard, qui développa le concept clé de réaction en chaîne, ont fait signer par Einstein une lettre prémonitoire au Président Roosevelt en août 1939.
Au début de cette année-là, Lise Meitner, physicienne juive d’origine viennoise, réfugiée en Suède, qui avait gardé le contact avec son ancien associé de Berlin, le chimiste Otto Hahn, avait appris que en bombardant de l’uranium avec des neutrons, il avait sans le vouloir produit des éléments chimiques plus légers. Elle avait calculé qu’une telle réaction produisait une perte de masse et par conséquent un dégagement d’énergie. Cette conclusion fit sensation dans le monde de la physique moderne. En France, elle conduisit Joliot Curie et son équipe à travailler à la réaction en chaîne et les neutrons ralentis à l’eau lourde, aux États-Unis, elle aboutit à la lettre de Einstein à Roosevelt, qui n’y fut pas indifférent.
Au cours de la guerre, les Britanniques informèrent leurs alliés Américains des résultats de leurs propres chercheurs. Parmi eux, deux physiciens juifs allemands, Otto Frisch, neveu de Lise Meitner et Rudolf Peierls, avaient démontré que la masse critique d’uranium nécessaire à une bombe était suffisamment faible pour être transportée par avion. Ce fut le coup d’envoi du Projet Manhattan. En décembre 42, eut lieu à Chicago la première réaction en chaîne expérimentale soutenue, contrôlée avec des plaques de modérateur en graphite, la première pile donc, succès majeur de l’équipe Fermi Szilard. Enrico Fermi, déjà Prix Nobel, avait quitté l’Italie fasciste parce que son épouse était juive.
Einstein ne joua pas de rôle dans le projet Manhattan en dehors de la lettre à Roosevelt, mais sa célèbre formule E=mc2 établie près de quarante ans auparavant, était à la base de tous ces développements.
Plus actif en revanche fut Niels Bohr de Copenhague, celui que beaucoup de jeunes physiciens européens considéraient comme leur maître, et dont la mère était juive.
Bohr fut non seulement un physicien de génie, un chef d’école, un penseur éminent qui a soutenu contre Einstein une interprétation de la réalité physique largement partagée aujourd’hui (l’hypothèse de Copenhague), mais un homme remarquable. Lorsque les Allemands, en automne 43, ont décrété la loi martiale au Danemark, il fut exfiltré en Suède où il a usé de son prestige pour que ce pays neutre accueille tous les Juifs du Danemark que la résistance parvint à transférer dans les ports de pêche danois.
Le 1er septembre 1939, jour du début de la guerre, c’est un article signé par Niels Bohr qui avait montré que la réaction en chaîne était liée à l’isotope 235 de l’Uranium, présent en quantité minuscule dans l’Uranium naturel. D’où les contraintes d’enrichissement, domaine bien d’actualité quand on pense à l’Iran.
Un disciple de Bohr mondialement célèbre s’appelait Werner Heisenberg. Il devint chef du programme nucléaire allemand, et les responsables du Projet Manhattan redoutaient son génie.
Heisenberg, qui avait parlé à Bohr à Copenhague en 1941 dans une rencontre mythique et mystérieuse dont Bohr sortit écœuré, prétendit après la guerre qu’il avait tout fait pour ralentir la recherche sur la bombe. Il resta un monument respecté de la physique, un président du CERN et des livres firent l’éloge de son attitude. On sait aujourd’hui que ce sont des mensonges. Heisenberg a fait ce qu’il a pu et, heureusement, il a échoué.
Il méprisait Hitler, n’était apparemment pas antisémite ; il était attaqué par les physiciens nazis les plus fanatiques pour avoir été un complice de la « physique juive », mais il s’est adapté à l’idéologie d’un régime qui prônait la grandeur de l’Allemagne, la lutte contre le bolchévisme et lui assurait une place digne de lui en matière scientifique. L’extermination des Juifs n’était qu’une désagréable occurrence d’importance secondaire sur laquelle il ne s’est jamais étendu.
Au fond, un comportement banal, par un homme doté de dons exceptionnels.
À méditer…
Richard Prasquier, Président d’honneur du Crif
- Les opinions exprimées dans les billets de blog n'engagent que leurs auteur
Le projet Manhattan, une conjonction d'individus talentueux, de très haut niveau.
@ Aggée
L'article du Crif apporte des précisions aux propos que tu as émis.
@ Christian
Excellent le documentaite de Mathador.
@ Gwanelle
La remarque qu sujet de la position de Werner Heisenberg est très courte dans l'article du Crif, son auteur reste prudent et mesuré.
Il faut se remettre en mémoire que l'après-guerre fut une période compliquée, trouble. Beaucoup de personnes ont voulu tourner la page, dans les deux camps. La parole des rescapés, des survivants, des exactions nazies, fut peu écoutée, et peu prise en considération. Primo Levi en a fait l'expérience en 1947, avec son ouvrage "Si c'est un homme", un écrit incontournable, qui ne fut reconnu pour sa valeur que longtemps après.
Simone Veil, Ginette Kolinka, pour ne citer qu'elles furent confrontées à une période qui ressemblait à une sorte d'amnésie collective.
Ce n'est qu'au cours des années 70 qu'on commença à s'intéresser en profondeur au nazisme, à son rayonnement, à ses conséquences.
Beate et Serge Klarsfield, Simon Wisenthal,... en furent les premiers artisans.
Werner Heisenberg est décédé en 1976, peut-être trop tôt pour être interrogé en profondeur sur cette période et sur son rôle.
...Au service de la propagande nazie
Cependant, entre 1941 et 1944, Heisenberg participe à plusieurs voyages de propagande nazie en Hongrie, au Danemark, aux Pays-Bas et en Pologne, dans le rôle d'éminence culturelle, accompagné par des officiels du parti nazi et célébré par les autorités militaires d'occupation, pour gagner les élites locales à la collaboration20. Et lors de ses entretiens avec Niels Bohr à Copenhague en septembre 1941, il lui dit sa « ferme conviction que l'Allemagne gagnera la guerre et que nous étions fous d'espérer (sa défaite) et de refuser la collaboration », et lui donne la nette impression que « sous (sa) direction, tout était fait en Allemagne pour fabriquer l'arme nucléaire »21. Cette réunion jette un froid entre Heisenberg et Bohr, lequel est exfiltré peu de jours après22 vers la Suède puis l'Angleterre et de là aux États-Unis à Los Alamos.
En 1943, Heisenberg se rend aux Pays-Bas où il confie qu'une victoire de l'Allemagne serait un moindre mal23. En Pologne occupée, dirigée par Hans Frank, un ami d'enfance, il prononce un discours réservé aux Allemands24.
Implication dans le projet de bombe atomique sous Hitler
Après la guerre, Heisenberg se présente comme un savant capable de construire la bombe mais qui a refusé de le faire pour ne pas servir Hitler. Cette vision des faits a été défendue par l'écrivain allemand Robert Jungk en 1957 dans son livre Plus clair que mille soleils. Heisenberg et Jungk expliquaient que Bohr avait mal interprété les paroles du savant allemand.
Mais, trente ans plus tard, en 1990, Jungk s'est rétracté, accusant un collègue de Heisenberg, von Weizsäcker, de l'avoir trompé, et accusant Heisenberg de l'avoir trompé également25.
Il fallut attendre les années 1990 pour que soient publiées par l'Institut Niels Bohr de Copenhague des lettres que Bohr écrivit à Heisenberg dans les années 1950 et 1960, sans se résoudre à les envoyer21,26. Dans celles-ci, Bohr précise que Heisenberg, lors de leur rencontre en 1941, n'exprime aucun scrupule moral concernant le projet allemand de bombe atomique, lui a dit avoir passé les années précédentes à travailler sur ce projet, et être convaincu qu'elle déciderait de l'issue de la guerre.
De nombreux historiens des sciences prennent ces documents comme une preuve de l'implication de Heisenberg dans le programme allemand, en dépit de ses dénégations postérieures. Pour le physicien Samuel Goudsmit (Alsos Mission, 1947) et les historiens David Cassidy (Uncertainty : the life and science of Werner Heisenberg, 1992), Paul Lawrence Rose (Heisenberg and the Nazi atomic bomb project, 1998) et le physicien Jeremy Bernstein (Hitler's uranium club : the secret recordings at Farm Hall, 2001), Heisenberg était dans l'impossibilité matérielle de faire la bombe (par manque de moyens et par une approche théorique inadéquate) mais il l'aurait certainement produite s'il avait pu car il le désirait ardemment ; c'est également l'avis du physicien du CNRS Sébastien Balibar, qui réfute aussi l'idée que Heisenberg ait voulu cacher aux nazis la possibilité de construire des armes nucléaires27.
De son côté, l'historien Mark Walker ne croit pas aux affirmations faites par Heisenberg après la guerre, qui prétendait que lui et ses collègues avaient gardé le contrôle de la recherche, qu'ils avaient reçu l'ordre de ne développer que les applications pacifiques, et que la question morale avait dominé leur pensée. Au contraire, Walker analyse comment les physiciens allemands ont réussi après guerre à éviter la purge, et le rôle prépondérant d'Heisenberg28.
Cependant, pour le journaliste Thomas Powers (Le mystère Heisenberg, 1992) et le dramaturge Michael Frayn (Copenhague, 1998), qui reprennent ses déclarations, Heisenberg aurait pu fabriquer la bombe mais, par bonté d'âme, a refusé de le faire.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Werner_Heisenberg