Dominique18 a écrit : ↑14 déc. 2020, 19:54
.. sachant que le conscient ne sert que d'alibi à l'inconscient...pfffff...
Peux-tu développer? Je pourrais comprendre si je rentre en surfusion mais je suis fatigué en ce moment. Donc, si tu peux allonger ton propos, ça m'aiderait à te lire. Merci.
Volontiers.
Je reprends la proposition d'Henri Laborit, qui figure dans le film "Mon oncle d'Amérique".
Je n'ai toujours pas trouvé mieux.
"...Il y a un premier cerveau que MacLean a appelé le cerveau reptilien. C'est celui des reptiles, en effet, et qui déclenche les comportements de survie immédiate sans quoi l'animal ne pourrait pas survivre : boire, manger — qui lui permet de maintenir sa structure — et copuler — qui lui permet de se reproduire. Et puis, dès qu'on arrive aux mammifères, un second cerveau s'ajoute au premier. Et d'habitude on dit, avec MacLean encore, que c'est le cerveau de l'affectivité. Je préfère dire que c'est le cerveau de la mémoire. Sans mémoire de ce qui est agréable, de ce qui est désagréable, il n'est pas question d'être heureux, triste, angoissé ; il n'est pas question d'être en colère ou d'être amoureux. On pourrait presque dire qu'un être vivant est une mémoire qui agit. Et puis un troisième cerveau s'ajoute aux deux premiers. On l'appelle le cortex cérébral. Chez l'homme, il a pris un développement considérable. On l'appelle un cortex associatif. Ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il associe. Il associe les voies nerveuses sous-jacentes et qui ont gardé la trace des expériences passées ; il les associe d'une façon différente de celles où elles ont été impressionnées par l'environnement au moment même de l'expérience. C'est-à-dire qu'il va pouvoir créer, réaliser un processus imaginaire. Dans le cerveau de l'homme, ces trois cerveaux superposés existent toujours. Nos pulsions sont toujours celles très primitives du cerveau reptilien.
Ces trois étages du cerveau devront fonctionner ensemble. Et, pour ce faire, ils vont être reliés par des faisceaux. L'un, on peut l'appeler le faisceau de la récompense, l'autre, on peut l'appeler celui de la punition. C'est lui qui va déboucher sur la fuite et la lutte. Un autre encore est celui qui va aboutir à l'inhibition de l'action. Par exemple, la caresse d'une mère à son enfant, la décoration qui va flatter le narcissisme d'un guerrier, les applaudissements qui vont accompagner la tirade d'un acteur, et bien tout cela libère des substances chimiques dans le faisceau de la récompense et aboutira au plaisir de celui qui en est l'objet.
J'ai parlé de la mémoire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, au début de l'existence, le cerveau est encore, disons, immature. Donc, dans les deux ou trois premières années de la vie d'un homme, l'expérience qu'il aura du milieu qui l'entoure sera indélébile et constituera quelque chose de considérable pour l'évolution de son comportement dans toute son existence. Et finalement, nous devons nous rendre compte que ce qui pénètre dans notre système nerveux depuis la naissance, et peut-être avant, in utero, les stimulus qui vont pénétrer dans notre système nerveux nous viennent essentiellement des autres ; et que nous ne sommes que les autres. Quand nous mourons, c'est les autres que nous avons intériorisés dans notre système nerveux, qui nous ont construits, qui ont construit notre cerveau — qui l'ont rempli — qui vont mourir.
Ainsi nos trois cerveaux sont là. Les deux premiers fonctionnent de façon inconsciente. Nous ne savons pas ce qu'ils nous font faire : pulsions, automatismes culturels. Et le troisième nous fournit un langage explicatif qui donne toujours une excuse, un alibi, au fonctionnement inconscient des deux premiers. Je crois qu'il faut se représenter l'inconscient comme une mer profonde et ce que nous appelons le conscient, comme l'écume qui naît, qui disparaît, renaît à la crête des vagues. C'est la partie très très superficielle de cet océan qui est écorchée par le vent.
On peut donc distinguer quatre types principaux de comportements :
1. Comportement de consommation, qui assouvit les besoins fondamentaux.
2. Comportement de gratification : quand on a l'expérience d'une action qui aboutit au plaisir, on essaie de la renouveler.
3. Comportement qui répond à la punition : soit par la fuite qui l'évite , soit par la lutte qui détruit le sujet de l'agression.
4. Comportement d'inhibition : on ne bouge plus, on attend en tension, et on débouche sur l'angoisse. L'angoisse c'est l'impossibilité de dominer une situation.
Le concept de Mac Lean est remis en cause, heureusement, ce n'est qu'un concept scientifique:
https://lecerveau.mcgill.ca/flash/capsu ... ortier.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9o ... _triunique
Ce qu'il faut retenir, ce sont les idées générales. Il est bien évident que depuis Laborit, on a fait des progrès depuis. La neuro-imagerie a permis des investigations qui se sont traduites par des avancées spectaculaires.
Il devient de plus en plus difficile de défendre des concepts qui reposent sur du langage, et non sur des bases scientifiques, observables.
Les chercheurs s'aperçoivent par exemple que le subsconscient n'est peut-être pas celui que l'on croyait. On a approché, par intuition, certaines notions. Intuition n'est pas science.
Les dernières nouvelles:
https://www.cerveauetpsycho.fr/sd/neuro ... -15883.php
https://www.cerveauetpsycho.fr/sd/neuro ... -15879.php
...Selon le neuroscientifique et psychanalyste sud-africain Mark Solms, la conscience apparaît dans toutes les situations où les prédictions de notre cerveau se révèlent erronées. Il s'agit alors de cet état de surprise qui se manifeste quand les prédictions implicites du cerveau tombent dans le vide. Et nos cellules nerveuses font tout pour éviter ce type de fautes. Contrairement à ce que postulait Freud, notre esprit ne tendrait pas vers plus de conscience, mais s'efforcerait de limiter cette dernière. Le cerveau souhaiterait autant que possible qu'il ne se passe rien d'imprévu. « L'uniformité totale est plus utile à la survie que la conscience qui pompe de l'énergie et du temps », selon Solms...
...a exprimé ses idées en 2018 dans un article cosigné avec Karl Friston, de l'University College de Londres. Friston est aujourd'hui, d'après la revue Science, le neuroscientifique vivant le plus cité. Il a été impliqué dans la mise au point de la plupart des techniques d'imagerie cérébrale qui ont installé les neurosciences dans la position influente qu'on leur connaît aujourd'hui. Il y a une dizaine d'années, Friston a proposé le principe d'énergie libre, une version mathématique de la théorie du cerveau prédicteur. Le terme d'énergie libre est une autre façon de nommer ce dont il était question plus haut, à savoir les moments où les prédictions du cerveau sont déjouées, ou encore les moments de surprise, ou plus simplement, de conscience. Des événements que notre cerveau s'efforcerait de maintenir aussi rares que possible...
...Nos expériences subjectives semblent d'une certaine façon indépendantes de la machinerie du cerveau, mais la conscience qui paraît planer au-dessus de toute chose est en fait étroitement couplée à des processus neuronaux automatiques. Vers où se porte votre attention, quels souvenirs ou idées vous viennent, comment vous percevez les personnes autour de vous, ce que vous parvenez à filtrer au milieu du flux de vos impressions, la façon dont vous les interprétez et les buts que vous poursuivez – tout cela résulte de processus automatiques. Le philosophe Arthur Schopenhauer (1788-1860) l'a formulé dans un de ses aphorismes : « L'homme peut bien faire tout ce qu'il veut, il ne peut pas vouloir ce qu'il veut. »
Timothy Wilson, de l'université de Virginie, voit là le prix que nous avons à payer pour avoir reçu de l'évolution un inconscient aussi efficace. Si nous devions toujours réfléchir pour être capable de nous faire une image du monde extérieur et pour savoir ce qu'il faut faire, nous aurions disparu depuis longtemps. Le pilote automatique dans notre tête fait de nous ce que nous sommes, pas notre conscience.
Le vrai génie qui trouve des solutions, c'est l'inconscient. C'est quand il se trompe que nous mettons en marche notre conscience...
La distinction ancestrale entre l'inconscient pulsionnel et la conscience rationnelle (avec une nette préférence pour la seconde) a la vie dure. Dans les faits, elle est contredite par les observations. Le vrai génie qui résout les problèmes et garantit notre survie, c'est l'inconscient. Nos préjugés à son encontre viennent du fait qu'il semble incontrôlable. Comment guider quelque chose dont on ne sait ni quand, ni comment il nous influence ? Et pourtant, cela fonctionne.
John Bargh, spécialiste des phénomènes d'amorçage à l'université de Yale, compare notre esprit avec un marin : pour conduire son voilier d'un point A à un point B, il faut des intentions conscientes et des calculs préalables. Mais aucun navigateur ne peut se reposer entièrement là-dessus. Il est obligé de composer avec des impondérables comme les courants ou les vents. Et ceux-là font ce qu'ils veulent. Mais le marin avisé les inclut dans ses choix pour arriver au but....
https://www.cerveauetpsycho.fr/theme/in ... -19691.php
Globalement, Henri Laborit, tient encore la route.
A noter qu'il était marin, qu'il savait utiliser un voilier, et qu'il était également peintre.
Pour corréler avec les extraits de l'article ci-dessus.
Par contre, certains autres personnages appartiennent bien au passé.
https://www.cerveauetpsycho.fr/theme/in ... s-7786.php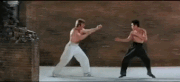


 praedicator veridicus, inquisitor intrepidus, doctor egregius
praedicator veridicus, inquisitor intrepidus, doctor egregius
