Poursuivons la réflexion...
Je n'ai pas lu le livre de Serge Halimi, mais des articles et d'autres ouvrages, qui rejoignaient son analyse.
Le constat est qu'un cynisme absolu règne.
L'une des bases des sociétés en devenir, c'est le système éducatif. C'est aussi son reflet.
Autour de 1992, en France, les économistes ont évalué le coût global de la scolarité d'un élève lambda, de l'entrée en petite section maternelle, à son accession en première année d'université.
Les calculs de rentabilité de l'outil, la gestion des "stocks" et le flux de ces "stocks" firent leur apparition avec le succès que l'on connaît.
Les "stocks" étant représentés par les élèves et accessoirement les enseignants.
On est cynique, ou on ne l'est pas.
En clair, les têtes pensantes ont utilisé et appliquée des outils d'évaluation provenant du monde de l'entreprise à un service public. La suite suivit (le secteur de la santé,....).
Deuxième donnée : pour qu'une société libérale fonctionne correctement, il suffit de disposer d'un certain nombre de cadres (10 %?) placés à des postes clés, stratégiques. Les politiques éducatives et de recherche ont été définies en ce sens par le traité de Lisbonne (2002) dont l'analyse suit:
http://institut.fsu.fr/La-strategie-de- ... -et-l.html
...Cette méthode est intéressante à beaucoup d’égard car elle fait prévaloir un comparatisme de type statistique dans le pilotage des systèmes éducatifs. C’est en comparant les niveaux de référence ou benchmarks avec certains pays modèles comme les Etats Unis ou le Japon et entre les pays européens que l’on trace les voies de réforme. De ces indicateurs en effet, on prétend en déduire les « bonnes pratiques » Comme le dit une chercheuse de l’Institut de recherches de la FSU, ce qui prime sur tout n’est pas l’argument politique ou culturel, c’est « l’argument statistique » censé enfermer l’ensemble du réel, en mettant de côté l’histoire, la société, les interactions entre institutions. Méthode purement technocratique donc, inspirée par les méthodes managériales de gestion des grands groupes et des multinationales. L’Europe est de ce point de vue une grande entreprise...
Une autre méthode et c’est celle que le gouvernement veut utiliser est de diminuer la dépense éducative là où elle n’est plus jugée efficace ou prioritaire. Ainsi Fillon a-t-il imaginé de réduire la dépense pour le secondaire. Mais on ne sait pas si les économies réalisées iront vers l’enseignement supérieur.
On peut remarquer que l’Europe en cherchant à construire un modèle libéral ne joue pas ses atouts, est incapable d’imaginer un modèle différent.
2- Faire piloter le système éducatif par les besoins de l’économie de la connaissance et les exigences de l’employabilité
Le changement de paradigme scolaire que l’on a observé un peu partout dans le monde depuis une vingtaine d’années se confirme en Europe : l’école est d’abord regardée comme une entreprise de production de capital humain, parmi d’autres entreprises ou lieux de formation. C’est une pensée avant tout économique de l’éducation et de la formation.
Elle part d’un présupposé c’est que les dépenses éducatives ne se justifient que par leur rendement, ou qu’elles se justifient prioritairement par leur rendement, soit social soit individuel...
On peut là encore repérer des aspects que l’on pourrait considérer comme positifs.
Augmenter le nombre d’élèves achevant un cycle secondaire, réduire le nombre d’élèves sortant sans diplômes, augmenter le pourcentage d’étudiants, le nombre d’élèves dans les filières scientifiques, etc Objectifs chiffrés qui se retrouvent par exemple dans la loi Fillon.
Mais en même temps, on voit déjà ce qu’implique un système éducatif commandé par des exigences de marché, une « éducation tirée par le marché » comme disent les Anglo-saxons :
- réduction des objectifs culturels à « un socle de compétences de base » défini en termes d’employabilité dans le cadre d’un marché du travail flexibilisé. Avec y compris comme grande priorité en matière de contenu le développement de l’esprit d’entreprise.
- accroissement de la dépense privée des ménages pour responsabiliser les étudiants, c’est-à-dire les obliger à suivre des études utiles économiquement, répondant aux besoins du marché.
- dépendance des lieux de formation des besoins ou des lubies des entreprises et de façon générale des financeurs.
En gros, comme toujours, un pilotage par le marché de l’éducation n’est pas toujours le meilleur moyen de préparer l’avenir...
Cette analyse date de 2011.
Nous sommes en 2022.
Est-ce que la donne a été fondamentalement changée au cours de la décennie écoulée ?
Non.
Deux quinquennats se sont succédés.
Le troisième démarre...
Petit rappel concernant "l'indépendance" supposée du système éducatif, avec le volet numérique, qui finit par piloter tout le reste :
https://eduscol.education.fr/ressources ... osoft.html
https://www.lexpress.fr/education/micro ... 28234.html
Ceux qui ont travaillé dans le domaine des systèmes et des logiciels en open edition apprécieront le côté farce.
Agrandissons le champ de réflexion, et intéressons-nous à une notion qui passe sous les radars, à savoir celle de la bande passante.
Qu'est-ce que ça à voir avec un système d'enseignement ???
Cyniquement -restons dans le ton comme stipulé en préambule- ceci:
https://www.lemondeinformatique.fr/actu ... 86673.html
...Venant en renfort, le lobby européen des télécoms, l’Etno (European Telecommunications Network Operators), a publié un rapport qui dénonce les manquements des géants du web dans leur contribution aux réseaux télécoms. Intitulé « l'écosystème Internet européen : avantages socio-économiques d'un équilibre plus juste entre les géants de la technologie et les opérateurs de télécommunications », le rapport indique que les opérateurs de télécommunications européens ont investi plus de 500 milliards d'euros dans les réseaux fixes et mobiles au cours des 10 dernières années...
Du traité de Lisbonne (2002), à la mission de l'Union Européenne au sujet de la régulation des GAFAM (2022), je ne suis pas certain que la notion de culture générale, qui devrait concerner chaque citoyen, en principe, y gagne.
Il est plutôt question de culture de la consommation et des outils la facilitant, si je ne m'abuse.
Ce qui me renvoie à un vécu professionnel personnel, en février 2017, où le responsable d'une formation, axée sur les ressources numériques, leur utilisation, les problématiques liées à l'utilisation des réseaux sociaux avait renvoyé quelques-uns de ses contradicteurs dans les cordes, en indiquant que les craintes liées à la place des GAFAM relevaient de fantasmes et de conduites idéologiques somme toute personnels.
On ne "saurait" mieux dire.
Ce responsable était un élément de votre du système hiérarchique, avec une âme de carriériste.
En 2022, nous pouvons constater (et savourer) l'ironie de la situation.
Loin de moi l'idée de considérer que l'enseignement actuel, au sens large, serait lié à une question d'exploitation et de rentabilité de cette bande passante.
Les moyens informatiques, le numérique, ne sont en principe, que des outils, pas des finalités, au service des humains à fortiori quand ces derniers sont des citoyens.
Il y a largement de quoi méditer.
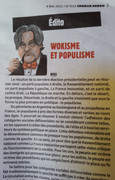
 praedicator veridicus, inquisitor intrepidus, doctor egregius
praedicator veridicus, inquisitor intrepidus, doctor egregius