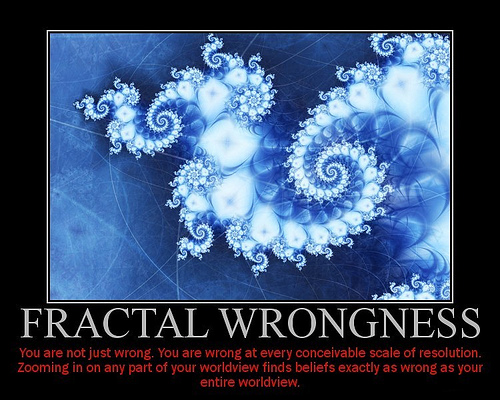3 idées reçues à propos de l'évolution
" L'évolution est une réalité au même titre que la chaleur du Soleil
16 ", affirme le professeur Richard Dawkins, éminent scientifique évolutionniste. Bien entendu, l'expérimentation et l'observation directe prouvent que le Soleil est chaud. Mais appuient-elles aussi indiscutablement l'enseignement de l'évolution ?
Avant de répondre à cette question, une précision doit être apportée. De nombreux scientifiques ont remarqué qu'avec le temps les descendants d'êtres vivants peuvent changer légèrement. Par exemple, on peut croiser des chiens pour que leurs descendants aient des pattes plus courtes ou le poil plus long*. Des scientifiques appellent ces changements mineurs " microévolution ".
Toutefois, les évolutionnistes enseignent que ces petits changements se sont accumulés sur des milliards d'années et ont produit les grands changements nécessaires à la transformation des poissons en amphibiens et des primates en hommes. Ces grands changements supposés sont appelés " macroévolution ".
C'est ainsi que Charles Darwin a enseigné que les changements mineurs observables impliquent que des changements bien plus grands, que personne n'a observés, sont aussi possibles
17. Pour lui, des formes de vie originelles, ou prétendument simples, ont évolué lentement sur des périodes considérables, par des " modification(s) très légère(s) ", pour donner les millions de formes de vie existant sur Terre
18.
Beaucoup trouvent cette affirmation logique. Ils se disent : " Si de petits changements peuvent survenir au sein d'une espèce*, pourquoi l'évolution ne pourrait-elle pas en produire de grands sur de longues périodes ? " En réalité, l'enseignement de l'évolution repose sur trois idées reçues que voici :
Première idée reçue. Les mutations fournissent les matières premières nécessaires à la production de nouvelles espèces. La macroévolution part du principe que les mutations, ou changements aléatoires dans le code génétique des plantes et des animaux, peuvent produire non seulement de nouvelles espèces, mais aussi des familles entièrement nouvelles de plantes et d'animaux
19.
Les faits. Bien des caractéristiques d'une plante ou d'un animal sont déterminées par les instructions contenues dans son code génétique, le " plan de fabrication " que renferme le noyau de chaque cellule*. Des chercheurs ont découvert que des mutations peuvent produire des modifications chez les descendants de plantes ou d'animaux. Mais les mutations produisent-elles vraiment des espèces entièrement nouvelles ? Qu'a révélé un siècle de génétique ?
À la fin des années 1930, les scientifiques ont adopté avec enthousiasme une nouvelle idée. Ils pensaient déjà que la sélection naturelle — processus au cours duquel l'organisme le mieux adapté à son environnement a plus de chance de survivre et de se reproduire — pouvait donner de nouvelles espèces végétales à partir de mutations aléatoires. Mais, à présent, ils présumaient qu'une sélection artificielle, c'est-à-dire dirigée par l'homme, pourrait le faire encore plus efficacement. " L'euphorie gagna les biologistes en général, et les généticiens et les sélectionneurs en particulier ", a écrit Wolf-Ekkehard Lönnig, chercheur à l'institut allemand Max Planck de recherche en phytogénétique*. Pourquoi cette euphorie ? M. Lönnig, qui étudie les mutations génétiques des végétaux depuis 30 ans, explique : " Ces chercheurs estimaient que le moment était venu de révolutionner la méthode traditionnelle de sélection des plantes et des animaux. Ils pensaient qu'en provoquant et en sélectionnant des mutations favorables, ils pourraient produire des végétaux et des animaux nouveaux et améliorés
20. " Certains espéraient même produire des espèces entièrement nouvelles.
Aux États-Unis, en Asie et en Europe, des scientifiques ont lancé des programmes de recherche (abondamment subventionnés) utilisant des méthodes qui promettaient d'accélérer l'évolution. Après plus de 40 ans d'efforts intensifs, quels ont été les résultats ? " Malgré un coût énorme, constate le chercheur Peter von Sengbusch, la tentative pour cultiver des variétés de plus en plus productives par irradiation [pour provoquer des mutations] s'est avérée un échec complet
21. " Commentaire de M. Lönnig : " Dans les années 80, les espérances et l'euphorie des scientifiques s'étaient soldées par un échec mondial. De nombreux pays occidentaux ont abandonné l'étude de la sélection par mutation en tant que branche à part entière de la recherche. Presque tous les mutants [...] mouraient ou étaient plus faibles que les variétés sauvages*. "
Les données aujourd'hui disponibles après 100 ans de recherches sur les mutations et, en particulier, 70 ans de sélection par mutation permettent aux scientifiques de dire si les mutations sont capables ou non d'engendrer de nouvelles espèces. Après examen des faits, M. Lönnig conclut : " Les mutations ne peuvent transformer une espèce [végétale ou animale]originelle en une espèce entièrement nouvelle. Cette conclusion s'accorde avec toutes les expériences et les résultats de toutes les recherches effectuées sur les mutations au XXe siècle, ainsi qu'avec les lois de la probabilité. "
Alors, des mutations peuvent-elles faire évoluer une espèce en une autre complètement nouvelle ? À l'évidence, non. Les recherches de M. Lönnig l'ont amené à la conclusion que les espèces bien définies ont des limites réelles que des mutations accidentelles ne peuvent ni effacer ni franchir
22 ".
Pensez aux implications de ce qui précède. Si des scientifiques hautement qualifiés sont incapables de produire de nouvelles espèces en provoquant et en sélectionnant artificiellement des mutations favorables, peut-on attendre mieux d'un processus inintelligent ? Si les recherches indiquent que les mutations ne peuvent transformer une espèce originelle en une autre entièrement nouvelle, comment au juste la macroévolution est-elle censée avoir eu lieu ?