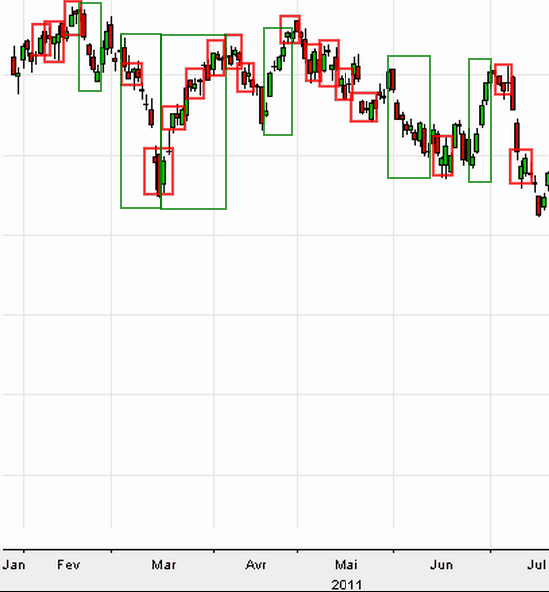Salut Cronos,
Vous dites :
Je souhaiterais que la durée de ces périodes reste à ma convenance, c’est à dire variables entre 3 et 10 jours, et non pas fixés à 3 jours. Et dans ce cas, une prévision est dite bonne ou mauvaise, quelque soit le nombre de jours qu'elle englobe.
Ça me va parfaitement. Ma suggestion d'intervalles réguliers de 3 jours était un premier jet, pour déblayer le terrain. Je n'ai aucune objection à vous laisser librement choisir les durées (variables) des intervalles. Ma principale exigence est que les prédictions doivent être émises
"longtemps avant" le début des intervalles où elles s'appliquent. Disons, au moins un mois avant (de préférence deux), pour que les informations locales "naturelles" aient eu le temps de s'estomper.
Pour vous, à partir du moment où l'on parle de prévisions éloignées de plusieurs mois, la probabilité de hausse ou de baisse est d'environ 50%, quelque soit la durée des périodes de temps retenues.
Oui et non.
"Oui" pour la probabilité voisine de 50% (pour un intervalle court), mais "non" pour les traiter comme des "pile ou face". Dans un calcul de probabilités, il faut tenir compte des dépendances entre les observations successives.
Par exemple, je veux bien admettre que la probabilité que la température qu'il fera à Montréal, à midi, le prochain 1
er avril a environ 50% de chance d'être supérieure à la moyenne des 10 dernières années (peut-être un peu plus, 51%, à cause du réchauffement climatique). Pareil pour les températures du 2, du 3 et du 4 avril. Mais je pense que la probabilité que les températures soient supérieures aux moyennes
pour les quatre jours est nettement supérieure à une chance sur 16 (ce qu'on obtiendrait en supposant l'indépendance). Les "canicules" s'étendent sur plusieurs jours.
Je souhaiterais m'abstenir de prévisions sur certaines périodes.
Ça me va encore. J'admets que certaines configurations planétaire puissent être moins inspirantes que d'autres.
Il est toutefois possible de s'engager sur des périodes dites de « forte hausse » ou de « forte baisse », (c’est à dire sur un % supérieur à la moyenne des hausses ou des baisses de l'ensemble des prévisions.)
O.K. Plutôt que ne considérer que 2 niveaux (hausse ou baisse), on pourrait en considérer 5 :
- +2 : forte hausse.
+1 : hausse modérée.
0 : à peu près inchangé.
-1 : baisse modérée.
-2 : forte baisse.
Le nombre de points mérités par une prédiction serait le
produit des deux cotes. Par exemple, si vous prédisez une forte hausse (+2) alors qu'il y a une hausse modérée (+1), ça vous donnerait +2 points. Si vous prédisez +1 alors que c'est -2, ça vous donnerait -2 points.
On pourrait aussi attribuer les points en fonction de la
différence entre les deux variables (plutôt que les produits). Par exemple, si vous avez prédit -2 alors que la réalité est +1, ça vous donnerait 3
"mauvais points". Les deux systèmes ont du pour et du contre.
Ne reste plus qu'à s'entendre sur les frontières définissant les 5 catégories (-2, -1, 0, +1 et +2) dans les cotes boursières "officielles" (i.e. la "réalité"). Pour vos prédictions, vous faites à votre goût.
Mais
mon scrupule principal porte sur le 50% dont on a parlé au début. Pour évaluer probabilistiquement votre performance globale, on ne doit absolument pas se référer à ce 50%. L'
ensemble de vos N prédictions doit être comparé à l'
ensemble des N réalités. Ce qu'il faut voir c'est si, en permutant (au hasard) vos prédictions, ça va beaucoup moins bien qu'en ne les permutant pas.
Si l'expérience est réalisée, et qu'on finit par disposer des deux listes de N nombres (vos prédictions et les réalités), je me charge des calculs de probabilités (pour voir si, en permutant (au hasard) vos N prédictions, ça va beaucoup moins bien qu'en ne les permutant pas).
Faut bien que mon PhD en statistique-mathématique serve à quelque chose.


Denis
Les meilleures sorties de route sont celles qui font le moins de tonneaux.