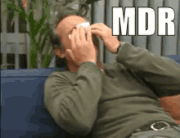Chez un enfant vulnérable génétiquement, il y a d'autres variables qui augmentent considérablement son risque de développer une schizophrénie à l'âge adulte:
- exposition de la mère à l'influenza ou à d'autres infections pendant le second trimestre de la grossesse;
- etc.
FACTEURS PRÉNATAUX
Avant même que les soupçons relatifs à la période prénatale ne soient clairement formulés, des recherches avaient montré que les schizophrènes nés à la fin ou durant la saison hivernale étaient significativement plus nombreux que ceux nés à d’autres périodes48,49 et ce, particulièrement dans l’hémisphère nord. On compterait aujourd’hui plus de 250 études à travers le monde portant sur cette seule question50. Cette constatation invitait les chercheurs à identifier le rôle pathogène de facteurs saisonniers. Une des hypothèses soumises à l’enquête fut la possibilité qu’un agent infectieux vienne perturber le développement foetal. Au Minnesota, Watson et al. 51 furent parmi les premiers à mettre la schizophrénie en relation avec la survenue de grippe. Avec des raffinements méthodologiques, les membres de l’équipe de Mednick 52 vérifièrent le même lien entre une épidémie de grippe (Influenza type A2) survenue à Helsinki en 1957, et le nombre de schizophrènes nés durant cette période. Ils conclurent que l’exposition de la mère à un virus durant le second trimestre de sa grossesse augmentait significativement le risque que son enfant développe une schizophrénie à l’âge adulte. Plusieurs équipes indépendantes (voir: 18 & 53) ont ensuite vérifié la régularité de ce lien dans différents pays et pour d’autres périodes de l’histoire. Peu d’équipes ont eu des résultats non significatifs et la réanalyse ciblée des données d’une de ces équipes54 par Mednick & al.(1994) a finalement confirmé le lien entre une exposition au virus pendant le troisième trimestre de la grossesse et la survenue de la schizophrénie. Ces recherches présentent d’importantes limites méthodologiques. La plus importante est qu’elles portent sur de vastes populations exposées à des épidémies sans vérifier spécifiquement si les mères de schizophrènes avaient effectivement contracté le virus. La seule exception est la récente réanalyse que Mednick & al.55 ont fait de leur échantillon. Leurs nouveaux résultats montrent que les mères infectées par le virus au deuxième trimestre représentent 86,7% de leur échantillon de schizophrènes contre seulement 20% pour les deux autres trimestres. L’hypothèse de Mednick est que le virus, ou la réponse de défense immunitaire de la mère, interfère à une étape critique de l’organisation du système nerveux central du foetus. La possibilité que la réaction immunitaire de la mère puisse être mise en cause a conduit des chercheurs du Danemark a vérifié l’effet d’une autre réponse immunitaire sur l’incidence de schizophrénie. La compatibilité sanguine entre la mère et son foetus est un facteur connu pour solliciter les réponses immunitaires de la mère lors de grossesses successives. Hollister & al.56 ont examiné l’incidence de schizophrénie dans un échantillon de 1,867 sujets de sexe masculin divisés suivant leur compatibilité sanguine avec leur mère. Les chercheurs ont montré que le risque de schizophrénie était presque trois fois plus élevé chez les sujets ayant un facteur Rhésus différent de celui de leur mère que chez ceux ayant un facteur Rhésus compatible. Comme ce phénomène ne s’observait pas chez les aînés, mais seulement chez les rejetons ultérieurs de la mère, les données supportaient l’hypothèse d’une interférence directe ou indirecte de la réaction immunitaire de la mère sur le développement nerveux foetal. Tous ces résultats confirment un lien entre une infection ou une réaction immunitaire de la mère et la survenue de la schizophrénie, mais pas nécessairement un lien causal. À propos des interférences virales, Kendell & Kemps 57 ont soutenu que le virus lui-même n’était peut-être pas en cause, mais que l’infection pouvait être simplement un indicateur de la présence d’un stress psychologique qui rendrait la mère plus vulnérable à la maladie. Selon eux, le stress psychologique pourrait être le facteur actif réel. Cette hypothèse ne s’applique pas au facteur Rhésus et ne tient pas non plus vraiment avec le facteur viral. En effet, si seul le stress interférait, la différence apparaîtrait seulement entre les enfants de mères infectées et ceux de mères non infectées. Or, les données sont saisonnières et se vérifient aussi, au sein de toute une population, lorsque l’on compare les périodes d’épidémie aux périodes non épidémiques. Le virus n’est peut-être pas l’agent direct, mais son addition au système augmente réellement le risque de schizophrénie indépendamment de facteurs psychologiques.
L’hypothèse psychologique tient mieux pour nuancer d’autres facteurs explorés par la recherche. Un de ces facteurs récemment mis en évidence est le rôle de la malnutrition de la mère pendant sa grossesse. Pour vérifier cette hypothèse, Suzzer & al.58 ont comparé l’incidence de schi-zophrénie chez des sujets adultes nés pendant une famine survenue dans les villes de l’ouest du Netherland durantla Seconde Guerremondiale, avec l’incidence dans une population comparable née à une époque où il n’y avait pas de famine. Encore une fois, les résultats étaient concluants. Ici, l’hypothèse d’un stress psychologique est plus facile à soutenir que dans le cas des épidémies virales parce qu’un état de famine dans une communauté est une source de stress psychologique beaucoup plus évidente que ne peut l’être une simple épidémie de grippe. Au niveau psychologique, finalement, il faut souligner qu’un stress violent chez la mère est un facteur qui a été étudié spécifiquement. Huttunen & Niskanen 59 ont montré que les foetus qui en étaient à leur deuxième mois de développement, au moment où leur mère apprenait que leur mari était décédé à la guerre, avaient un taux de psychose plus élevé (schizophrénie comprise) que les foetus de mères qui apprenaient la nouvelle à un autre moment du développement. L’étude de Huttunen & Niskanen 59 ne contrôle cependant pas les autres facteurs potentiellement pathogènes. Nous savons, par exemple, qu’un deuil provoque une dépression du système immunitaire 60,61,62. Il est possible et même vraisem-blable que les mères de sujets schizophrènes aient été plus vulnérables à des agents infectieux à cause de l’état dépressif provoqué par le deuil et que ce soit l’agent infectieux qui soit en cause. La seule façon de départager ces deux hypothèses serait de reprendre l’étude en contrôlant le facteur «infection». Dans la même veine, une recherche plus récente portant sur une cohorte de 11,017 sujets conduisait l’équipe de Myhrman & al.62b à observer que les mères de sujets schizophrènes adultes avaient manifesté une plus forte proportion de grossesse non désirée au 6e et 7e mois de leur grossesse que le groupe de comparaison. Encore une fois, en absence de contrôle des comportements associés, plusieurs interprétations peuvent être données à ce résultat. L’hypothèse d'une interférence psychologique demeure cependant au centre des questions. En résumé, une infection virale ou un autre stress physique sollicitant le système immunitaire de la mère pendant le second trimestre de la grossesse est très fortement suspecté d’augmenter le risque qu’un bébé, prédisposé génétiquement, développe une schizophrénie à l’âge adulte. Une malnutrition et un violent stress psychologique survenant au même moment pourraient aussi être des causes environnementales pathogènes, mais sans que l’on puisse encore bien les départager. Ce que tous ces facteurs ont en commun, cependant, c’est de mettre en cause le second trimestre du développement foetal. Cette convergence invite à penser que le second trimestre est une période de vulnérabilité critique pour la survenue ultérieure de la schizophrénie chez les personnes génétiquement prédisposées à développer la maladie. Comme le remarque certains auteurs 2,29, à ce stade de la recherche, les indices convergeant vers le second trimestre sont suffisamment bien documentés pour commander des politiques préventives auprès des femmes enceintes à haut risque.
FACTEURS LIÉS À L’ACCOUCHEMENT
Les premières études ayant montré les liens entre la schizophrénie et les difficultés survenant pendant l’accouchement sont les études longitudinales et rétrospectives. Un modèle du genre est l’étude du Copenhagen High Risk Project. En 1962, cette équipe a recruté 207 adolescents issus de mères schizophrènes. Les chercheurs ont évalué soigneusement leurs sujets et leurs parents et ont effectué des mesures physiologiques de réactivité du système nerveux autonome. Surtout, l’équipe disposait des fiches obstétriques (standardisées et très détaillées au Danemark) complètes des sujets. En réévaluant leurs sujets après 10 ans et 30 ans (entre 1972 et 1974, puis vers 1989), l’équipe a pu identifier ceux qui étaient devenus schizophrènes et chercher les facteurs distinctifs que présentaient ces adolescents par rapport à ceux qui ne sont pas devenus schizophrènes. Les résultats ont montré que plusieurs facteurs précoces étaient statistiquement liés à une augmentation du risque de schizophrénie. Les difficultés survenues durant l’accouchement (delivery complications) en faisaient partie. Leurs résultats7,63 montrent que chez un sujet à plus haut risque génétique (dont le père est aussi schizophrène), les problèmes de grossesse et d’accouchement multiplient par sept le risque de développer une schizophrénie à prédominance de symptômes négatifs. La plus intéressante mesure de cette équipe est cependant la comparaison entre le nombre d’incidents obstétricaux chez des sujets schizophrènes, des sujets normaux et des sujets du spectre schizophrénique. Le groupe où le moins d’incidents de problèmes d’accouchement étaient observés était celui des sujets du spectre63. Ces résultats suggéraient qu’un accouchement particulièrement facile était un facteur de protection contre la schizophrénie pour des sujets ayant une prédisposition génétique à développer la maladie. Malheureusement, dans ce genre d’étude comme dans les suivantes, les incidents d’accouchement sont généralement évalués par des scores globaux qui ne distinguent pas bien chaque incident spécifiquement et qui calculent aussi simultanément les incidents survenant pendant le développement foetal (pregnancy) et ceux survenant pendant l’accouchement lui-même (delivery) et après la naissance (neonatale period).
Dans leurs revues respectives sur cette question, McNeil64 et Machon & Mednick18 observent que plusieurs recherches portant spécifiquement sur cette question ont ensuite documenté les soupçons. Par ailleurs, la tomographie cérébrale a montré que plus les incidents obstétricaux étaient nombreux dans l’histoire d’un sujet schizophrène, plus il avait de risque de présenter des anomalies cérébrales (Voir: 29,64). Une autre limite de ces études est cependant de ne pas permettre de départager les rôles respectifs des incidents obstétricaux et du risque génétique. Dans sa revue sur la question, McNeil64 montre que les incidents obstétricaux peuvent tout aussi bien être indirectement provoqués par les facteurs héréditaires que s’additionner à eux ou être des causes indépendantes de schizophrénie pour des sujets qui ne présentent pas de risques génétiques au départ. McNeil montrait cependant que plusieurs arguments militent en faveur de l’hypothèse additive puisque les facteurs obstétricaux les plus significativement liés à une augmentation du risque sont les incidents d’accouchement qui s’accompagnent d’une privation d’oxygène chez le nourrisson. La comparaison entre jumeaux discordants et concordants quant à la maladie suggère pour leur part que les facteurs obstétricaux ne jouent un rôle additif que dans le cas des jumeaux discordants. McNeil & al.65 suggèrent que chez les jumeaux concordants, le facteur génétique serait plus puissant et provoquerait peut-être à lui seul la maladie sans l’addition de facteurs environnementaux. Nous remarquons cependant que dans leurs données, les incidents de grossesse (pregnancy) des jumeaux concordants sont, en valeur absolue, plus élevés que pour les jumeaux discordants bien que le nombre de sujets ne conduisent pas à des différences significatives. Il pourrait donc aussi être possible que les incidents de grossesse soient les facteurs clés chez les concordants, d’où leur plus faible représentation dans les incidents d’accouchement. Le partage de la pondération entre les facteurs génétiques, les facteurs prénataux et les incidents d’accouchement n’est pas encore complété. Par contre, on peut déjà identifier clairement que les incidents d’accouchement sont des facteurs qui augmentent le risque de schizophrénie chez un nombre important de sujets génétiquement prédisposés à cette maladie. Inversement, un accouchement particulièrement facile apparaît comme un facteur de protection pour des personnes génétiquement fragiles.
FACTEURS NÉONATAUX
Les facteurs néonataux sont rarement étudiés séparément des autres facteurs obstétricaux. Dans leurs recherches, McNeil & al.65 décrivent des incidents directement reliés à la grossesse et à l’accouchement tels que le poids à la naissance et les longs délais d’accouchement. Les recherches les plus avancées actuellement sont celles conduites sur des modèles animaux. La recherche consiste à provoquer des lésions spécifiques du cerveau à des périodes de temps précises suivant la naissance et de vérifier ensuite l’incidence de ces lésions sur le développement et le comportement du cobaye 65b,65c,65d. Il ressort clairement de ces recherches que le moment où survient la lésion est déterminant sur le comportement de l’animal à l’âge adulte. Cette constatation suggère que, durant les tous premiers jours du développement d’un bébé animal, se produisent des processus critiques pour le développement du cerveau. Si ces processus sont interrompus par des lésions, les conséquences s’observent de manière spécifique jusqu’à un âge avancé. La généralisation de modèles animaux à l’être humain est hasardeuse, mais ces recherches soulèvent des questions pertinentes pour une intervention préventive. Une recherche (66) récente sur les circonstances de la naissance de 11,017 sujets adultes a montré que les sujets contractant un virus alors qu’ils étaient nourrissons avaient de plus fortes chances de développer une schizophrénie ou une autre forme de psychose à l’âge adulte. Il y a un intéressant parallèle entre ces résultats et les recherches sur les modèles animaux.
L’INSTABILITÉ FAMILIALE
Ce sont, encore une fois, les recherches longitudinales qui ont mis en évidence le rôle pathogène de l'instabilité familiale. Dans leur étude originale 7, l'équipe du Copenhagen High Risk Project (CHRP) a montré qu'une sévère instabilité dans l'environnement éducatif familial précoce multipliait par cinq le risque de dévelop-per une schizophrénie à prédominance positive chez les sujets présentant un risque génétique. De plus, lorsque la présence de prédispositions génétiques était vérifiée (hypothétiquement), par l’occurrence d’une hypersensibilité du système nerveux autonome, l’addition du facteur «instabilité familiale» multipliait le risque par huit. La définition que l’équipe du CHRP donne de la «sévère instabilité de l’environnement éducatif familial précoce» est cependant très «opérationnelle». Dans leur index d’instabilité, les auteurs ne retenaient que les événements matériellement documentables et exceptionnellement stressants pour un jeune enfant, tels une séparation mère-enfant ou père-enfant de plus de 1½ an; une institutionnalisation de plus de 1½ an; une expérience d’au moins deux déménagements de foyer. En analysant une cohorte de 9,125 enfants nés au Danemark, Barr & al. (Voir: 29) ont vérifié cette observation sur une plus grande échelle. Les enfants ayant expérimenté une séparation avec la mère durant les premières années de leur vie avaient un plus grand risque de développer la schizophrénie à l’âge adulte si, bien sûr, ils étaient prédisposés génétiquement à la maladie. Il faut souligner que, pour les autres enfants (sans prédispositions génétiques), l’expérience de séparation avec la mère augmentait le risque d’hospitalisation à l’âge adulte et de désordre de personnalité non psychotique.
L’effet pathogène de la séparation semble cependant pouvoir être neutralisé par des mesures préventives. En reprenant les données de l’étude du CHRP, Walker & al.67 ont montré que les enfants à haut risque séparés de leur mère, mais qui étaient placés en foyer nourricier («foster care») ou chez d'autres membres de la famille («care of relatives»), avaient un moindre risque de devenir schizophrènes que ceux placés en institution. En d’autres termes, si une séparation précoce est un facteur de risque, un «placement adéquat», au contraire, constitue une protection mesurable contre la maladie pour les enfants à risque. Il y a tout lieu de croire que c’est la stabilité et la qualité de la relation affective qui constitue ici un facteur de protection. Cette interprétation est alimentée par l’étude du CHRP qui montre que les enfants élevés par des mères schizophrènes socialement dysfonctionnelles ont plus de risque de développer la maladie que ceux élevés par des mères ayant plus d’habiletés29.
Dans une autre recherche, Burman & al.68 montrent aussi qu’une fois adulte, les sujets schizophrènes témoignent de beaucoup moins de satisfaction face à leurs relations familiales précoces que les sujets à haut risque qui n’ont pas développé la maladie. Bien que dans ces cas, les facteurs héréditaires ne sont pas contrôlés par le cadre de recherche, des études d’adoptions69 viennent soutenir cette interprétation. Elles montrent que les enfants à risque pris en charge par des familles adoptives fonctionnelles ont un bien moindre risque de développer la maladie que les enfants à risque pris en charge par des familles adoptives «perturbées». Ici pas d’interférence génétique entre le comportement des parents et l’hérédité des enfants. Par ailleurs, on savait déjà par les études de Vaugh & Leff 70 que la qualité de la communication dans une famille, mesurée par une échelle de qualité des émotions exprimées (EE), était un facteur de rechute pour les sujets ayant la maladie. Il est intéressant de constater que le même phénomène semble aussi jouer un rôle étiologique dans le développement précoce et dans le déclenchement initial de la maladie. Une vaste étude sur l’étiologie de la maladie mentale (UCLA Family Project), une équipe californienne a montré que le manque d’habilités des parents à établir et maintenir une complicité avec leurs adolescents et une attitude affective négative, critique, intrusive et culpabilisante étaient des facteurs associés à un plus grand risque de développer la maladie71. Une revue récente de cette question effectuée par Miklowitz72 va dans le même sens. Il est malheureux de constater que les facteurs affectifs environnementaux de la petite enfance n’aient pas fait l’objet de plus de recherches subséquentes puisqu’il semble que ces facteurs ont une incidence réelle sur le développement de la maladie au moins en ce qui regarde les schizophrènes à prédominance de symptômes positifs.
4
5) PARNAS J; CANNON TD; JACOBSEN B & al. (1993). Lifetime DSM-III-R diagnostis outcomes in the offsprings of schizophrnic mothers. Archives of General Psychiatry, 50, 707-14.
46) PRICE RH; COWEN EL; LORION RP & al. (1988)14 Ouncesof prevention,Washington, dc; American Psychological Association.
47) SUDDATH RL; CHRISTISON GW; TORREY & al. (1990) Anatomie abnormalities in the brains of monozigotic twins discordant for schizophrenia.N EnglJ Med, 322, 789-794.
48) BRADBURY TN & MILLER GA (1985). Season of birth in schizophrenia: A review of evidence, methodology and etiology. Psychological Bulletin, 98, 569-94.
49) BOYDS JB; PULVER AE; STEWART W (1986). Season of birth: Schizophrenia and bipolar discorder. Schizophrnia Bulletin, 12, 173-86.
50) TORREY EF; MILLER J; RAWLING R & YOLKEN RH (1997). Seasonality of births in schizophrenia and bipolar disorder: a review of the literature. Schizophrenia Research, 28(1), 1-38.
51) WATSON CG; KUCULA T; TILLESKJOR C & JACOBS L (1984) Schizophrenic birth seasonability in relation to the incidence of infectious diseases and temperature extremes. Achives of General Psychiatry, 41, 85-90.
52) MEDNICK SA; MACHON RA; HUTTUNEN MO & BONETT D (1988). Adult schizoprenia following prenatal exposure to an influenza epidemic. Archives of General Psychiatry, 45, 189-92.
53) WYATT RJ; APUD JA; POTKIN (1996) New Directions in prevention1 and treatment of Schizophrenia: A Biological Perspective. Psychiatry, 59, 357-70.
54) KENDELL RE & KEMP IW (1988) Maternal influenza in the etiologiy of schizophrnia. Archives of General Psychiatry, 46, 878-82. MEDNICK SA; MACHON RA; HUTTUNEN MO (1990). An update on the Helsinki Influenza Project [letter] Archives of General Psychiatry, 47, 292.
55) MEDNICK SA; HUTTUNEN MO; MACHON RA (1994). Prenatal influenza infections and adult schizophrenia. Schizophrenia Bulletin, 20, 263-7.
56) HOLLISTER JM; LAING P; MEDNICK SA (1996). Rhesus Incompatibility as a Risk facteur for Schizophrenia in Male Adults. Achives of General Psychiatry, 53, 19-24.
57) KENDELL RE & DIEHL SR (1983) Maternal influenza in the etiology of schizophrenia. Achives of General Psychiatry, 46, 878-82.
58) SUSSER E; NEUGEBAUER R; HOCK HW & al. (1996). Schizophrenia After Prenatal famine. Further Evidence. Archives of General Psychiatry, 53, 25-31.
59) HUTTUEN M; NISKANEN P (1978) Prenatal loss of father and psychiatric disorders. Archives of general Psychiatry, 35, 429-31.
60) ZISOOK S; SHUCHTER SR; IRWIN M & al. (1994) Bereavement, depression and immune function. Psychiatry Res, 52, 1-10.
61) KEMENY ME; WEINER H; DURAN R & al. (1995) Immune system changes after tehe death of partner in HIV-positive gay men. Psychosom Med , 57(6) 547-54.
62) IRONSON G; WYNINGS C; SCHNEIDERMAN N & al (1997) Posttraumatic stress symptoms, intrusive thoughts, loss, and immune function after Hurricane Andrew. Psychosom Med, 59(2), 128-41. 62b) MYHRMAN A; RANTAKALLIO P; ISOHANNI M & al. (1996) Unwantedness of a pregnancy and schizophrenia in the child. Br J Psychiatry, 169(5), 637-40.
63) CANNON TD; MEDNICK SA; PARNAS J (1990b) Two patways to schizophrenia in children at risk. In: Robins & Rutter,Straight and Devious Pathaays from Childhood to Adulthood (pp328-349).CambridgeUniversityPress.
64) McNEIL TF (1988). Obstetric factors and perinatal injuries. In: Tsuang Mt & Simpson Jc, Handbook of Schizophrenia Vol.3. Nosology, Epidemiology and Genetics (pp 319-345) NY, Elsevier.
65) McNEIL TF; CANTOR-GRAAE E; TORREY EF & al. (1994) Obstetric complications in histories of monozygotic twins discordant and concordant for schizophrenia. Acta Psychiatrica Scandinavia, 89, 196-204.
65b)WOOD GK; LIPSKA BK; WEIBERGER (1997) Behavioral changes in rats with early ventral hippocampal damage vary with age at damage. Brain res Dev res, 101(1-2) 17-25
65c)BERTOLINO A; SAUNDERS RC; MATTAY VS & al. (1997) Altered development of prefrontal neurons in rhesus monkeys with neonatal mesial temporo-limbic lesions: a proton magnetuc resonance spectroscopic imaging study. Cered Cortex 7(8), 740-48.
65d) SAMS-DODD F; LIPSKA BK; WEINBERGER DR (1997) Neonatal lesion of rat ventral hippocampus result in hyperlocomotion and deficits in social behaviour in adulhood. Psychopharmacology (Berl) 132(3), 303-10. 66) RANTAKALLIO P; JONES P; MORING J & VON WENDT L (1997) Association betwen central nervous system infections during childhood and adult onset schizophrenia and other psychoses: a 28-yaers follow-up. Int J Epidemiology, 26(4) 837-43.
67) WALKER EF; CUDECK R; MEDNICK &al. (1981) Effects of parental absence and institutionalization on the development of clinical symptomes in high-risk children. Acta Psychiatrica Scandinavia, 63, 95-109.
68) BURMAN B; MEDNICK SA; MACHON R & al. (1987). Perception of family relationships of children at hiht-risk for schizophrenia. Journal of Abnormal Psychology, 96, 364-366.
69) TIENARI P; WYNNE LC; MORING J &al. (1994) The finnish Adoptive Family Study of Schizophrenia: Implications for family research. British Journal of Psychiatry, 23(suppl) 20-26.
70) VAUGHN CE & LEFF JP (1976). The Influence of Falily and Social Factors on the Caourse of Psychiatric Illness. British Journal of Psychiatry, 129, 125-137.
71) GOLDSTEIN MJ (1987) The UCLA High-Rosk Project. Schizophrenia Bulletin, 13, 505-14.
72) MIKLOWITZ DJ (1994) Family risk indicators in schizophrenia. Schizophrenia Bulletin, 20(1), 137-149