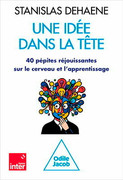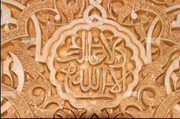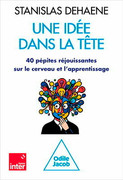Stanislas Dehaene : « L’intelligence artificielle n’est pas près d’égaler notre cerveau »
INTERVIEW. À tout âge, nous pouvons apprendre, stimuler ce fascinant organe et en retarder le vieillissement. C’est le message du neuroscientifique dans son nouvel ouvrage, « Une idée dans la tête ».
Propos recueillis par Guillaume Grallet et Héloïse Pons
Publié le 24/10/2024 à 07h30
La dernière fois que nous nous étions entretenus avec Stanislas Dehaene, il sortait d'un tête-à-tête émouvant avec son cerveau. « Tout mon esprit, ma personne, mes souvenirs, ma volonté tiennent-ils vraiment dans ce kilo et demi de matière molle ? Tout ce que je ressens, tout ce que je suis même, se réduit-il à la décharge de quelques dizaines de milliards de neurones – quand bien même ils seraient agencés avec soin par un demi-milliard d'années d'évolution et cinquante-six ans d'éducation ? » s'interrogeait-il en 2021 dans Face à face avec son cerveau (Odile Jacob), alors qu'il rassemblait dans ce livre passionnant les travaux de scientifiques du monde entier, à propos de l'organe le plus mystérieux et fascinant du corps humain.
Cette fois-ci, le professeur au Collège de France, titulaire de la chaire de psychologie cognitive expérimentale, répond de manière limpide à – presque – toutes les questions qui nous passent par la tête : qu'est-ce que la plasticité cérébrale ? quel rôle joue le chant des oiseaux ? un bébé apprend-il déjà dans le ventre de sa mère ? peut-on faire des découvertes en dormant ? qu'est-ce que l'attention ? comment mémoriser en profondeur ? comment booster notre cerveau à tout âge ? Ces chroniques, des « pépites réjouissantes sur le cerveau et l'apprentissage » qui ont fait le bonheur des auditeurs de France Inter cet été, le scientifique les a couchées sur le papier dans Une idée dans la tête (Odile Jacob), un livre qui se picore.
En combinant des images d’IRM en 3D de cerveaux de plus de 100 individus, le projet Connect, du centre NeuroSpin (CEA de Paris-Saclay), a établi un atlas décrivant les connexions intracérébrales (travaux de Pamela Guevara, Jean-François Mangin et Cyril Poupon).
Certes, la diversité des processus neurologiques abrite encore nombre d'inconnues. Mais les dernières recherches du scientifique, qui, avec son équipe, peut désormais s'appuyer sur Iseult, l'aimant IRM le plus puissant du monde, installé sur le plateau de Saclay, résonnent comme un appel à l'action.
Car, pour Stanislas Dehaene, tout un chacun a le potentiel pour devenir un grand mathématicien. En effet, explique le président du Conseil scientifique de l'Éducation nationale, les efforts finissent toujours par payer, et cela tout au long de la vie. Autre bonne nouvelle : une alimentation et une hygiène de vie saines peuvent retarder le déclin cognitif et l'apparition des maladies neurodégénératives, alors que, sur le front d'alzheimer, les progrès médicaux laissent entrevoir certains espoirs.
Quoi qu'il en soit, pas question d'avoir des complexes face à l'intelligence artificielle, qui n'est pas près de rivaliser d'intuition, de créativité et de sens de l'à-propos avec notre cerveau. Mieux, la consommation énergétique de ce dernier, infinitésimale, devrait nous rendre fiers au regard d'une IA qui, certes, nous permet d'en savoir plus sur le fonctionnement de notre activité neuronale mais ne peut se passer de supercalculateurs cruellement gourmands en énergie. Alors, comme le dit le professeur : « Croyez en vous-même, croyez en votre cerveau, apprenez à mieux le connaître – car, avec un peu d'effort quotidien, son potentiel d'apprentissage est tout simplement extraordinaire ! »
Le Point : Votre nouveau livre vise à rendre les découvertes en neurosciences accessibles au grand public. Pourquoi est-ce « d'utilité publique », selon vous ?
Stanislas Dehaene : Les neurosciences progressent à une vitesse fulgurante, et beaucoup de gens sont intimidés par les sciences et le fonctionnement du cerveau, qui leur apparaît comme un organe tellement complexe qu'ils n'y accèdent pas. Or il y a énormément de choses que nous devrions tous savoir sur notre cerveau.
D'autant que beaucoup de neuromythes entourent le cerveau…
Oui, des idées vraiment étranges circulent sur le cerveau, qui ne sont pas loin d'être l'équivalent de théories aberrantes – comme celle de la Terre plate – pour nous, scientifiques. C'est étrange de voir que les gens adhèrent si rapidement à ces thèses fausses. Par exemple, l'idée que le cerveau droit serait artistique et le cerveau gauche, rationnel est une vision complètement simpliste. Il y a aussi l'idée qu'on n'utiliserait que 10 % de notre cerveau, ce qui est une absurdité totale du point de vue des neurosciences.
Un autre mythe tenace concerne les styles d'apprentissage. Beaucoup pensent que nous sommes tous différents les uns des autres, que chacun a son style, l'un visuel, l'autre verbal, et que c'est vraiment important d'en tenir compte. C'est complètement faux. En réalité, un des messages clés de mon livre est un message d'universalisme : nous avons tous un cerveau très semblable, celui d'Homo sapiens. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de différences, mais ce qui nous rassemble est beaucoup plus important que ce qui nous divise.
Je veux aussi trancher le débat entre ceux qui pensent que tout est inné et ceux qui croient que tout est acquis. Les deux sont faux, il faut trouver le juste milieu entre ces deux écueils. Dans l'apprentissage du langage, par exemple, un réseau linguistique bien organisé est déjà présent chez le bébé dès les premiers mois, mais, si ce réseau ne reçoit pas d'entrées linguistiques très structurées dès les premiers mois et les premières années de la vie, il va s'étioler, et cette partie d'acquis est fondamentale.
Certaines fausses croyances concernent aussi la dyslexie…
Il faut comprendre qu'il existe beaucoup de dyslexies très différentes les unes des autres. L'idée que toutes les dyslexies viennent d'une erreur en miroir, que ces enfants confondent la gauche et la droite, est complètement fausse. Si ce type de dyslexie existe, il est très rare. Les dyslexies les plus courantes sont celles qui viennent du fait de ne pas bien entendre les sons du langage, ou de ne pas bien comprendre l'agencement des lettres. Sur ce point, notre hypothèse est que les neurones qui sont sensibles à la position des lettres ne sont pas assez précis chez ces personnes.
Dans le livre, je réfute aussi l'idée selon laquelle la dyslexie peut être d'origine rétinienne, périphérique ou visuelle, et qu'une paire de lunettes ou une lampe magique suffisent à la corriger. C'est une absurdité totale, il n'y a aucune science derrière, car la dyslexie vient de circuits profonds du cerveau, à l'interface entre vision et langage.
Vous qualifiez l'apprentissage de la lecture d'« une des plus grandes transformations du cerveau ». Qu'est-ce qu'on y observe quand on apprend à lire ?
Un circuit très précis doit se mettre en place pour que les enfants lisent avec efficacité. Il est situé dans l'hémisphère gauche chez 96 % des gens, car il est associé aux régions du langage. En fait, il fait le lien entre les aires visuelles et celles du langage. C'est une région bien précise que nous possédons tous au même endroit. Chez les enfants qui n'apprennent pas bien à lire, notamment les enfants dyslexiques, cette région ne se développe pas normalement – et, chez l'adulte, sa lésion fait perdre toute capacité de lire. Il existe donc un lien étroit entre cette région et la capacité de lire.
L’intelligence des bébés va bien au-delà de ce que l’on imaginait.
Dans cette zone, les neurones semblent coder à la fois les lettres et leur position dans le mot. Par exemple, vous avez un neurone qui répond à la lettre « A », mais seulement quand elle est en début de mot. Le modèle que nous avons développé commence à être validé par des expériences d'enregistrement neuronal chez l'homme.
Avant d'apprendre à lire, il faut apprendre à parler. Les neurosciences peuvent-elles nous éclairer sur la meilleure façon d'apprendre à son enfant à parler ?
Des chercheurs – dont ma femme, Ghislaine Dehaene, fait partie – ont réussi à observer le cerveau et le comportement des bébés alors que l'enfant est mutique et ne produit pas de langage. Ils se sont rendu compte que ce n'est pas parce que l'enfant ne produit pas qu'il ne comprend rien. En réalité, le bébé accumule rapidement les données sur sa langue maternelle. Ça va très vite : en moyenne, l'enfant de 1 an comprend déjà 50 mots, et 200 mots à 2 ans, alors qu'il commence à peine à parler.
L'intelligence des bébés va bien au-delà de ce que l'on imaginait. Sur le plan grammatical, l'enfant analyse les phrases, il est capable de repérer les pronoms et les déterminants et comprend qu'après un déterminant comme « le » ou « la » vient souvent un nom ; ce qui l'aide à apprendre encore plus vite d'autres mots.
Qu'en est-il de l'apprentissage des langues étrangères chez les jeunes enfants ?
L'apprentissage précoce des langues étrangères est une magnifique illustration de la plasticité cérébrale de l'enfant. Imaginez le cerveau comme un bouillonnement de synapses, particulièrement intense durant les trois premières années de vie. Chaque cellule neuronale est comme un petit être autonome, créant constamment de nouvelles connexions.
Cette plasticité extraordinaire permet aux jeunes enfants d'apprendre plusieurs langues avec une facilité déconcertante. Ils adaptent naturellement leur langage à leur interlocuteur, sans mélanger les langues. C'est un don précieux que nous devrions encourager, car il ouvre des portes immenses pour leur avenir.
Il est crucial de souligner l'importance d'une intervention précoce, notamment pour repérer et aider les enfants avec des difficultés auditives. Que ce soit par la langue des signes ou des implants, agir avant 12-18 mois peut faire toute la différence dans leur développement linguistique.
Ces découvertes éclairent-elles le débat « nature vs culture » dans le développement du langage et de la plasticité cérébrale ?
Absolument. Nos recherches montrent qu'il existe un réseau linguistique présent dès la naissance, une sorte de terreau fertile. Mais ce potentiel inné a besoin d'être nourri par des interactions linguistiques riches et structurées dès les premiers mois de vie pour s'épanouir pleinement. C'est une belle métaphore de la condition humaine : nous naissons avec un potentiel extraordinaire, mais ce sont notre environnement et nos expériences qui le façonnent et le réalisent. Pour le langage comme pour tant d'autres aspects du développement, le petit être humain a besoin à la fois de son héritage biologique et d'un environnement stimulant. C'est cette synergie qui fait de nous ce que nous sommes.
Jusqu'à quel âge peut-on jouer sur la plasticité du cerveau ?
La plasticité ne s'arrête jamais ! Cependant, elle se ralentit nettement vers une vingtaine d'années. En neurosciences, on décrit la petite enfance comme une « période sensible » où le cerveau ne cesse de se modifier – à tel point qu'avant l'âge de 10 ans il est possible de perdre tout un hémisphère sans conséquences apparentes. Avec l'âge, ces capacités diminuent, mais même une personne âgée peut encore apprendre à parler une nouvelle langue ou à jouer du piano. Elle ne le fera jamais avec la même fluidité qu'un enfant, mais elle pourra se voir progresser, jour après jour, et y prendre du plaisir, ce qui est essentiel.
Y a-t-il un moyen de stimuler cette plasticité tout au long de sa vie, jusqu'au grand âge ?
Précisément, l'exemple des musiciens nous donne d'excellentes pistes, car leurs pratiques sont en harmonie avec bon nombre de données des neurosciences cognitives. Citons d'abord une pratique quotidienne de l'activité à apprendre, sans se décourager mais en prêtant attention aux erreurs, car c'est leur correction, la plus précise possible, qui permet de progresser.
C'est pourquoi la pratique sous l'égide d'un maître est si importante – mais un maître bienveillant, qui ne punit pas les erreurs mais indique simplement comment faire mieux. Apprendre en groupe est également motivant. Enfin, bien entendu, le sommeil joue un rôle essentiel, même s'il est moins efficace chez l'adulte que chez l'enfant.
Cela dit, la plasticité cérébrale est vraiment moindre chez la personne âgée, et il est frustrant de voir un gamin apprendre les langues trois fois plus vite que nous ! Comprendre pourquoi la plasticité se ferme et comment la rouvrir sont des enjeux majeurs en médecine.
Est-ce tout simplement possible ?
En fait, si l'on parvenait à rendre aux neurones adultes un peu de la fluidité de l'enfance, peut-être parviendrait-on à effacer les souvenirs traumatiques ou à atténuer les séquelles d'un accident vasculaire cérébral. Or on est en train de découvrir que certains agents pharmacologiques dissolvent les « filets périneuronaux » qui emprisonnent les neurones adultes et seraient responsables de leur mobilité réduite. Parmi ces molécules à suivre figurent les psychédéliques, longtemps décriés mais d'un intérêt croissant en psychiatrie. Certaines expériences montrent que la MDMA, par exemple, plus connue sous le nom d'ecstasy, ou le LSD peuvent rouvrir une période sensible pour l'apprentissage chez la souris, ou permettre aux soldats de dépasser leurs souvenirs post-traumatiques – bien entendu dans un contexte thérapeutique bien encadré.
Quel message essentiel adressez-vous aux parents ?
Il est simple : parlez à vos enfants, le dialogue est aussi important pour leur cerveau que l'air et l'eau ! Malheureusement, certains parents sous-estiment l'importance de cette interaction, pensant à tort que la télé ou les écrans peuvent remplacer le dialogue. C'est une erreur profonde. Des études récentes montrent clairement que les conversations parents-enfant stimulent un développement cérébral harmonieux et un langage plus efficace. Dans notre monde dominé par les écrans, il est plus important que jamais de privilégier ces moments d'échange direct avec nos enfants.
Vous insistez également sur l'importance du sommeil, condition sine qua non d'un bon apprentissage…
Le sommeil remplit plusieurs rôles cruciaux pour notre cerveau. Il permet de nettoyer celui-ci de toxines qui s'accumulent pendant la journée, et donc de restaurer la fonction cérébrale. Mais il intervient également dans l'apprentissage. Le cerveau ne se contente pas de se reposer pendant le sommeil, il est en fait extrêmement actif, particulièrement chez le jeune enfant. Une nuit de sommeil chez l'enfant peut être trois fois plus efficace sur le plan de l'apprentissage qu'une nuit de sommeil chez l'adulte. Le cerveau réactive nos expériences passées, consolide la mémoire et réorganise nos pensées.
Si l’enfant a encore besoin de la sieste, il faut le laisser dormir.
De plus en plus, on s'aperçoit que la structuration des connaissances se produit pendant le sommeil. Par exemple, si on veut qu'un enfant maîtrise le vocabulaire ou qu'il progresse dans l'apprentissage des mathématiques qu'il a fait la journée, son sommeil est extrêmement important. Des études ont montré que, si on laisse dormir des gens après un apprentissage, cet apprentissage est beaucoup plus consolidé que chez ceux qu'on a privés de sommeil.
C'est pourquoi, au Conseil scientifique de l'Éducation nationale, nous insistons énormément sur le rôle de la sieste chez les petits. Même en moyenne section de maternelle, certains enfants ont encore besoin de faire la sieste. Notre message est clair : si l'enfant a encore besoin de la sieste à cet âge-là, il faut le laisser dormir. Contrairement à ce que pensent certains enseignants et inspecteurs, ce n'est pas du tout une perte de temps. Pareil pour les adolescents, qu'il faut laisser dormir le matin s'ils en ont besoin.
Le cerveau permet de consolider les connaissances, mais pas seulement… Pouvez-vous nous parler de ce que vous appelez le « pouvoir créatif du sommeil » ?
De jolies recherches récentes montrent que le cerveau ne se contente pas de rejouer des patrons d'activité neurale, il les recombine. Les neurones se réactivent, mais dans un ordre différent et avec une flexibilité plus élevée, qui peut d'ailleurs expliquer notre contenu mental de rêve : ces recombinaisons peuvent être extrêmement créatives ! Cette créativité nous aide à trouver des solutions, notamment dans les mathématiques ; l'expérience a montré qu'on trouve plus facilement la solution d'une énigme mathématique si on dort dessus.
Certains ont-ils plus la bosse des maths que d'autres ?
Nous avons toutes les preuves qu'il y a un effet majeur de l'éducation dans ce domaine. Notre cerveau comprend des représentations précoces des objets mathématiques, en particulier les nombres approximatifs, mais ces intuitions se transforment beaucoup sous l'effet de l'éducation. Il faut en finir avec l'idée qu'il y aurait des élèves « doués » et d'autres « pas doués » en mathématiques. Non seulement cette perspective fixiste est fausse, mais elle a des effets pervers sur le système éducatif. Les élèves un peu en avance croient qu'ils n'ont plus besoin de faire d'efforts. Et ceux qui sont en retard pensent que c'est fichu pour eux et que ça ne changera jamais. Les deux sont faux. La recherche montre que, en réalité, c'est l'effort exigé par les mathématiques et l'engagement dans cet apprentissage, jour après jour, qui va transformer les circuits du cerveau.
En quoi le cerveau d'un mathématicien est-il spécifique ?
Certains pensent que les mathématiciens ont un cerveau différent, mais c'est encore un neuromythe ! Nos recherches d'imagerie cérébrale montrent que, pour réfléchir aux objets mathématiques, même les plus abstraits, un matheux utilise les mêmes régions que nous possédons tous et qui, au départ, se dédient aux nombres et à l'espace. Dès la plus tendre enfance, et même chez les autres primates, ces régions répondent déjà aux nombres approximatifs : un, deux, trois, peu, beaucoup… C'est l'éducation qui étend les capacités de ces aires cérébrales en élargissant progressivement les concepts : avec le comptage, le concept de nombre devient précis (dès la maternelle), puis nous apprenons à penser les grands nombres, comme 20 ou 100, et à calculer avec les chiffres arabes, enfin à penser les fractions ou les décimaux. Chez les mathématiciens, à travers le même processus d'apprentissage, le vocabulaire s'étend encore – réels, irrationnels, complexes… –, et les problèmes que soulèvent ces nouvelles idées conduisent à proposer différents types d'infinis, la théorie des groupes… Tous ces objets mentaux font partie de l'enveloppe des concepts « pensables » par n'importe quel membre de l'espèce humaine.
Sur quels types d'efforts pensez-vous qu'il faille concentrer son énergie pour progresser en maths ? Le calcul mental ?
Les programmes scolaires français ont tendance à insister lourdement sur les nombres, et, bien sûr, il faut créer des automatismes en arithmétique, mais les mathématiques ne se résument pas au calcul, loin de là. En réalité, les mathématiques ont commencé avec Euclide et la géométrie.
Il est très important de développer ce sens de la vision dans l'espace, car il va beaucoup aider les enfants à suivre en maths. On peut s'entraîner dans ce domaine par le jeu. Les nouveaux programmes vont dans la bonne direction, en insistant notamment sur l'idée de motifs mathématiques dès la maternelle ; lorsque vous jouez avec des losanges et des carrés, que vous comprenez comment ces pièces peuvent s'ajuster ensemble pour paver l'espace, que vous apprenez à faire un mandala, vous êtes déjà sur la voie des mathématiques.
Et, dans l'école française, n'a-t-on pas trop tendance à punir et à blâmer les erreurs en général, qui sont pourtant essentielles pour un bon apprentissage ?
On parle souvent de revenir aux « fondamentaux » à l'école, mais de quoi parle-t-on ? Du langage bien sûr, en particulier la lecture, puis des mathématiques et du calcul, mais on ne pense pas assez au troisième, qui réside dans le bien-être et la santé mentale des élèves.
Certains enfants sont totalement découragés par l'école française. Une enquête classe la France 62e sur 65 pays pour la capacité d'insuffler aux élèves la confiance en soi. La priorité devrait être de donner aux élèves l'envie d'apprendre, parce qu'ils ont confiance dans leur capacité d'y arriver. Tout le monde peut et doit y arriver. Dans ce contexte, faire des erreurs est strictement normal, ça ne doit pas être un motif de perte de confiance en soi.
Une meilleure confiance en soi peut-elle permettre de faire preuve de plus d'efficacité cérébrale ?
La confiance en ses propres capacités est un ingrédient essentiel de l'apprentissage. En effet, c'est elle qui détermine la quantité d'effort et d'engagement cognitif que nous allons investir. Qui imaginerait de s'investir dans un domaine où il est sûr d'échouer ? C'est pourtant, hélas, le signal que l'école renvoie parfois à certains élèves en leur accordant, semaine après semaine, de mauvaises notes et des bulletins angoissants. Persuadés d'être nuls, ils n'ont aucune chance de progresser. En laboratoire, pour qu'un animal ne perde pas l'envie d'apprendre, il faut lui donner 70 à 80 % de récompenses positives, et seulement environ 20 % d'essais juste assez difficiles pour le mettre au défi de progresser. Adoptons cette idée dans les classes !
En quoi l'erreur nous permet-elle de progresser ?
Certains ont honte de leurs erreurs, et l'école renforce parfois ce message en parlant de « faute ». Mais c'est une absurdité : personne n'apprend sans faire d'erreur. La plupart des algorithmes contemporains d'apprentissage sont fondés sur la comparaison, implicite ou explicite, entre ce que je fais et ce que j'aurais dû faire – un signal d'erreur. Le cerveau est parcouru de signaux d'erreur qui sont utilisés pour ajuster, en permanence, notre comportement aux retours que nous recevons du monde extérieur et du milieu intérieur. Se tromper, c'est encore apprendre.
Que devient notre mémoire à l'heure de l'IA ?
Il y a d'autres belles surprises dans votre livre, comme les capacités mentales des aveugles…
Oui, même un aveugle de naissance « voit » des images mentales ! Ce qu'on veut dire par là, c'est la capacité de manipuler mentalement des objets tridimensionnels, cette faculté essentielle qui vous permet de représenter un objet dans ses trois dimensions, de le faire tourner dans votre tête, de comprendre son volume et de naviguer dans l'espace. De nombreux aveugles aiment les mathématiques et s'y épanouissent. Nos expériences commencent à montrer comment leur cerveau réutilise leurs aires visuelles : celles-ci ne restent pas silencieuses, mais sont recyclées pour projeter sur le monde extérieur une même vision abstraite des objets mathématiques.
Jusqu'où ira l'intelligence artificielle ? Elle nous aide déjà à en savoir plus sur notre cerveau…
Je suis persuadé que nous sommes sur une courbe de progrès inarrêtable. Les modèles actuels sont encore primitifs, bien que très impressionnants, mais on continue d'y ajouter des ingrédients qui proviennent souvent de l'observation fine du cerveau et qui font progresser ces machines. Par exemple, des chercheurs commencent à ajouter dans les systèmes visuels artificiels des connexions qu'on appelle « horizontales », qui relient les neurones entre eux au sein d'une même aire du cortex, et qui existent dans notre cerveau mais pas dans la plupart des modèles d'IA actuels.
Ces connexions permettent de résoudre, par des calculs dynamiques, certains problèmes qui étaient jusque-là impossibles pour les réseaux de neurones classiques. De nombreuses astuces de notre cerveau ne sont pas encore intégrées dans les intelligences artificielles. Elles font d'ailleurs de nombreuses erreurs, particulièrement dans le domaine des mathématiques. Elles ne « voient » pas ce dont elles semblent pourtant parler avec aisance. Demandez-leur de dessiner un cercle avec des droites tangentes, par exemple, ou même « un triangle bleu qui touche un cercle vert », et la plupart des intelligences artificielles s'effondrent totalement.
Notre cerveau pèse 1,3 kg et fonctionne avec 20 watts, les géants de l’IA font la course aux centrales nucléaires .
Autant le réseau cérébral du langage commence à être bien imité, autant celui des mathématiques et de la géométrie reste largement incompris et médiocrement modélisé. Par ailleurs, vu en tant que circuit intégré, le cerveau humain reste inimitable. Même si l'on commence à comprendre ses algorithmes et à les reproduire dans des machines qui possèdent maintenant plusieurs centaines de milliards de paramètres, on n'arrive pas à le faire avec la même efficacité énergétique. Là où notre cerveau pèse 1,3 kg et fonctionne avec 20 watts, les géants de l'IA font la course aux centrales nucléaires !
Le cerveau humain, avec sa capacité d'imagination et de créativité spontanée, reste une merveille que nous continuons d'explorer et d'admirer. On l'observe surtout chez les tout-petits – je le vois avec mes petits-enfants –, qui développent jour après jour des facultés nouvelles. C'est un émerveillement constant que l'intelligence artificielle n'est pas près d'égaler !
« Une idée dans la tête », de Stanislas Dehaene, Editions Odile Jacob, octobre 2024, 240 pages, 17 euros.