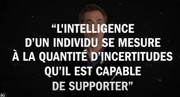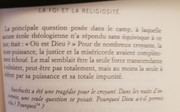L'art de se complaire dans les sophismes: l'appel à l'autorité et l'appel à l'ignorance pour ne surtout pas répondre aux contradictions.Philippe de Bellescize a écrit : 28 janv. 2025, 10:01 .....L'Être premier le créateur de toutes choses - que les traditions religieuses nomment Dieu.Dominique18 a écrit : 27 janv. 2025, 15:44 "Dėfinissez-moi d'abord ce que vous entendez par Dieu et je vous dirai si j'y crois."
L'Etre premier existe puisque les traditions religieuses en ont fait leur credo. Qui plus est, il est le créateur de toutes choses.
Pie XII n'aurait pas répondu mieux. Il n'y a donc pas de questions à se poser puisque tout est déjà défini. On ne sait pas comment, par quoi, et par qui, mais c'est ainsi, aucun souci. Ce qui donne une idée du passéisme référentiel.
L'art de ne pas tenir compte des objections et remarques et, par une pirouette stylistique espérer s'en sortir en posant les mêmes énièmes questions alors que les réponses ont déjà été exposées.
Pas la peine de s'attarder sur Carlo Rovelli et les expériences de pensée, c'est futile et épuisant. Brandolini, ça va un moment.
Surtout quand d on apprend qu'on peut séparer le temps de l'espace, que le photon a une masse... et ce en totale contradiction avec les états actuels constatés par les scientifiques, qui font consensus. La discussion devient inutile et absurde.
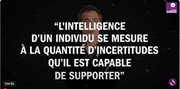
Édit.. en résumé...
"Je ne sais pas tout, je ne comprends pas tout, mais ce n'est pas grave puisque que je sais que j'ai raison."
https://www.leprincipemoteurdelunivers. ... azine.html
C'est clair et limpide....Si l’on a « le goût du vrai », on doit pouvoir tenir compte de certains « courts-circuits » – quand on les a identifiés – en ne les passant pas sous silence. Or, je me demande si c’est toujours vraiment le cas...
Je suis en accord avec cette présentation des choses, à condition de reconnaître que la physique peut, elle aussi, se tromper dans la façon de traiter une difficulté. La philosophie peut, à partir de là, avoir un rôle critique. Je prétends que l’approche philosophique et logique de mon dernier livre, Paradoxe sur l’invariance de la vitesse de la lumière, a des conséquences scientifiques « négatives ». Il démontre que l’on ne peut pas s’appuyer sur la relativité restreinte pour penser l’espace-temps...
or, le raisonnement de mon ouvrage cité supra est incontournable. Il s’agit de comprendre que la conception de l’espace-temps de la physique, depuis plus de cent ans, repose sur un principe faux, ou du moins inadéquat. À partir de là se pose la question de savoir, une fois remis en cause le postulat de l’invariance de la vitesse de la lumière, sur quels principes une nouvelle conception de l’espace-temps peut être fondée...
En conclusion, on peut remarquer que, si les scientifiques refusent de reconnaître la valeur, pourtant avérée, de certains « courts-circuits », ils limitent leur capacité à cerner des questions connexes plus avancées. Ce n’est pas seulement un questionnement scientifique qui est en cause, mais aussi la possibilité d’un progrès culturel important. Un scientifique peut-il rester un chercheur si, quand il a identifié le bien-fondé d’un raisonnement, il fait comme s’il ne l’avait pas identifié ?
Qu'ajouter de plus ?